La Banque de la République du Burundi (BRB) a récemment dévoilé une initiative annonçant l’introduction du crédit documentaire comme un nouvel instrument. Pour l’économiste Jean Ndenzako, cet instrument risque de causer plus de torts.
Qu’est qu’un crédit documentaire ?
Un crédit documentaire, ou lettre de crédit est un instrument financier utilisé dans le commerce international. Il sert de garantie entre l’acheteur et le vendeur pour s’assurer que le paiement et la livraison des marchandises se déroulent sans heurts.
Comment fonctionne ce système ?
Pour une ouverture du crédit documentaire :
1. L’acheteur demande à sa banque (la banque émettrice) d’ouvrir un crédit documentaire en faveur du vendeur.
2. Notification : La banque émettrice informe la banque du vendeur (la banque notificatrice) de l’ouverture du crédit documentaire.
3. Livraison des marchandises : Le vendeur expédie les marchandises et présente les documents requis à sa banque.
4. Vérification des documents : La banque notificatrice vérifie que les documents correspondent aux termes du crédit documentaire.
5. Paiement : Si tout est en ordre, la banque émettrice effectue le paiement au vendeur. Les documents couramment requis incluent la facture commerciale, le connaissement, le certificat d’origine et l’assurance. Cela protège les deux parties en s’assurant que les marchandises sont expédiées avant le paiement et que le paiement ne sera effectué que si les conditions du crédit documentaire sont remplies.
La Banque de la République du Burundi (BRB) s’implique dans ce système. Quelle est votre réaction ?
Cet outil, habituellement réservé aux transactions commerciales internationales pour sécuriser les paiements entre acheteurs et vendeurs, semble être une tentative de la Banque centrale pour dynamiser une économie étouffée par la pénurie de devises et une inflation galopante.
Est-ce un problème ?
Mais cette décision, bien qu’ambitieuse, interroge profondément son alignement avec le rôle traditionnel d’une banque centrale et expose le pays à des risques majeurs.
Lesquels ?
Dans un contexte où l’inflation atteint 36,3 % (selon des estimations de décembre 2024) et où les réserves de devises couvrent à peine 1,7 mois d’importations. Cette annonce suscite plus d’inquiétudes.
Comment ?
Une rupture avec le rôle classique de la BRB. Le mandat d’une banque centrale, tel que défini par la théorie économique moderne, repose sur la régulation de la masse monétaire, la stabilisation des prix et la supervision du système financier. La BRB, en théorie, devrait se concentrer sur ces priorités à travers des outils comme le taux directeur ou les opérations d’open market, surtout dans un pays où la stabilité économique reste fragile.
Pourtant, en adoptant le crédit documentaire – un mécanisme opérationnel géré traditionnellement par les banques commerciales – la BRB semble s’aventurer hors de son domaine habituel. Cette déviation pourrait trahir une faiblesse du secteur bancaire privé, incapable de soutenir seul le commerce international.
Quelles sont les conséquences ?
Cette déviation risque aussi de brouiller les lignes entre politique monétaire et activités bancaires directes, compromettant l’indépendance et la crédibilité de l’institution. Dans un pays où les interférences politiques ont parfois influencé les institutions financières, cette initiative pourrait ouvrir la porte à une politisation accrue, avec des crédits documentaires potentiellement détournés au profit d’élites bien connectées.

Des dangers pour l’économie nationale ?
L’un des dangers les plus immédiats de cette politique est le risque financier qu’elle fait peser sur la BRB. En s’engageant à faciliter ou garantir des crédits documentaires, la banque centrale s’expose à des pertes en cas de défaut de paiement par les entreprises bénéficiaires.
Avec des réserves de devises déjà limitées, une telle éventualité pourrait épuiser ses ressources et aggraver la pression sur le franc burundais, qui souffre déjà d’une sous-évaluation sur les marchés parallèles. Si la BRB devait intervenir pour couvrir ces engagements, elle risquerait de fragiliser davantage sa capacité à stabiliser l’économie, exposant le pays à une crise de liquidité encore plus profonde.
Quid de l’inflation ?
L’Inflation et la dépréciation sont un cocktail explosif en gestation. Un autre péril majeur réside dans l’impact potentiel sur l’inflation et la monnaie. Si la BRB finance ces crédits documentaires en augmentant la masse monétaire – par exemple via des prêts aux banques ou des avances directes – elle pourrait alimenter une inflation déjà hors de contrôle. Dans une économie où la demande de devises dépasse largement l’offre, cette injection de liquidités risquerait aussi d’accélérer la dépréciation du franc burundais, rendant les importations, vitales pour le Burundi, encore plus onéreuses.
Pour une population majoritairement dépendante de produits de base étrangers, cette spirale inflationniste pourrait aggraver la précarité et miner les modestes gains économiques réalisés ces dernières années.
Un spectre d’une mauvaise allocation des ressources ?
L’histoire économique du Burundi, marquée par la corruption et le clientélisme, amplifie un autre risque : celui d’une mauvaise allocation des ressources. Si les crédits documentaires sont attribués de manière opaque ou biaisée, ils pourraient bénéficier à une poignée d’acteurs privilégiés – comme des exportateurs de café proches du pouvoir – plutôt qu’à l’ensemble de l’économie.
Une telle distorsion limiterait l’impact de cette politique sur la croissance inclusive et renforcerait les inégalités, transformant un outil potentiellement utile en un vecteur de favoritisme. Sans mécanismes de transparence rigoureux, cette initiative pourrait ainsi échouer à atteindre ses objectifs de relance économique.
Un risque pour la crédibilité internationale ?
Elle est en jeu. A l’échelle mondiale, cette annonce pourrait ternir la réputation de la BRB auprès des partenaires internationaux. Le Fonds monétaire international (FMI), la Banque mondiale et les investisseurs étrangers, qui scrutent les efforts du Burundi pour restaurer sa crédibilité après des années de sanctions, pourraient percevoir cette démarche comme une improvisation risquée.
Une banque centrale qui s’écarte des normes de gouvernance reconnues – en s’impliquant dans des opérations commerciales directes – pourrait compliquer les négociations pour un soutien financier extérieur, essentiel pour un pays aux ressources limitées. Cette perte de confiance serait d’autant plus dommageable pour un Burundi qui cherche à se repositionner sur la scène internationale.
Ce n’est donc pas une solution efficace ?
Une solution mal taillée pour des problèmes structurels. L’intention de la BRB est peut-être louable : stimuler le commerce extérieur pour attirer des devises et soutenir une économie asphyxiée par des contraintes structurelles. Mais le choix du crédit documentaire comme instrument direct semble mal calibré. Une banque centrale n’est pas conçue pour gérer des outils opérationnels de ce type, qui relèvent des compétences des banques commerciales.
Une approche plus judicieuse aurait été de renforcer le secteur bancaire privé – par des incitations ou des garanties indirectes – tout en laissant à la BRB son rôle de régulateur. Sans s’attaquer aux racines des maux économiques du pays, comme la faible productivité, la dépendance aux matières premières et une gouvernance fragile, cette initiative risque de n’être qu’un pansement temporaire, assorti de conséquences potentiellement désastreuses.
Alors audace ou imprudence ?
En définitive, l’introduction du crédit documentaire par la BRB se présente comme une expérience audacieuse dans un paysage économique déjà instable. Si elle vise à répondre à des besoins pressants, elle expose le pays à des risques financiers, monétaires et institutionnels difficilement soutenables. Les prochains mois seront déterminants pour juger si cet « instrument » peut réellement dynamiser le commerce sans compromettre la stabilité fragile du Burundi.
Pour l’heure, cette décision ressemble davantage à un pari risqué qu’à une stratégie mûrement réfléchie, laissant planer le doute sur ses chances de succès dans un environnement aussi précaire.
Propos recueillis par Fabrice Manirakiza

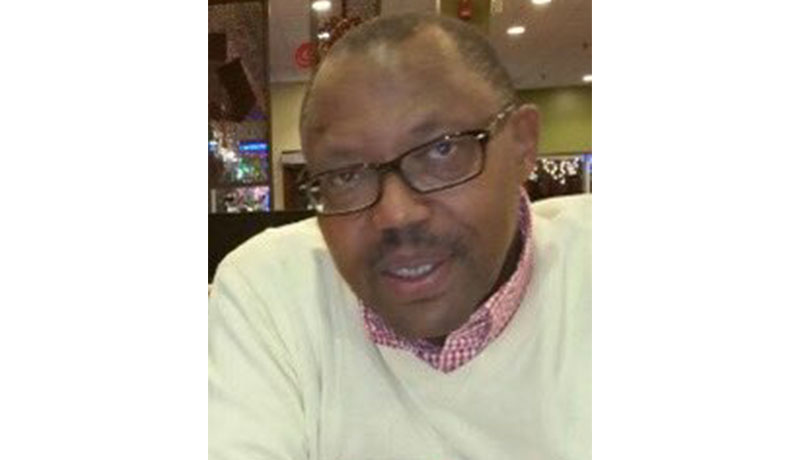
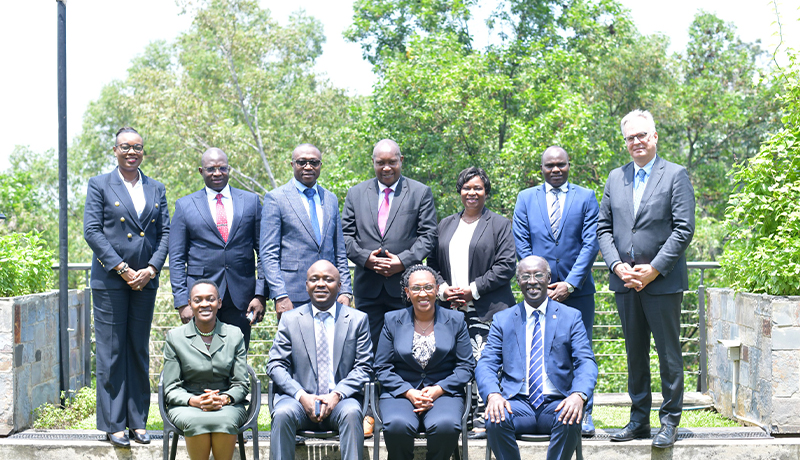










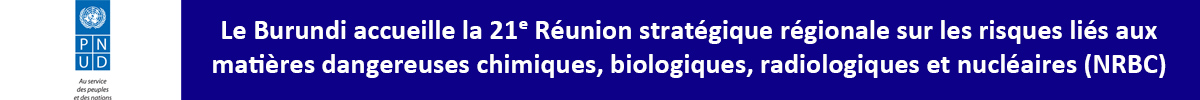


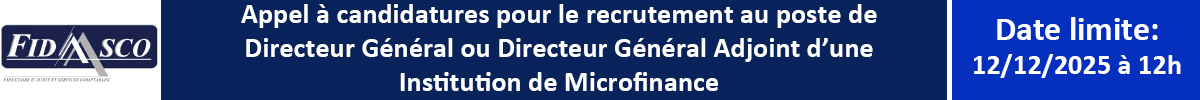






En français facile, ils vont accorder des crédits documentaires aux acheteurs [leurs amis et/ou aux autres] avec exigence des commissions. Ils vont aussi valider les transactions à couvrir et demander des rétro-commissions chez les vendeurs [potentiellement eux-mêmes en se plaçant hors des frontières burundaises ou en devenant commissionaires des vendeurs étrangers qui leur seront amis de/pour les circontances]. Ainsi, les transactions risquent d’être surfacturées et la BRB va se vider du peu de devises qui lui restaient. Non seulement ils sont devenus commerçants, maintenant ils transforment la BRB avec son trésor public et sa réserve nationale en banque commerciale pour eux-mêmes.
Mon cher Kaziri
Cela veut dire qu’avec la corruption qui sévit au Burundi: le pays le plus pauvre et le plus corrompu au monde
Vous recevez des $ à la BRB, vous allez à pied (Je voulais dire en Mercedes, dernier modèle) au marché noir et vous devenez immédiatement milliardaire.
C’est pourquoi, il n’y a plus d’esdence, de sucre, de médicaments au oays de Mwezi Gisabo.
Y a t il quelqu’un qui peut expliquer comment un payscl au bord de la banqueroute peut se permettre decl maintenir un taux de change artificiel?
Regarde!!!!!!
Le $usd s’échange à la brb comme suit »:
bif 2980
Le taux au marché parallèle: bif 7609
Nobody can understand. it’s
completely unbelievable 🐁🐖🐅
C’est un article intéressant.
Bonjour. je trouve qu’il serait mieux de présenter l’auteur de l’analyse si pertinente. Merci
Merci pour la remarque
On va en tenir compte
Le modérateur
Que ce soit la BRB ou les autres banques commerciales , une évaluation rigoureuse des risques permettrait d’identifier la crédibilité des entreprises concernées et de limiter les possibilités de défauts de paiement. De plus, instaurer des plafonds limités sur les crédits documentaires garantirait que les engagements financiers restent à des niveaux maîtrisables, tant pour les entreprises que pour les banques.
Ces approches combinées renforceraient non seulement la stabilité financière des banques, mais elles enverraient aussi un message fort de prudence et de sérieux à tous les acteurs économiques.
Cher Lazare,
Pourriez vous nous donner un exemple d’un pays qui a instauré ce processus et qui, par consequent, a réussi à relancer l’économie? La Zimbabwe? L’Argentine?
Pour moi, ceci consiste à un gouvernement qui veut décider les gagnants et les perdants. Tout sauf la méritocratie.
Je soupçonne que les banques qui sont des institutions privées, donc avec un devoir fiduciaire à leurs actionnaires, refusent de financer les transactions qui n’ont aucun sens économique!
L’autre qui arrive à perdre le stock d’essence de 4 mois, comme il contrôle la BRB gère par un rappeur ou quelque chose dans ce genre, va improviser ! Comme j’ai dit, le mot « Méritocratie » n’existe pas dans les têtes gouvernantes. Ils passent tout leur temps à étudier comment confisquer les biens des Burundais qui travaillent.
Résultat finale: Destruction de BIF et toutes les transactions au Burundi se feront en USD ou Euro. Si vous vouler un exemple, aller voir en RDC, pardon le Zaire! Comme on dit « if it looks like a duck, walks like a duck and quacks like a duck, then it’s a duck » Toute la bande CND-FDD est comme des Zairois sous Mobutu.