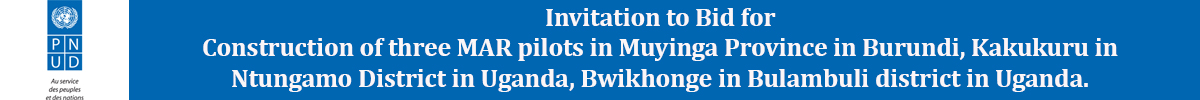Dans le Burundi traditionnel, le soir, au coin du feu, la famille réunie discutait librement. Tout le monde avait droit à la parole et chacun laissait parler son cœur. C’était l’heure des grandes et des petites histoires. Des vérités subtiles ou crues. L’occasion pour les anciens d’enseigner, l’air de rien, la sagesse ancestrale. Mais au coin du feu, les jeunes s’interrogeaient, contestaient, car tout le monde avait droit à la parole. Désormais, toutes les semaines, Iwacu renoue avec la tradition et transmettra, sans filtre, la parole longue ou lapidaire reçue au coin du feu. Cette semaine, au coin du feu, Désiré Manirakiza.
Votre qualité principale ?
La détermination.
Votre défaut principal ?
En tant qu’être humain, j’ai beaucoup de défauts. Il m’est difficile d’en choisir le principal. Peut-être faudrait-il laisser ceux qui interagissent avec moi le soin d’en dire davantage. Mais comme il faut choisir, je dirais que mon principal défaut c’est le pessimisme. Paradoxal, n’est-ce pas, pour quelqu’un qui dit être déterminé ! Mais la vie est ainsi, ce n’est pas toujours ce qu’on aime qu’on soit et vice versa.
La qualité que vous préférez chez les autres ?
Ici aussi, difficile de choisir une seule qualité. La vie étant complexe, il y a trois qualités que je préfère chez les autres. Le pardon, l’empathie et la loyauté.
Le défaut que vous ne supportez pas chez les autres ?
Je ne vais pas choisir ici un seul défaut. Sur la base de mon expérience, trois défauts me sont insupportables chez les autres : la rancune, l’hypocrisie et l’extrémisme. Comme un ruminant, le rancunier revient sur le mal qu’on lui a fait et n’oublie donc pas. Il ressent le remboursement des blessures, des injustices, des dettes sociales comme un impératif tellement exigeant qu’il ne trouve la paix intérieure que lorsqu’il parvient à rendre les coups reçus. En pensant rembourser les dettes, le rancunier devient en réalité son propre ennemi, parce qu’en ne pardonnant pas, la douleur le ronge toute la vie et vit éternellement dans la peur. Alors que, ainsi que le disait Nelson Mandela, le pardon libère l’âme et fait disparaître la peur, alors que le pardon est une arme puissante pour désarmer les méchants, la rancune détruit l’âme et fait de la peur une réalité permanente.
L’hypocrite, contrairement au rancunier, n’a pas nécessairement subi de préjudices. Il joue un double jeu ; il est malin et moqueur. Tel le Bakame de nos contes, il sait jouer du Lion et du Renard. Il marche avec un poignard dans la poche arrière et une rose entre ses mains. Véritable caméléon, il a une émotion forte et est doté d’une capacité de jeu hors du commun. Il peut donc embobiner tout le monde. Il est dit être le défenseur de l’égalité, mais trouve du plaisir à dominer les autres ; officiellement, il parle de paix, du vivre-ensemble, de l’amour, du pardon, de retenue, de la tolérance, de l’inopportunité de la guerre, mais éprouve du plaisir et se réjouit lorsque des familles entières sont décimées ; il chante les idéaux de la démocratie, de la gouvernance, mais embrasse en coulisses les dictateurs et/ou est tyrannique dans ses relations ; il dit être pour la tolérance, mais ne supporte pas de remise en cause, même lorsque celle-ci n’a rien de méchant ; bref, les paroles de l’hypocrite sont belles, mais son intérieur est rebelle.
Enfin, il y a l’extrémiste. Tout comme l’hypocrite, pour développer son extrémisme et sa haine, il n’a pas besoin d’alibi ; il n’a pas besoin d’avoir subi quelque violence que ce soit. Il est manipulateur, il a une haine gratuite. Volontairement, il a une conception simplifiée et écornée de la réalité. Là où les autres voient la pluralité, il y décèle une simplicité binaire et manichéenne. Pour lui, entre le « Nous » interne, apaisé et non violent, et le « Eux » externe et menaçant, il n’y a que le vide, le trou noir ; point d’intermédiaire, point de position médiane ou équidistante. De ce point de vue, il est un chantre de l’affrontement.
Les trois catégories de personnages font de la manipulation leur mode opératoire ; ils opèrent par séduction (à travers leurs discours), victimisation, culpabilisation et intimidation. Leur point commun est qu’ils dénient le vivre-ensemble, invitent à l’affrontement et à la haine de l’autre. Plus une société compte d’individus acquis à la rancune, à l’hypocrisie et à l’extrémisme, plus grand est le risque d’assister à l’érection de ce qu’Amin Maalouf appelle « les identités meurtrières », l’effritement du lien social et, conséquemment, à la déchéance du corps social.
La femme que vous admirez le plus ?
Sans doute, ma mère. Elle est décédée lorsque j’avais huit ans. J’ai peu de souvenirs d’elle, mais je garde d’elle le souvenir d’une une femme très rigoureuse, presque autoritaire. Etant donné que la présence de mon père était en pointillé, son autoritarisme est ce qu’elle avait pour pouvoir dresser et canaliser l’énergie des gamins que nous étions (moi et mon grand frère). Son éducation dure et son intransigeance est, suis-je tenté de dire, ce qui m’aura permis de survivre dans ce monde après son décès. Personne ou presque pour nous (me) protéger (mon père et ma mère sont morts le même mois), je n’ai pu m’adapter que parce que très tôt, j’avais appris que se plaindre ne résout rien, à part se rendre ridicule. Je profite d’ailleurs de cette tribune pour rendre un hommage à mon épouse qui, à plusieurs égards, joue les mêmes rôles qu’autrefois, ma génitrice jouait en l’absence de notre « Pater ».
L’homme que vous admirez le plus ?
Nelson Mandela. Pour moi, il est le parfait opposé du rancunier, de l’hypocrite et de l’extrémiste
Votre plus beau souvenir ?
Ma réussite au redoutable Concours national en 1994. Un événement ne m’a jamais autant ému. L’émotion suscitée par cette réussite était à la mesure des traumatismes et désespoirs causés par les multiples échecs à ce même examen. J’ai passé ce concours à trois reprises sans succès. C’est à la quatrième tentative, dans un désespoir difficile à décrire, que j’ai pu l’avoir. Si je l’avais raté, sans doute que j’aurais abandonné les études cette année. Tout le village se moquait déjà de moi – j’étais le plus grand de tous les élèves et le short de mon unique tenue scolaire ne parvenait plus à couvrir tout mon corps. Mes anciens camarades de classe, qui avaient décidé d’aller à Bujumbura où certains avaient réussi à décrocher un job de domestique, revenaient, de temps à autre, à la campagne avec quelques biens de la ville, et je dois admettre que je commençais à être séduit par leur nouvelle vie. Quand je vois les maltraitances et le déni d’humanité que subissent les domestiques dans nos maisons, ceux que le vocabulaire hérité de la colonisation désigne sous le vocable de B « boy », je lève les yeux vers ciel, fais un signe de croix et rends grâce au seigneur : je l’ai échappé belle !.
Votre plus triste souvenir ?
La disparition de ma mère, non pas tant parce qu’elle est morte, mais parce que je ne connais pas les circonstances de sa mort. Un jour, elle m’a envoyé lui chercher du jus de banane – Amake – chez ma tante qui devait préparer l’urwarwa. Ma mère était certes malade, mais pas agonisante. Je me suis rendu chez la tante ; le trajet faisait plus d’une heure de marche à pied. Arrivé, j’ai dû attendre quelque chose comme deux heures, le temps que le jus en question soit disponible. Lorsque, vers 15 h, je suis arrivé à proximité de chez nous, à un croisement de deux routes, j’ai aperçu de loin mon grand-père avec d’autres voisins, deux d’entre eux portant sur leurs épaules une litière – l’inderuzo – et d’autres des pelles et houes. Ils venaient d’enterrer ma mère. Je n’ai jamais eu d’explication, personne ne m’a jamais dit ce qui s’était passé et, aujourd’hui encore, j’ai peur de le demander. Ni les oncles, ni mon grand-père, ni mon grand frère, personne ne m’a même jamais montré sa tombe. Nous sommes d’une société qui n’a rien à faire avec la mémoire.
Quel serait votre plus grand malheur ?
Ne pas être en mesure de subvenir aux besoins de ma famille ; voir mes enfants souffrir de faim sans possibilité de leur donner à manger ; ne pas pouvoir les soigner, etc. Disparaître à jamais et les laisser seuls dans ce monde de brutes, sans défense, serait atroce pour moi.
Le plus haut fait de l’histoire burundaise ?
La signature, le 28 août en 2000, de l’Accord d’Arusha. Si cet accord signifiait le partage du pouvoir entre les élites factionnelles, il était surtout pour le bas peuple le symbole de la fin de la guerre avec tous ses malheurs. Il était porteur d’espoir en ce sens qu’il établissait, au Burundi, ce qu’Alexis de Tocqueville appelait, l’égalisation des conditions.
La plus belle date de l’histoire burundaise ?
Le 1er juillet 1962, jour de l’indépendance du Burundi. Certes, l’espoir placé en cette indépendance n’a duré que le temps des roses, parce que, cela n’est un secret pour personne, après le départ du colon blanc, il s’est installé des colons noirs – les blancs de remplacement – mais le 1er juillet représente à ne point douter (à mes yeux) la plus belle date de l’histoire du pays.
La plus terrible ?
Le 21 octobre 1993, date de l’assassinat du président Melchior Ndadaye et de certains de ses collaborateurs. Le 21 octobre 1993 et les mois qui ont suivi marquent, et je pèse mes mots, l’effondrement de l’économie symbolique de notre société et ses valeurs. Les outils comme la machette, la serpette, le couteau, la houe, le bambou ont cessé d’être reconnus pour leur seul rôle dans l’agriculture, la cuisine ou la construction, pour devenir, dans l’imaginaire des Burundais, des symboles de la mort, de la terreur. Durant la crise qui a suivi cet assassinat, les Burundais se montrèrent particulièrement barbares et cruels à travers des scènes de mise à mort d’une rare animosité : pilage de bébés, éventrement des femmes enceintes, mise à mort par empalement et/ou par crucifiement, brûler vifs des victimes sans défense, etc. Le 21 octobre 1993 représente pour moi la date de notre dé-civilisation.
Le métier que vous auriez aimé faire ?

Quand j’étais encore élève, je voulais être « Muganga » : je ne savais pas établir le distinguo entre les différentes catégories qui composent le corps médical. Le « Muganga » était pour moi le modèle, il donnait la vie. Avec la crise, je me suis rendu compte que j’avais du mal à supporter la présence dans un hôpital, à manipuler le sang et à voir les morts. Après, mon désir a évolué, et j’ai voulu être avocat ; un désir qui, lui aussi, a vite été abandonné, lorsque j’ai pu me rendre compte que l’avocat, en tant que professionnel, ne faisait pas que plaider pour les justes martyrisés, mais qu’il plaide aussi pour les bourreaux, au grand dam des victimes. Pour moi, dans certaines circonstances, l’avocat me paraissait être la preuve vivante de manque d’empathie. J’ai donc décidé d’être enseignant, un métier merveilleux. Beaucoup de personnes sont loin d’imaginer le bonheur que procure le fait de voir évoluer des étudiants que l’on a accompagnés en modifiant, souvent de façon collaborative ou sans leur consentement, leurs répertoires de réflexion.
Votre passe-temps préféré ?
Lorsque j’ai un peu de temps, je joue au football. Pendant mon séjour au Burundi, durant le temps libre, je sacrifie à la tradition : comme tous les hommes ou presque (Burundais) je vais au bar, seul ou avec des amis. Le bar est un endroit idéal pour créer des liens, mais aussi pour apprécier les mutations de notre société et sa culture.
Votre lieu préféré au Burundi ?
Les plages du lac Tanganyika, et plus particulièrement Saga plage, un lieu magnifique qui permet d’entrer en contact avec ce que la nature a de plus magique : l’eau. En plein midi, le vent souffle, les vagues vont et viennent, emportant avec elles certaines traces de l’humain, qu’elles ne tardent pas à ramener. L’ardeur de la chaleur de Bujumbura se voit éclipsée par plus forte qu’elle.
Le pays où vous aimeriez vivre ?
Le Burundi. Je vis ailleurs non pas par choix, mais par nécessité.
Le voyage que vous aimeriez faire ?
Je ne suis pas très porté aux voyages et aux aventures.
Votre rêve de bonheur ?
Sur le plan personnel et familial, mon rêve est d’accompagner mes enfants jusqu’à leur maturité, partir après qu’ils soient devenus «Ibiswi vyinobera » (Traduction libre : des enfants à mesure de subvenir seuls à leurs besoins). Sur le plan sociétal, je rêve d’un Burundi uni, prospère, débarrassé de tous les rancuniers, hypocrites, extrémistes et de toutes les idéologies et logiques suprémacistes ; un Burundi dans lequel tous les Burundais, « riches » comme « pauvres », « grands » comme « petits », ceux du Nord comme ceux du Sud, de l’Est ou de l’Ouest jouiraient d’une estime de soi, d’une reconnaissance et d’une dignité humaine. Un Burundi où le « principe de parité de participation », pour emprunter une terminologie chère à Nancy Fraser, guiderait toute relation sociale.
Votre plat préféré ?
A vrai dire, à part quelques caprices, je n’ai pas de plat préféré. Je mange tout ; du manioc au macabo, du poisson braisé au porc-épic en passant par des brochettes de chèvre ou du Ndolé aux crevettes.
Votre chanson préférée ?
Je n’ai pas de préférence. J’écoute du tout, et je choisis en fonction des émotions du jour.
Quelle radio écoutez-vous ?
J’écoute, chaque matin à 6h30, le journal Afrique matin sur RFI
Avez-vous une devise ?
Oui et c’est celle-ci : « Ce qui fait la valeur et la grandeur de l’homme n’est pas ce qu’il fait par principe, mais plutôt ce qu’il fait un principe ».
Votre souvenir du 1er juin 1993 ?
Les réjouissances des partisans du Frodebu et l’angoisse de ceux de l’Uprona. Les premiers, à l’annonce des résultats de la présidentielle, se rendent, feuilles de bananiers en mains, chez les seconds pour les narguer. Cette réjouissance sera proportionnelle à leur angoisse/douleur le 21 octobre de la même année.
Votre définition de l’indépendance ?
L’indépendance, à mon avis, désigne l’absence de relations de domination, de suggestion et/ou de coordination entre plusieurs faits ou événements. Du point de vue microsociologique, l’indépendance renvoie au fait pour un individu de ne pas subir d’injonctions dans ses prises de décisions, dans la formulation et l’expression de ses opinions. Dans le cadre d’un pays ou d’une collectivité quelconque, l’indépendance se réfère à sa capacité à s’autodéterminer, principalement dans le domaine politique, et, par conséquent, d’entretenir des relations non asymétriques avec les autres, quelle que soit leur puissance.
Votre définition de la démocratie ?
La démocratie est pour moi un système de gestion de la cité où tous les citoyens, quels que soient leur rang et leur statut social, jouissent d’une reconnaissance et d’une dignité humaine ; un système où la solidarité est à l’œuvre – ceux qui ont suffisamment soutiennent ceux qui n’en ont pas – ; où les droits des citoyens sont respectés, mais où ces derniers n’ont pas que des droits, mais aussi des devoirs. Contrairement à ce que pensent certains, la démocratie n’est pas, à mes yeux, une affaire de « tout ou rien », elle est un processus, une construction perfectible. Elle n’est donc jamais une donnée objective et objectivable. Par ailleurs, elle n’est pas réductible aux questions d’alternance et autres débats politiques de l’heure.
Votre définition de la justice ?
J’identifie deux acceptions de la justice. La première est d’ordre philosophique. Elle renvoie à un principe moral de la vie en société, fondé sur l’exigence qu’a chacun de nous de respecter la vie et les droits des autres. Ces droits sont ceux que chaque individu a par le simple fait qu’il est un être humain. La deuxième acception, liée à la précédente, est d’ordre théorico-juridique. En ce sens, la justice est un ensemble de normes et de lois institutionnalisées et dont le but est de veiller au respect des droits des citoyens. Elle prend la forme de « surveiller et punir », pour parler comme Michel Foucault.
Si vous étiez ministre de l’Enseignement supérieur, quelles seraient vos deux premières mesures ?
Premièrement, je donnerais plus d’importance à la recherche, sans discrimination aucune entre ce qu’on appelle les disciplines prioritaires et les autres. Dans un pays comme le Burundi, historiquement ravagé par des violences dont l’affrontement entre Hutu et Tutsi constitue la traduction la plus dramatique, tous les efforts de transformation de la société sont vains, tant qu’on ne connaît pas l’état intérieur de ces traumatisés. Etant donné que l’homme est le véritable acteur du développement, il est impossible de le maîtriser sans la maîtrise de sa pensée. Cela implique des recherches, notamment en sciences sociales, un domaine, hélas, marginalisé. Ma deuxième mesure serait de diminuer l’importance de la pratique du syllabus dans nos universités. Le syllabus est pour moi un fléau, à la fois pour les enseignants et les étudiants. Alors qu’il tend à faire des premiers de simples fonctionnaires du public faisant du service minimum, il transforme les seconds en perroquets répétant des énoncés dont ils ignorent le sens et la quintessence.
Si vous étiez ministre des Sports, quelles seraient vos deux premières mesures ?
Une seule mesure : je ferais du sport, dans son ensemble, sans distinction, un secteur d’activité et d’émulation pouvant faire vivre ceux qui y sont engagés.
Croyez-vous à la bonté humaine ?
Oui. Certes, je suis conscient qu’en l’homme sommeille le bon et le mauvais, comme nous l’apprend la vie de tous les jours et comme nous l’indique d’ailleurs la philosophie classique, les travaux des rousseauistes et des hobbesiens sont éloquents à cet égard. Je sais aussi qu’en fonction des personnes et des circonstances, le démon de la méchanceté peut être plus puissant. Mais, de façon générale, dans nos différentes vies et à différentes époques, nous faisons l’expérience de la bonté humaine.
Pensez-vous à la mort ?
Oui, je pense à la mort ; je sais qu’elle rôde autour de moi, et je suis conscient qu’elle se rapproche de moi chaque jour qui passe. Mais je n’y perds pas trop de temps, parce que, de toutes les façons, je ne peux rien contre, je ne peux lui opposer aucun argument ; elle est la seule réalité objective qui ne souffre d’aucun doute et dont nous sommes tous sûrs et certains. Quand le moment arrive, la salope et faucheuse frappe et ne rate jamais sa cible.
Si vous comparaissiez devant Dieu, que lui diriez-vous ?
Je lui dirais, les yeux dans les yeux, que j’ai essayé de faire ce que je pouvais pour suivre ses deux principaux commandements. Je lui demanderais, dans son jugement, de ne pas mettre la barre très haute, parce que, simple humain, j’étais.
Propos recueillis par Egide Nikiza






 Désiré Manirakiza, professeur associé et enseignant dans différentes universités, dont l’Université du Burundi et l’Université catholique d’Afrique centrale, est né le 24 mai 1978 sur la colline de Rutoke de la commune et province Gitega.
Après ses études secondaires au Lycée Gitega et son Service militaire obligatoire, il s’envole au Cameroun où il s’inscrit à l’Université de Yaoundé I. Il y obtient une licence en sociologie en 2005, une maîtrise en 2007 et un DEA (Diplôme d’études approfondies) en 2009 dans la même filière.
Parallèlement, à partir de 2006, il s’inscrit à l’Université de Yaoundé II-SOA où il poursuit des études en Sciences politiques. En 2007, il obtient une maîtrise de droit, option science politique et en 2009, il décroche un DEA en Sciences politiques.
En 2010, il est lauréat de la bourse de mobilité de l’AUF (Agence universitaire de la francophonie) qui lui permet d’aller en France pour poursuivre ses études doctorales. Il s’inscrit à l’Université de Franche-Comté où il soutient, en septembre 2013 son doctorat en Sociologie. La même année, il est recruté comme enseignant permanent à l’Université catholique d’Afrique centrale. En 2015-2016, il s’en va, après avoir obtenu une bourse d’excellence de la confédération suisse, poursuivre ses recherches postdoctorales à l’Université de Neuchâtel.
Désiré Manirakiza est impliqué dans des espaces de recherche aussi bien locaux qu’internationaux. Il est actuellement coordonnateur local du R4D (The Swiss Programme for Research on Global Issues for Development), un projet de recherche impliquant quatre institutions universitaires (Université catholique d’Afrique centrale du Cameroun, Université Gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal, Institut de hautes études internationales et du développement de Genève en Suisse et la Haute école spécialisée de Suisse occidentale-Lausanne) et dont le but est de montrer en quoi le football féminin est un enjeu de citoyenneté des filles et des femmes. Il a, à son compte, un nombre de publications dont les plus récentes portant sur le Burundi sont : «Du « Mess des officiers » à « Haleluya Fc » : politiques du corps, pratique sportive et inflexion de l’héritage nationaliste au Burundi », Politique africaine, n° 147, 2017 ; « Société civile et socialisation démocratique au Burundi. Retour sur une complicité ambigüe», Swiss Journal of Sociologie, vol. 44, n° 1, 2018.
Désiré Manirakiza, professeur associé et enseignant dans différentes universités, dont l’Université du Burundi et l’Université catholique d’Afrique centrale, est né le 24 mai 1978 sur la colline de Rutoke de la commune et province Gitega.
Après ses études secondaires au Lycée Gitega et son Service militaire obligatoire, il s’envole au Cameroun où il s’inscrit à l’Université de Yaoundé I. Il y obtient une licence en sociologie en 2005, une maîtrise en 2007 et un DEA (Diplôme d’études approfondies) en 2009 dans la même filière.
Parallèlement, à partir de 2006, il s’inscrit à l’Université de Yaoundé II-SOA où il poursuit des études en Sciences politiques. En 2007, il obtient une maîtrise de droit, option science politique et en 2009, il décroche un DEA en Sciences politiques.
En 2010, il est lauréat de la bourse de mobilité de l’AUF (Agence universitaire de la francophonie) qui lui permet d’aller en France pour poursuivre ses études doctorales. Il s’inscrit à l’Université de Franche-Comté où il soutient, en septembre 2013 son doctorat en Sociologie. La même année, il est recruté comme enseignant permanent à l’Université catholique d’Afrique centrale. En 2015-2016, il s’en va, après avoir obtenu une bourse d’excellence de la confédération suisse, poursuivre ses recherches postdoctorales à l’Université de Neuchâtel.
Désiré Manirakiza est impliqué dans des espaces de recherche aussi bien locaux qu’internationaux. Il est actuellement coordonnateur local du R4D (The Swiss Programme for Research on Global Issues for Development), un projet de recherche impliquant quatre institutions universitaires (Université catholique d’Afrique centrale du Cameroun, Université Gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal, Institut de hautes études internationales et du développement de Genève en Suisse et la Haute école spécialisée de Suisse occidentale-Lausanne) et dont le but est de montrer en quoi le football féminin est un enjeu de citoyenneté des filles et des femmes. Il a, à son compte, un nombre de publications dont les plus récentes portant sur le Burundi sont : «Du « Mess des officiers » à « Haleluya Fc » : politiques du corps, pratique sportive et inflexion de l’héritage nationaliste au Burundi », Politique africaine, n° 147, 2017 ; « Société civile et socialisation démocratique au Burundi. Retour sur une complicité ambigüe», Swiss Journal of Sociologie, vol. 44, n° 1, 2018.