Dans la commune Gihanga de la province de Bubanza, les défis qui hantent la vie des habitants sont multiples : routes impraticables, manque d’eau et d’électricité, pauvreté extrême, carence de formations sanitaires, manque d’engrais chimiques, pénurie du carburant, … Pour ces habitants, les futurs dirigeants devraient relever tous ces défis.
La commune à vélo est le nom qui a été attribué à la commune Gihanga, l’une des communes de la province de Bubanza. Commune à vélo parce que le vélo occupe une place de choix dans la vie quotidienne de ses habitants.
De la localité de Randa au centre Gihanga, la route est quasi impraticable. Des flaques d’eau cachent de nombreux nids-de-poule et provoquent souvent des accidents chez les conducteurs qui ne font pas attention.
De la RN5 (Route nationale N°5 Bujumbura-Cibitoke) au centre Gihanga, le scénario est le même. Les chauffeurs de camions doivent faire attention et rouler à moins de 10km/h. Sinon, les risques de s’affaisser dans ces flaques d’eau sont très grands.
En bas du bâtiment qui abrite les bureaux de la commune, se trouve un parking de vélos. La localité donne l’impression que tous les habitants savent faire du vélo. Tantôt un enfant transportant un bidon de plus de dix litres par-là, tantôt une jeune fille avec sa mère par-ci.
Jean Irampa, qui fait du taxi-vélo, observe le mouvement de la population et le passage des voitures en attendant un client potentiel. Il a l’air fatigué et s’exprime avec beaucoup de gènes. « Ces temps-ci, on n’a pas le droit de tout dire. »
Par après, il se lâche, mais avec des réserves. « Le jour des élections, j’irai voter comme les autres. Je me suis aussi fait enrôler comme les autres. J’aimerais voter pour un candidat qui saura baisser les prix des produits de première nécessité », dit-il avant de se taire. Il a apparemment trop dit.
Des promesses en l’air
Sur le même parking des vélos, à côté de Jean, un autre taxi-vélo, qui écoutait son ami de loin, tout en refusant de donner son nom, fait savoir que la route de Gihanga est dans un état lamentable malgré les promesses de la réparer.
« On nous a à maintes reprises promis de rendre praticable cette route qui passe devant les bureaux de la commune. Mais, regarde son état ! Les gens que nous voulons dans les organes de prise de décision sont ceux qui savent tenir la parole donnée », s’indigne-t-il.
Il fait savoir que la cohabitation politique est bonne, mais qu’il n’a pas le droit de tout dire : « Il faut parfois savoir tenir sa langue. » Les autres taxi-vélos l’observent du coin de l’œil.
La grande majorité des jeunes refusent de s’exprimer par rapport au rôle des futurs dirigeants qui sortiront des élections. Ils préfèrent parler de la pauvreté, de la pénurie d’eau et surtout des prix qui ne cessent de monter.
Le chauffeur de taxi-vélo Jean affirme avec beaucoup de regret que ses moyens ne lui permettent plus d’acheter une bière de la Brarudi. « Que nos dirigeants, vraiment, fassent un effort parce que je n’arrive plus à avoir la Primus ! Maintenant, je la regarde de loin. »
Les défis à relever sont multiples
Pour les futures élections, les habitants de la commune Gihanga, expriment à l’unanimité l’envie d’avoir des dirigeants capables de changer les choses comme la non-disponibilité du carburant.
Un autre chauffeur de taxi-vélo déplore le manque de carburant, une chose très courante dans sa commune. « Un camion qui ramène des vivres de Makamba durant cette pénurie doit les vendre à un prix de manière à ce qu’il récupère le montant dépensé pour le carburant. Une bouteille d’1 l de mazout s’achète ici à 25 000 BIF. Du coup, avoir assez de mazout pour venir de Makamba n’est pas chose facile. Les denrées alimentaires sont très chères. Pour moi, la vie est très dure. »
Les habitants de Gihanga craignent que les dirigeants qu’ils ont élus risquent de revenir se présenter à nouveau. « Vu la situation actuelle, nous risquons de ne pas avoir le choix et de leur donner des voix. »
Le plus étonnant pour la population de Gihanga, ce sont les promesses que les politiciens font aux habitants. « On ne voit jamais rien de tout ce qu’ils promettent. Cela nous donne l’impression d’un envoûtement à voir comment ils nous font courir dans tous les sens pendant la campagne pour nous oublier après. Tout cela me dépasse. »
Le développement des jeunes, un espoir lointain
Ces utilisateurs de taxi-vélo font savoir que leur auto-développement est très difficile, à cause, des prix élevés des produits de première nécessité. L’un d’entre eux fait savoir que depuis que les prix ont commencé à monter, il n’arrive plus à avoir de quoi épargner.
Le prénommé Eric, la vingtaine, n’arrive pas à projeter son avenir avec les défis auxquels il doit faire face tous les jours. « A mes débuts avec mon vélo, je pensais qu’ en un rien de temps, je me ferais facilement une moto. Mais maintenant, je peine à nourrir ma famille. Dire que je pourrais économiser est quasi impossible. »
L’envie de faire partie des organes de prise de décision dans un parti politique ne lui a jamais traversé l’esprit parce que si cela pouvait être le cas, il fait savoir qu’il risquerait de faire comme les autres : nourrir sa famille et se taire. « Qui daigne venir s’occuper de nous ? Ils occupent leurs bureaux et après le bureau, ils rentrent voir leurs familles et c’est fini. Nos cris ne servent à rien. »
Il fait savoir que l’enrôlement est un devoir dont il s’est acquitté et qu’il fera de même avec les élections, mais en tant qu’électeur et non en tant que candidat. « D’ailleurs, je ne vois pas ce que je ferai si je suis devant le peuple. Tout me semble compliqué parce qu’il y a beaucoup de problèmes difficiles à résoudre. Qu’est-ce que je dirai au peuple s’il vient me demander du carburant par exemple ? »
Il plaint d’ailleurs ceux qui sont aux commandes dans ces moments de pénurie et de cherté de la vie : « Tout le monde leur réclame ce qui ne se trouve pas à leur portée. Cela est frustrant à la longue. » Avec un sourire, il avoue qu’il succomberait à une crise cardiaque.
Il avoue qu’avec la vie qu’il mène, il préfère ne plus y penser. « D’ailleurs, si je ne le fais pas, les autres qui voient plus loin que moi le feront. »
Evariste Mbonyingingo, représentant du parti Sahwanya-Frodebu en commune Gihanga, indique que les habitants de cette commune sont disposés à participer dans les prochaines élections même s’ils ne se sont pas fait enrôler d’une manière satisfaisante. « Je pense qu’ils étaient réticents à se faire enrôler à cause des mauvais traitements qu’ils subissent ainsi que la pauvreté dans laquelle ils vivent. »
Evariste Mbonyingingo fait savoir que la Coalition « Burundi Bwa Bose » a été exclue dans l’élection des conseillers communaux. « Nos listes pour les conseillers communaux dans la commune élargie de Mpanda ont été rejetées. Actuellement, on se concentre sur l’élection des députés. »
Concernant la cohabitation politique sur les collines entre les militants des différentes formations politiques, Mbonyingingo indique que c’est l’accalmie pour le moment. « Avant la création de la Coalition Burundi Bwa Bose, des permanences du parti Sahwanya-Frodebu ont été démolies dans la commune Mpanda. Nous avons porté plainte, mais notre plainte a été ignorée. »
Malgré que la liste des conseilleurs communaux ait été rejetée dans la nouvelle commune Mpanda, Mbonyingingo affirme que la Coalition avait essayé d’inclure plus de femmes. « Nous avions aligné vingt femmes. Les femmes leaders s’impliquent beaucoup dans ce processus contrairement aux autres femmes. Ces dernières sont réticentes et déclarent qu’elles ne vont pas voter. Nous continuons la sensibilisation en leur disant que c’est leur droit. »
M. Mbonyingingo fait savoir qu’en cas de victoire en commune Mpanda, la Coalition va beaucoup mettre l’accent sur les projets de développement. « Les habitants de Gihanga ont besoin des routes praticables, de l’électricité, de l’eau potable, … Les besoins sont immenses. »
Il exhorte les militants des partis politiques de respecter les idées des uns et des autres. « Si les prochaines élections sont crédibles et transparentes, nous allons accepter les résultats des urnes. »
Contactés, les responsables du parti CNDD-FDD dans la commune Mpanda n’ont pas voulu s’exprimer. « Celle qui est habilitée à communiquer sur les activités de notre parti est la Secrétaire nationale chargée de l’information et de la communication. »
Une jeunesse désespérée, mais prête à retrousser les manches
Sur la colline Gihanga, en commune Bubanza, Onesphore Ciza, père de famille, n’a pas l’habitude de longues phrases. Mais ce jour-là, il laisse éclater sa lassitude. « Nous voulons que les nouveaux élus nous réhabilitent la route pour la bonne circulation des biens et des personnes. Qu’ils nous trouvent de l’eau potable ! » Il s’arrête un instant, regarde autour de lui et ajoute : « On parle d’élections. Mais, chez nous, c’est encore la galère pour aller d’un endroit à un autre sans risquer sa vie. »

En commune Gihanga, la situation n’est guère meilleure. A Gihanga-centre, Janvier Ngendakumana montre du doigt les trous béants de la route : « Tu quittes la maison propre, bien habillé, et tu arrives sale. Ce n’est pas une figure de style. C’est réel, on souffle durant la période sèche depuis le mois de mai. Certes, on n’aime pas la saison sèche, mais à cause de cette mauvaise route, c’est devenu un calvaire. »
Pour lui, les autorités doivent enfin traiter la voirie comme une priorité : « Il faut arranger ces routes avant de nous demander nos voix. »
Mais, ce qui fait souffrir le plus les habitants, c’est l’absence d’eau potable. Toujours selon Janvier Ngendakumana, « cela fait des mois qu’on n’a plus vu une seule goutte d’eau dans nos robinets. Les gens vont jusqu’à Dorsal pour en trouver. C’est loin, fatigant et dangereux parfois. On peut y passer plusieurs heures. Ce qui constitue une perte en temps. »
Une jeunesse lucide et sans illusions
Parmi ceux qui subissent le plus les effets du chômage et du sous-développement, il y a les jeunes. À Gihanga-centre, Aimé Bigirimana, la vingtaine, rêve d’un avenir meilleur. « J’aimerais bien créer une coopérative avec d’autres jeunes. On a l’énergie, des idées. Mais il nous manque le capital. » Il soupire avant de continuer. « Si les nouveaux élus veulent vraiment nous aider, qu’ils mettent des moyens à notre disposition. On ne veut pas des discours, on veut des solutions. »
Olivier Mpawenimana, jeune habitant de la même commune, hausse les épaules. Il connaît par cœur la route Tepe–Gihanga-centre, en très mauvais état. « C’est un calvaire. Elle est quasi impraticable. Même les motos et les voitures évitent ce chemin. Et pourtant, c’est un axe essentiel. » Lui aussi appelle à des projets concrets, au-delà des promesses. « Il faut penser aux jeunes, à leur donner accès à des financements, à des emplois. »
De son côté, Isaïe Nshimirimana, taxi-vélo depuis sept ans, décrit son quotidien comme un parcours d’un combattant. Le tronçon appelé “terre 5” est devenu un vrai casse-tête : « C’est plein de nids-de-poule. Quand il pleut, c’est la catastrophe. On doit parfois descendre du vélo avec les clients. Ce n’est pas professionnel, mais on n’a pas le choix. »
Santé, carburant, engrais : le désespoir silencieux
Dans la même commune Gihanga, Albert Hategekimana est un jeune qui a terminé ses études et tient un petit salon de coiffure pour subvenir à ses besoins. Il est loin d’être indifférent par rapport à ce qui se passe autour de lui. « Ici, il n’y a même pas d’hôpital public. Juste un centre de santé privé, géré par des sœurs. Les soins sont entièrement à la charge du patient (100%). Le seul hôpital le plus proche est à Gihungwe. Hélas, ils n’ont pas de la radiographie. Même pour une simple radiographie, il faut aller jusqu’en mairie de Bujumbura. Vous imaginez, le temps, le coût avec cette pénurie de carburant où les frais de déplacement ont triplé. C’est un problème sérieux. »
Il trouve qu’il s’agit d’une injustice flagrante. Il demande à la prochaine administration de mettre en avant cette préoccupation, car la santé, c’est la vie.
Un jeune homme, qui a requis l’anonymat, prend le relais dans un murmure. Il ne croit plus aux belles paroles. « C’est toujours la même chanson à chaque période des élections. Ils viennent, ils parlent, ils partent. Et nous, on reste là, on passe aux oubliettes jusqu’à une nouvelle échéance électorale. » Il pointe aussi du doigt la flambée des prix des fertilisants. « Un sac de Fomi coûte jusqu’à 250 000 FBu alors qu’il devrait être à 66 000. C’est le prix officiel. Mais, sur le terrain, c’est une autre réalité. Ça devient préjudiciable pour nous. Le prix est hors norme. »
Arthémon Nizigiyimana, agriculteur de riz, enchaîne : « Les engrais sont trop chers. Les gens cultivent à perte. Et puis, il y a le carburant. Pour aller vendre, c’est la croix et la bannière. » Il regarde au loin, vers ses rizières desséchées, comme s’il cherchait une réponse dans l’horizon.
Jean-Bosco Mateso, un père de famille, a une autre préoccupation : les prix des boissons de la Brarudi. « Une Fanta à 2 000 Fbu, une Primus à 5 000. C’est devenu un luxe. Même boire entre amis est devenu difficile. Pourquoi l’État ne fait rien pour réguler ces prix ? », s’est-il questionné.
Un climat de paix à préserver
Malgré toutes ces difficultés, les habitants de Gihanga soulignent un climat politique plutôt calme. Janvier Ngendakumana l’exprime avec une certaine fierté. « Vraiment, le voisinage est très bon. Même entre les gens de partis différents, il y a une bonne entente. » Il espère que cette paix ne sera pas perturbée par les tensions électorales et cette campagne qui va commencer très prochainement.
Tharcisse Ndayishimiye, 28 ans, se veut vigilant. Il a déjà connu plusieurs scrutins. Pour lui, la responsabilité incombe aux politiciens. « Qu’ils évitent les discours qui divisent ! On vit bien ensemble ici. Que ça reste ainsi ! »
Dans la commune Gihanga, les citoyens n’attendent plus des promesses, mais des actions concrètes. Routes, eau, hôpitaux, emplois et fertilisants : les besoins sont clairs, les messages aussi. Reste à savoir si, cette fois, leurs voix seront entendues au-delà des urnes. Car plus que des électeurs, ce sont des citoyens qui réclament leur dignité.
Les femmes de Gihanga demandent la paix, la sécurité et le développement de la commune

Laurette Kanyange, la trentaine, agente de transfert et retrait d’argent (Lumicash), explique qu’elle n’a pas le temps de participer aux réunions organisées par les partis politiques ni à d’autres activités connexes.
« Je travaille du matin au soir pour nourrir mes enfants. Normalement, je rentre à la maison à 20h, mais je fais une petite pause à midi pour allaiter mon bébé. En ce qui concerne l’appartenance politique, je ne suis membre d’aucun parti. Je n’ai pas le temps d’assister aux réunions et autres engagements. La politique ne m’intéresse pas », confie-t-elle, assise sur un tabouret près de la route, balayant les environs du regard afin de ne pas laisser échapper un client en quête d’unités. A propos des élections, elle précise qu’elle s’est inscrite et qu’elle attend le jour du vote pour choisir un candidat.
« Comme j’écoute rarement les projets présentés pendant les campagnes électorales, je vote un peu au hasard », déclare-t-elle avec indifférence, avant d’ajouter, en souriant, qu’elle soutient en général le parti au pouvoir. Tant que celui-ci garantit la paix et la sécurité, elle se dit satisfaite. « Je ne suis qu’une simple citoyenne. Je n’ai aucun intérêt à me battre pour des postes politiques. Ce qui compte pour moi, c’est pouvoir travailler en paix. Je veux me réveiller chaque matin, gagner le pain de ma famille et rentrer chez moi en sécurité. »
Elle confie avec amertume ne plus avoir de doléances. Malgré ses études en comptabilité générale, elle n’espère pas trouver de l’emploi.
« D’autres jeunes se sont affiliés à des partis politiques dans l’espoir d’obtenir un emploi ou, à défaut, un poste politique. Ce n’est pas mon cas. Moi, j’attends de voir ce que les élus auront à offrir durant leur mandat. »
Une autre jeune femme, habitante de la même commune, souhaite que Gihanga se développe davantage. « Lorsqu’il pleut, presque toute la commune est inondée. Les routes deviennent impraticables. Nous supplions les futurs candidats de réhabiliter ces infrastructures », implore-t-elle. Elle réclame également un retour à la disponibilité abondante du carburant, comme auparavant.
Selon elle, le manque de carburant impacte non seulement la vie économique, mais aussi la vie sociale. « Je viens de passer deux ans sans rendre visite à ma famille qui vit à l’intérieur du pays, car je ne peux pas supporter les coûts des tickets. Aux futurs candidats, s’il vous plaît, garantissez-nous le carburant. Que ces élections législatives, communales et sénatoriales marquent l’entrée dans une nouvelle ère », lance-t-elle.
Elle insiste aussi sur l’importance de la sécurité civile. Elle raconte que récemment, les citoyens de Gihanga craignaient une guerre imminente en raison du conflit à l’Est de la RDC. « Aujourd’hui, nous sommes apaisés. Nous espérons que cette guerre ne nous atteindra pas et qu’elle prendra bientôt fin. Les futurs candidats doivent nous garantir la paix. »
La flambée des prix, un casse-tête
« Je souhaite simplement qu’il y ait assez de carburant. Le commerce ne fonctionne plus », affirme une commerçante, assise devant une table d’environ un mètre de long. Sur la table, elle vend des arachides et des bananes. Selon elle, les clients n’achètent plus ses bananes dont le prix est passé de 100 à 500 FBu l’unité au cours des trois dernières années. « Il n’y a pas que mes bananes. Toutes les denrées alimentaires ont vu leurs prix flamber. Aujourd’hui, un kilo de riz coûte 5 200 FBu. Le citoyen lambda ne peut plus se permettre d’en manger. Un kilo de haricot varie entre 3 500 et 4 000 FBu. Nos enfants risquent de souffrir de malnutrition. Les futurs candidats doivent assurer la stabilité des prix. C’est inquiétant. »
Violette Kamariza, également résidente de Gihanga, aimerait que les futurs candidats développent des projets sanitaires, notamment la construction d’au moins un hôpital dans sa localité. Blessée à la cheville droite, elle souhaitait se rendre à Bujumbura, capitale économique, pour se faire soigner. « Ma cheville est enflée depuis plus d’un mois. Pour faire une radiographie, je dois aller à Bujumbura dans l’un des établissements sanitaires. Ici, cet examen n’est pas disponible », déplore-t-elle.
Elle peine aussi à se déplacer à cause des frais de transport qui ont triplé. Elle aussi plaide pour la disponibilité du carburant qu’elle considère comme essentielle pour relancer les activités économiques du pays. Elle revient également sur l’état des routes à Gihanga.
« On dirait qu’on nous a complètement oubliés. Les véhicules de transport se font rares. Les chauffeurs n’osent plus emprunter nos routes. Ils redoutent les profonds nids-de-poule sur le trajet vers Bujumbura. Une partie de la route est non goudronnée. C’est lamentable », se désole-t-elle.
Elle explique que les habitants sont contraints de se déplacer à moto, parfois jusqu’à quatre passagers plus le motard. « C’est la réalité, car personne ne peut se permettre de payer une moto pour un long trajet. Les motards nous disent qu’ils s’approvisionnent en carburant sur le marché parallèle, d’où la cherté des trajets. Peu importe la distance, même la plus courte, un motard n’accepte plus une somme inférieure à 1 500 FBu. »
Elle se dit convaincue que pendant les campagnes électorales, certains projets incluront la construction de routes pour les inciter à voter. Elle prie ces candidats de tenir leurs promesses. Elle précise ne pas avoir de préférence politique et affirme qu’elle votera selon les projets proposés par les candidats.
« En se référant aux listes électorales, le niveau de participation des jeunes et des femmes dans les organes de prise de décision reste inférieur. On l’estime à environ 40 % », indique Clémence Ndayahundwa, une leader communautaire de la commune Gihanga. Elle souligne que les jeunes affiliés à différents partis politiques parviennent à cohabiter en paix.
Aux futurs élus lors des prochaines élections législatives, elle demande de préserver la paix et d’encourager la cohésion sociale, condition essentielle au développement de la commune. Et de demander aux partis politiques de rester pacifiques au cours de ces échéances électorales. « Cependant, les femmes et les jeunes devraient être davantage représentés dans les instances de prise de décision à l’avenir. »
Interview avec Christophe Bigirimana
« Les habitants doivent rester sereins et vigilants au niveau sécuritaire. »
Quelle est la situation qui prévaut dans la commune Gihanga à l’approche des élections ?
Contrairement à ce que nous observions dans les années antérieures, la situation est relativement normale. La population vaque à ses occupations quotidiennes sans aucun problème.

Et quel est le comportement des jeunes affiliés aux partis politiques ?
Les autorités de la commune se sont données corps et âme au niveau de la sensibilisation avent l’approche de cette période préélectorale. Nous avons organisé beaucoup de réunions dans les collines qui composent notre commune.
Nous avons expliqué à la population, plus particulièrement aux jeunes, que les élections sont des activités comme tant d’autres. Donc, les gens doivent se donner beaucoup plus aux travaux de développement.
Un appel au calme leur a été lancé. Surtout ils doivent rester sereins et vigilants au niveau sécuritaire.
Quel est leur niveau d’implication dans les élections ?
Cette implication s’est traduite par l’enrôlement qui a été un succès. Tout le monde a répondu présent. Durant la période d’affichage des listes, nous avons observé un grand mouvement de jeunes et de femmes qui vérifiaient si bel et bien leurs noms ont été bien transcrits. En tout cas, la participation a été un grand succès.
Quelles sont leurs principales préoccupations selon vous ?
Ce sont les moyens de pouvoir organiser des travaux de développement. Ça se remarque surtout au niveau du capital. Ce qui est leur source principale de lamentation. Ils sont en manque criant de moyens pour pouvoir se lancer dans les travaux de développement et dans les activités génératrices de revenu. Ils demandent que la Banque d’investissement des jeunes et celle d’investissement des femmes soient plus proches et qu’elles soient renforcées pour pouvoir donner beaucoup de capitaux et de crédits.
Le code électoral, est-il déjà à leur portée ?
Il y a eu des sensibilisations là-dessus. La commission électorale communale indépendante a déjà effectué des descentes dans les communes. Elle a rencontré les jeunes à part, puis la population en général.
Avez-vous des recommandations ?
J’appelle tout d’abord la population au calme, à rester sereine en évitant les accrochages. Elle doit savoir qu’avant les élections, pendant les élections et après les élections, la vie continue. Qu’elle se concentre surtout aux travaux de développement tout en sauvegardant la sécurité parce que sans elle, il ne peut pas y avoir d’élections.
Je crois d’ailleurs que les travaux de développement sont essentiels dans la mesure où ils nous aident à subvenir à nos besoins et ceux de nos familles. Et puis, les élections nous permettent d’élire nos dirigeants dans un cadre légal.
Malgré la divergence dans les programmes politiques, il ne faudrait pas que cela soit une source de conflit, mais plutôt qu’elle amène une pierre dans la construction du pays.
Quel est l’état sécuritaire ?
La sécurité est relativement bonne parce que les groupes rebelles qui se disaient existants dans la Rukoko n’y sont plus depuis un bon bout de temps.
D’ailleurs, j’appelle la population à rester tout de même toujours vigilante malgré cette quiétude.
Réactions
Faustin Ndikumana : « Les projets de société qui pourraient intéresser les Burundais actuellement est la réforme de la gouvernance. »
Le directeur national de Parcem affirme que le processus électoral en cours est marqué par cinq éléments principaux. D’abord, le peu d’engouement de la population par rapport à ce processus. Il explique cela par la réticence que les citoyens ont affiché au moment de l’enrôlement. Et fait savoir que le gouvernement a même imposé à l’administration de faire des menaces pour les personnes qui ne voudraient pas se faire inscrire : « Il y a eu même une obligation, une intimidation pour que les gens puissent aller se faire inscrire. »

Pour lui, le peu d’engouement avait pour raison les conditions de vie actuelles qui préoccupent beaucoup plus les citoyens.
Il explique que le processus électoral est marqué par le comportement du parti au pouvoir qui a été maintes fois épinglé : « Parce que le parti au pouvoir a été accusé de vouloir faire cavalier seul depuis la mise sur pied de la loi électorale, et le vote de la loi électorale, le processus de mise en place de la Commission électorale nationale indépendante. Donc il n’y a pas eu de dialogue pour la mise en place de la CENI, et aussi dans l’élaboration du processus de la loi électorale. »
Pour Faustin Ndikumana, faire voter la loi électorale est chose simple dans le Parlement qu’il qualifie de monocolore. Un autre élément qu’il soulève est les conditions économiques qu’il trouve difficiles : « La crise du carburant pourra même limiter l’arrivée de certains candidats sur le terrain parce que vous savez, les partis d’opposition ont toujours dénoncé le fait que le parti au pouvoir pourra peut-être avoir des conditions favorables, mais que les autres partis risquent de ne pas avoir des moyens de locomotion pour accéder à leurs militants. »
Un autre élément qu’il souligne est l’élimination de certains candidats de poigne : « L’opposition a été laminée par le fait que le principal parti d’opposition a été malmené, où on a impliqué l’administration qui s’est immiscée dans la gestion de son parti, avec des accusations provenant de partout. »
Il fait aussi savoir qu’il y a eu l’élimination de certains candidats qui marquaient l’opposition : « Certains disent que ces élections pourraient ne pas avoir d’enjeux permettant aux gens de constater qu’il n’y a pas une compétition saine et digne de son nom. Ensuite, il y a la faible transparence au niveau de l’électorat, notamment au moment de la publication des résultats, parce que beaucoup disent que le fait que l’administration dit que c’est bien lui qui va procéder aux proclamations des résultats, ça montre qu’il pourrait y avoir des tricheries cachées. »
Il fait savoir que les gens craignent qu’il puisse y avoir des tricheries cachées : « Les médias semblent avoir été exclus du monitoring de publication des résultats progressifs. Donc, je crois que la CENI et l’administration seront responsables de la proclamation des résultats dans plusieurs contrées et régions du pays. On dit que les candidats n’arrivent pas dans leur destination, dans leur région, donc il pourrait y avoir des difficultés, parce que les candidats, même des fois, n’arrivent pas à leurs militants. »
La réforme dans le programme politique
Le directeur national de Parcem propose que les projets de société qui pourraient intéresser les Burundais actuellement est la réforme de la gouvernance : « Je crois que tout candidat qui peut se faire élire, tout parti politique qui veut se faire élire, devait savoir que le Burundi a besoin d’abord de cette réforme. Le Burundi a besoin d’un nouvel ordre de gouvernance. Donc que ce soit au niveau de la gouvernance politique, pour assurer une réconciliation durable, un dialogue pour recoller les morceaux et pour que tous ces projets puissent rentrer. »
Au niveau de la gouvernance administrative, il préconise une administration redevable qui fait actuellement une administration très politisée, qui ne fait pas vraiment son travail de façon équitable selon lui. Pour la gouvernance économique, la lutte contre la corruption est un élément très fondamental pour cet économiste.
« Il faut la promotion de l’environnement des affaires pour que les Burundais puissent bénéficier des investissements directs étrangers. La stratégie de mobilisation des financements à partir d’un partenariat fructueux à travers une bonne stratégie de mobilisation de la coopération parce que le Burundi ne peut pas vivre seul. »
Il suggère que pour faire face à ces problèmes, il faut récupérer et autoriser les produits de première nécessité et en faire une initiative de grâce économique : « Une initiative de grâce économique à partir d’un modèle. Même s’il y a l’avis de 2040-2060, ça c’est une orientation. Il faut des réformes concrètes au niveau macroéconomique et ensuite relancer l’économie à partir du développement du secteur privé visible. La construction des infrastructures pour permettre au secteur privé de décoller. »
Les questions liées au déficit de l’énergie et aux problèmes de transport, les infrastructures, sont vraiment en déficit selon Faustin.
Cet activiste trouve en effet que l’absence d’une opposition forte ce qui fait que, selon lui, les enjeux ne se manifestent pas dans ce processus électoral : « Vous savez que l’opposition n’est pas suffisamment forte comme il l’était auparavant. Je crois que les tensions entre les partis politiques risquent de ne pas se manifester de façon très criante. Mais plutôt la tension pourra surgir à partir d’une intimidation de l’administration pour que les gens puissent participer aux élections. »
Il craint néanmoins que les gens risquent de ne pas afficher un engouement pour participer aux élections. Pour lui, la tension pourrait venir de l’administration pour menacer les gens qui ne pourront pas se présenter aux élections : « Mais il faut savoir qu’au Burundi, les élections restent calmes. Les élections restent le point de départ pour la réforme fondamentale du système de gouvernance. Je pourrais dire que la participation aux élections reste fondamentale parce que si on veut toujours réformer les choses, il faut toujours participer aux élections », conclut-il.
Jean de Dieu Mutabazi : « Le changement d’élus doit se faire dans la paix et la stabilité du pays. »
Alors que le Burundi s’apprête à entrer en campagne électorale dans trois semaines, à cinq semaines des scrutins communaux et législatifs, l’effervescence électorale reste étonnamment discrète. Pour Jean de Dieu Mutabazi, président du parti Radebu, cette situation ne signifie pas un désintérêt pour le processus : « Le processus électoral est définitivement entré dans sa phase opérationnelle », affirme-t-il.
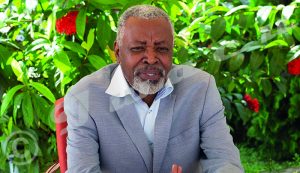
D’après lui, plusieurs raisons sont avancées pour expliquer cette « faible fièvre électorale ». Il indique que certains évoquent le manque de moyens financiers des partis politiques, d’autres la pénurie persistante de carburant. « Une autre hypothèse pointe un intérêt plus marqué de l’électorat pour les présidentielles prévues en 2027. »
Sur les 36 partis agréés, souligne-t-il, seuls 20 ont déposé des candidatures pour les législatives et communales. « L’enjeu de la dernière semaine de campagne s’annonce donc décisif pour ceux qui souhaitent accéder au prochain Parlement. » Selon Jean de Dieu Mutabazi, malgré le calme ambiant, l’opinion nationale attend des futurs élus les solutions à ses problèmes et préoccupations.
Sur le terrain politique, il juge le climat serein. « Globalement, les partis cohabitent pacifiquement sur les collines et dans les communes », assure-t-il, même si quelques cas isolés d’arrestations de militants ont été rapportés. Aucun parti, selon lui, ne peut cependant se dire persécuté à l’échelle nationale.
Concernant la représentation des jeunes et des femmes, M. Mutabazi se veut optimiste. Il affirme que « la majorité des postes de prise de décision est occupée par des jeunes », en se basant sur la moyenne d’âge dans les institutions étatiques. La présence des femmes, elle, atteint le quota constitutionnel de 30 % dans les instances parlementaires et gouvernementales. Il reconnaît toutefois des efforts à faire dans les postes techniques et administratifs, tout en appelant à privilégier le mérite.
Interrogé sur la constitution des listes électorales, Jean de Dieu Mutabazi évoque des critères combinant ancienneté, militantisme, niveau d’études et fonctions au sein du parti. « Des efforts de parité sont également visibles à travers diverses formules d’alternance homme/femme sur les listes, et certaines sont même dirigées par des femmes. »
Enfin, Jean de Dieu Mutabazi insiste sur l’importance de distinguer « projet de société » et « programme politique ». Il appelle les candidats à se baser sur les valeurs fondamentales du pays : indépendance, souveraineté, démocratie, justice sociale, tolérance et respect des droits humains. Il plaide pour des projets répondant concrètement aux défis majeurs comme la pauvreté, le manque d’eau potable, d’électricité, de carburant et d’intrants agricoles, tout en mettant en avant la nécessité de moderniser les secteurs productifs comme l’agriculture et les mines. Sans oublier le socle indispensable, selon lui, de tout développement : la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption.
Jean de Dieu Mutabazi appelle à une campagne pacifique et civilisée : « Le changement d’élus doit se faire dans la paix et dans la stabilité du pays ». En cas de litige, il en appelle au recours à la Cour constitutionnelle, et conclut en conseillant aux partis d’adopter un « langage zèbre, et non le langage chacal ».
Rencontre avec Emmanuel Nengo
« Les Batwa doivent se sentir Burundais comme tant d’autres Burundais. »
Quelle analyse faites-vous de ce processus électoral en cours ?
Je dirais personnellement que ce processus électoral me semble atypique par rapport aux autres processus que j’ai pu suivre depuis que j’ai commencé à suivre les processus électoraux.
Aujourd’hui, il me semble que durant ce processus, il n’y a pas vraiment beaucoup informations, il n’y a pas trop d’échanges ou de discussions au sein de la population par rapport à ces élections prévues en juin. Cela m’étonne, car auparavant, dans d’autres processus électoraux, dans trois mois ou quatre mois avant leur tenue, on pouvait écouter au sein de la société des échanges par rapport au processus électoral.

La raison que je peux fournir par rapport à cette question est peut-être personnelle. Je pense que ce processus est, d’une façon ou d’une autre, un peu différent par rapport aux autres. Car, dans les autres processus, souvent, on pouvait y trouver aussi l’élection présidentielle. Mais, pour le moment, il n’y aura pas d’élection présidentielle au mois de juin ou même pendant cette année.
Cela ne suscite peut-être pas plus d’engouement de la population, car le poste du président de la République est un poste clé pour le pays. Je pense que cela aussi peut être inclus parmi les raisons de cette situation qui me semble atypique par rapport aux autres processus.
Une autre raison ?
Une autre raison que je peux personnellement fournir est que la situation économique que traverse notre pays peut aussi contribuer à ce que les citoyens n’aient plus d’engouement à ce processus électoral.
Aujourd’hui, il y a le problème de carburant. Les denrées alimentaires sont très chères. A part ça, il y a d’autres problèmes qui existent au sein de la population. Cela provoque une résistance peut-être de la population à participer à ce processus comme elle le faisait avant. Vous vous souvenez du début de l’enrôlement des électeurs. Il y a eu un problème, car les gens n’allaient pas se faire enrôler. La raison était aussi ce problème économique. Ce dernier revient chaque fois, et même pendant la période préélectorale, pendant la période électorale. Peut-être qu’il va encore se répercuter sur la période post-électorale. Ça, c’est mon point de vue.
Trouvez-vous que la Communauté Batwa est représentée dans les partis politiques et surtout dans les instances de prise de décisions ?
J’y répondrai en disant qu’aujourd’hui, nous avons des Batwa qui sont dans des partis politiques. Mais, franchement, au niveau de leur présence dans les instances de prise de décision de ces partis politiques, je peux dire qu’il n’y a pas une présence des Batwa.
Simplement, ils sont dans d’autres instances de prise de décision. Là, je voudrais parler, par exemple, au niveau de l’exécutif, au niveau du législatif, sauf au niveau du judiciaire. Là, il n’y a pas vraiment de présence des représentants des Batwa.
Quels conseils pouvez-vous donner aux membres de la Communauté Batwa pour qu’ils se fassent élire lors des prochaines élections ?
Le conseil que nous avons toujours prodigué à l’endroit de la communauté Batwa, c’est d’abord de se sentir Burundais à part entière comme tant d’autres Burundais. Et puis de manifester l’estime de soi. Ça, c’est très important pour les communautés Batwa. Mais aussi, ils doivent lutter contre les barrières socio-culturelles qui, d’une façon ou d’une autre, les affectent. Là, je dirais que, par exemple, les autres communautés trouvent que les Batwa ne sont pas plus engagés dans la politique. Or, les Batwa sont présents lors de l’enrôlement des électeurs et pendant les élections.
Mais, quand il s’agit effectivement de se faire élire, c’est là où on trouve un défi. Comme je le disais, les Batwa devraient participer dans ce processus depuis l’inscription des électeurs, l’enregistrement des candidats, le démembrement de l’institution chargée des élections, la campagne électorale, le maintien de la paix, la sécurité de la nation même après les élections. Donc, les Batwa devraient y participer.
C’est pourquoi, jusqu’à maintenant, je les encourage d’abord à s’estimer, à se valoriser et puis à adhérer dans des partis politiques pour qu’ils commencent à apprendre la politique à travers ces partis politiques. Ça, c’est très important.
Selon vous, quels sont les projets prioritaires que les politiques doivent mettre en avant pour la communauté Batwa ?
Je peux recommander aux leaders politiques d’investir dans les Batwa aussi comme ils investissent dans d’autres groupes et dans d’autres composantes sociales du pays. De cette façon, les Batwa pourront avoir une ouverture pour s’engager dans la politique. Un autre projet prioritaire, c’est d’inclure les Batwa sur les listes électorales. C’est important, car une fois que les Batwa se retrouvent sur les listes électorales, ils peuvent se sentir impliqués dans la prise de décision de leurs partis politiques.
J’ajouterais que les leaders politiques devraient plaider pour la mise en place des textes législatifs et réglementaires plus inclusifs qui faciliteraient la participation effective et significative des Batwa dans les instances de décision. Je veux dire un cadre normatif contraignant et incitatif qui permettrait même aux partis politiques d’intégrer et de promouvoir la participation des Batwa au sein de leurs partis et au cas échéant dans les instances de prise de décision.
Quid des projets de société ?
Aucun projet de développement n’est efficace sans l’élément fondamental qu’est la terre. Raison pour laquelle les futurs dirigeants devraient mettre en œuvre les engagements du président de la République d’octroyer 1 ha à chaque ménage Batwa sans terres. Développer les activités génératrices de revenus à travers les groupements coopératifs ; appuyer l’éducation en faveur des Batwa, un élément moteur du développement ; renforcer l’appui au logement convenable qui est favorable pour la santé.
Souvent, la période électorale est jalonnée par des tensions entre les militants des partis politiques. Quels conseils pouvez-vous prodiguer aux Burundais ?
Le conseil que je peux lancer à l’endroit de tous les Burundais, c’est d’abord de savoir que le processus électoral est un des droits humains. Il y a d’autres droits qui sont nécessaires également comme les droits sociaux, économiques et culturels qui doivent continuer à être sauvegardés, car après les élections, la vie continue.
C’est pour cette raison que la création des tensions entre les militants n’apporte rien d’important. Plutôt, cela amène juste des crises au sein de la société burundaise. C’est pourquoi, comme je le disais, il est important que chaque Burundais s’investisse pour la paix et la sécurité dans notre pays.
Sans paix, il n’y aura pas de progrès ni vraiment pas de participation effective à la vie politique, économique et culturelle. C’est pourquoi les Burundais doivent comprendre que les élections constituent l’une des périodes où chaque citoyen doit s’exprimer.
Un citoyen qui a l’âge de voter doit s’exprimer et donner son consentement sur comment il peut être dirigé. Mais il doit comprendre qu’après cette période, la vie continue et la vie est composée par plusieurs droits. C’est important que les Batwa participent à ces prochaines élections. La sensibilisation a été faite.
Vous discutez souvent avec la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) ?
Les organisations des Batwa ont eu une rencontre avec les responsables de la Ceni. Elles ont pu exprimer leurs inquiétudes par rapport à leur représentation. La Ceni a pu fournir des informations et des réponses qui ont pu diminuer les inquiétudes des communautés Batwa.
Ce qui reste, c’est d’attendre le moment venu pour que nous puissions savoir si la Ceni a pu respecter les engagements qu’elle a promis à l’endroit des communautés et des associations Batwa.
L’une des inquiétudes était de savoir si la représentation des Batwa ne va pas être affectée par des influences extérieures au niveau de considérer les positions des représentants des Batwa.















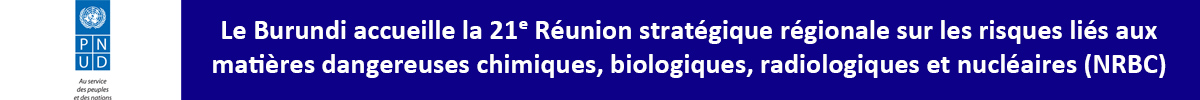


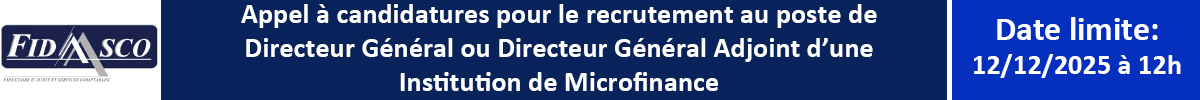






ewe abadd !! uburundi buzaterimbere ntangare!!!?