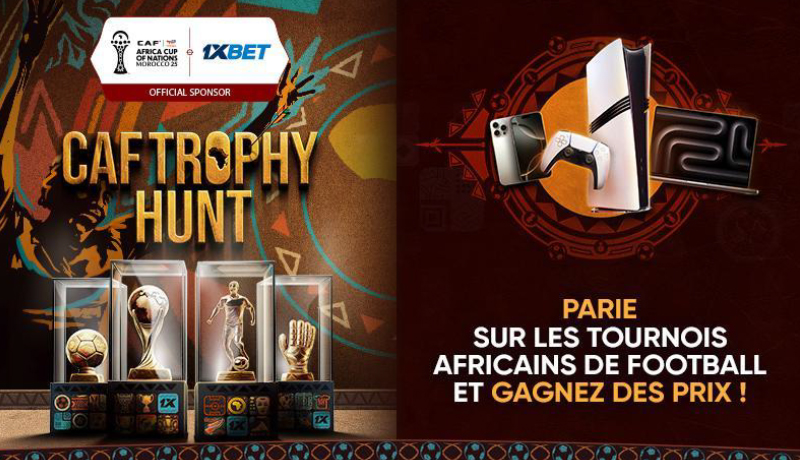La Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme (CNIDH) a franchi une étape cruciale dans son engagement à promouvoir et protéger les droits humains au Burundi. En collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme (HCDH) et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), la CNIDH a organisé un atelier de grande envergure pour renforcer les mécanismes communautaires de redevabilité et de protection.
Les participants points focaux étaient au nombre de 70 et en grande partie constitués par des rapatriés et des déplacés. Ils ont été soigneusement sélectionnés dans tout le pays dans le but d’affiner leurs compétences et d’amplifier leur leur suivi et l’impact des interventions sur le terrain. D’après les organisateurs, l’atelier du 23 au 24 septembre n’est pas un événement isolé puisqu’il s’inscrit dans une vision plus large de la CNIDH.
L’atelier renforce les capacités des Points Focaux de la CNIDH pour en faire « les yeux et les oreilles de la CNIDH sur terrain », mieux les sentinelles des droits humains au sein de leurs communautés. Pour le délégué de la CNIDH, l’objectif est clair : celui de construire une société où chaque citoyen, quelle que soit sa condition, est protégé et entendu.
Partant, la CNIDH met l’accent sur la redevabilité, un principe fondamental qui garantit la transparence des actions des institutions et des acteurs de la société civile et les responsables envers les populations qu’ils servent. La réponse se trouve dans les mécanismes communautaires, ces réseaux de solidarité et de communication qui tissent le lien social.
« Comme prévu dans sa mission, la CNIDH doit faire tout pour que les droits de l’homme ne soient pas de simples concepts, mais des réalités vécues au quotidien par les Burundais, en particulier les plus vulnérables », déclare le délégué de la CNIDH.
Du mandat à l’action : le rôle pivot de la CNIDH

La séance a débuté par une plongée dans les fondements du travail de la CNIDH, de son mandat et de ses missions. Loin d’être un simple exposé, la présentation a été l’occasion de réaffirmer la place unique de la Commission en tant qu’institution indépendante, jouant un rôle d’alerte, de promotion et de protection des droits humains. Les échanges ont mis en lumière le défi constant auquel fait face la CNIDH : naviguer entre sa mission de surveillance et son rôle de médiateur pour résoudre les conflits sans jamais compromettre son indépendance.
L’approfondissement du cadre international des droits de l’homme a été l’un des moments clés de l’atelier. Les participants ont été initiés aux principes de base du monitoring des droits humains, une compétence essentielle pour documenter de manière crédible les cas de violations.
Ils ont appris à distinguer les différents types de violations, à collecter des preuves et à structurer les rapports d’incidents, en tant que compétences cruciales pour leur travail sur le terrain et des instruments de redevabilité pour un Burundi plus juste.
« Nous voulons que toute personne soit respectée dans ses droits et devoirs, et vous êtes les mieux placés pour avoir subi un jour des violations dans vos droits » a souligné un des facilitateurs de la CNIDH.
Au cœur des communautés, l’espoir d’une protection renforcée
Les travaux de l’atelier ont accordé une attention particulière à la situation des personnes rapatriées, des personnes déplacées internes (PDI) et des apatrides, en vertu de la loi n°1/25 du 5 novembre 2021 portant réglementation des migrations au Burundi dont objet est la réglementation de l’immigration et l’émigration au Burundi et s’applique tant aux Burundais qu’aux étrangers, y compris les demandeurs d’asile, les réfugiés et les apatrides.
Ces groups de population, souvent invisibles et marginalisées sont au cœur des préoccupations de la CNIDH. Par conséquent, une session spécifique a été dédiée aux principes et cadres de protection de ces groupes, soulignant les défis spécifiques qu’ils rencontrent en matière de logement, de sécurité alimentaire et d’accès aux services de base.
« J’ai compris que la redevabilité n’est pas un concept abstrait et c’est cela que nous allons mettre en pratique », confie Emilienne Irakoze, le Point Focal de la province de Buhumuza d’une voix empreinte de conviction. « Nous avons la responsabilité de faire en sorte que la voix des vulnérables soit entendue. Nous sommes leur pont avec les autorités ! » Son témoignage met effectivement en lumière l’importance de l’engagement personnel dans un travail qui dépasse la simple profession.
Une dimension cruciale de la protection a été abordée avec la problématique de la « Redevabilité envers les Populations Affectées et la Prévention de l’Exploitation et des Abus Sexuels (PEAS) ». Ce module a mis l’accent sur l’éthique de l’aide humanitaire. Il souligne la nécessité de construire des relations de confiance et de prévenir toute forme d’abus, en particulier envers les femmes et les enfants qui sont souvent les plus exposés. « Il arrive que l’aide humanitaire soit à l’origine des abus. Soyez vigilants, ne vous fiez pas aux apparences pour que personne ne profite d’un vulnérable, sous prétexte de l’aider », a mis en garde Céline Nsabimana du HCR.
Les Points Focaux, au cœur de la redevabilité communautaire
En droits de l’homme, la redevabilité est l’obligation des personnes et institutions qui détiennent le pouvoir de rendre des comptes pour leurs actions et leurs politiques, en répondant de leurs actes devant les personnes touchées et en se soumettant à d’éventuelles sanctions en cas d’insuffisance. Cela implique l’obligation de rendre compte et la transparence dans les actions des débiteurs d’obligations.

La session sur le rôle des Points Focaux dans la redevabilité communautaire a été véritablement au cœur de l’atelier. Les participants ont échangé sur leurs propres expériences et identifié les obstacles et les leviers pour établir des mécanismes de redevabilité efficaces. « Vous n’êtes pas appelés à remplacer l’Etat mais à promouvoir et protéger les droits de l’homme en consultation avec les institutions de l’Etat », a rappelé aux Points Focaux Vera Mutoni de l’ONU Droits Humains. Selon elle, le rôle des PF ne se limite pas à rapporter les incidents, mais à établir des relations de confiance, à rassurer et impliquer les populations dans la recherche de solutions.
Les Nations Unies souscrivent à la conception que les droits de l’homme sont des normes qui consacrent et protègent la dignité de tous les êtres humains. Ils sont universels, inaliénables (insusceptibles de cession), et s’appliquent à chaque personne sans exception, notamment liée à la nationalité, au genre ou à d’autres caractéristiques. « Que cela soit votre Bible en tout et partout », souligne Véra Mutoni.
Un avenir de dignité et de respect
Au terme de l’atelier, une sensation de renouveau flottait dans l’air. Les 70 Points Focaux sont repartis avec un sentiment de mission renouvelée et des compétences renforcées. Ils constituent désormais un maillon essentiel dans la chaîne de protection des droits de l’homme au Burundi.
Selon les organisateurs, en investissant dans ces hommes et ces femmes de terrain, la CNIDH investit dans l’avenir du pays car en fin de compte, la protection des droits humains ne se mesure pas seulement par le nombre de rapports écrits ou de lois votées, mais par la dignité et la sécurité que chaque Burundais ressent au quotidien.
A Gitega, l’impact de l’atelier a été mesuré à travers les voix des participants. Une participante, issue d’une communauté de rapatriés de la province de Buhumuza affirme qu’elle sera la voix des sans voix. « Quand nous sommes rentrés, nous nous sommes sentis déracinés dans notre propre pays. L’accès à la terre, l’absence de papiers d’identité, la méfiance de certains voisins… tout cela était lourd à porter. L’idée que des personnes comme moi, issues de nos communautés, soient formées pour nous aider, ça change tout. C’est la preuve que nos souffrances sont reconnues et que nos droits seront défendus !»
Son message rappelle avec force la signification profonde de l’atelier et la promesse d’un avenir où personne ne sera plus laissé pour compte, comme exprimé par le slogan de la CNIDH : « Agateka kanje niko gateka kawe ! » (Ta dignité, c’est ma dignité !).
Quant au participant Pasteur Jean Bebeto Ntiyankundiye, il promet de ne ménager aucun effort pour la protection des droits humains envers tout le monde. Même son de cloche chez la participante Corine Mukantare qui souligne que la plupart des victimes souffrent en silence et manque de personnes de confiance avec qui parler de leurs mésaventures.
L’atelier est organisé dans le cadre du Programme conjoint des droits humains au Burundi (2024-2027), mis en œuvre à travers le Fonds fiduciaire multipartenaire (MPTF), et financé par l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas et le Bureau de la Coopération Suisse au Burundi.