Devant les députés, le ministre des Finances, du Budget et de l’Economie numérique a soutenu la réforme du programme de gratuité des soins pour les enfants de moins de cinq ans et les femmes qui accouchent jugé budgétivore. Certains intervenants parlent d’une volonté de supprimer un programme qui a révolutionné la santé de la population. Ils estiment qu’il est essentiel de mener un dialogue large et inclusif là-dessus.
Selon le ministre Alain Ndikumana, le programme de gratuité des soins est budgétivore. Il fait savoir qu’il manque de transparence et de cohérence et qu’il mérite une réforme pour minimiser les dépenses.
La déclaration a été faite le 29 octobre 2025 devant les députés lors de l’examen des rapports de performance et d’exécution budgétaire des 3e et 4e trimestres de l’exercice 2024-2025. Il a souligné qu’au 3e trimestre, avec une prévision de 1 499 231 279 293 BIF, les dépenses exécutées se sont élevées à 1 644 035 279 748 BIF, soit un taux d’exécution de 109,7 %.
Au 4e trimestre, avec une enveloppe prévisionnelle de 1 016 444 845 215 BIF, les dépenses réelles sont de 1 619 834 986 857 BIF, affichant ainsi un taux d’exécution de 159,4 %. Les exonérations se sont chiffrées à 58 314 110 376 BIF pour le 3e trimestre et à 66 380 410 792 BIF pour le 4e trimestre. Cumulées sur l’année, elles atteignent plus de 225,188 milliards BIF, soit un taux de 205,6 % par rapport aux prévisions initiales.
Les députés ont été inquiétés par ces dépassements budgétaires. Comme explication, le ministre Ndikumana a notamment pointé du doigt le coût élevé du programme de gratuité des soins. Selon lui, ce programme, bien que socialement louable, pèse lourdement sur le budget de l’État et manque de clarté dans son application. « Les factures que nous recevons des hôpitaux ne sont pas toujours justifiées et certaines femmes bénéficiaires ont les moyens de payer ».
« Que l’on assiste les plus démunis »
Le ministre Alain Ndikumana estime qu’il serait plus équitable de réserver la gratuité des soins aux familles réellement démunies afin de limiter les dépenses publiques injustifiées. Il a insisté sur la nécessité de revoir en profondeur le programme. Il considère que sa mise en œuvre manque de transparence et de cohérence.
M. Ndikumana tente une démonstration. « Je n’ai rien contre la gratuité des soins, mais je ne comprends pas pourquoi, en tant que ministre, ma femme devrait accoucher gratuitement, tout comme celle du chef de l’État ou d’autres femmes aisées. L’État devrait se concentrer sur les citoyens vulnérables. »
La déclaration intervient au moment où des hôpitaux et des formations sanitaires accusent le gouvernement de beaucoup d’arriérés de paiement des factures. Par conséquent, certaines structures sanitaires refusent même de fournir des services à ces catégories de patients.
Pour certains observateurs, à travers la déclaration du ministre Ndikumana, le gouvernement veut supprimer le programme. Instauré en 2006, après plus d’une décennie de guerre, il avait pourtant révolutionné la couverture sanitaire au Burundi.
Selon les données de la Banque mondiale, de l’OMS et du ministère de la Santé publique, les accouchements assistés dans les structures sanitaires sont passés de 34% en 2005 à 67% en 2012. Le taux de mortalité infantile est passé de 129 décès pour mille naissances en 2006 à 63,5 en 2024. Quant à la mortalité maternelle, elle est passée de 785 décès maternels en 2006 à 299 décès en 2023 pour 100 000 naissances.
Réactions
Gabriel Rufyiri: « Beaucoup de politiques en place permettent le détournement des fonds publics »
Le président de l’Olucome dit soutenir la proposition du ministre des Finances. « Cela fait plusieurs années que l’Olucome dénonce le vol organisé qui est opéré à travers les appuis pour les soins, des médicaments et aussi d’autres moyens qui sont donnés pour les enfants de moins de 5 ans et les mères qui accouchent. »

Il rappelle que cette politique est venue en 2006 après l’allègement partiel de la dette aux pays pauvres et très endettés dont le Burundi faisait partie par les institutions de Bretton Woods, en l’occurrence le FMI et la Banque mondiale. Parmi les conditions figure le soutien du secteur socio-économique. D’où le gouvernement a proposé, en accord avec les partenaires, de soutenir les groupes vulnérables dont les enfants de moins de 5 ans et les mères qui accouchent.
Un comité national avait été créé pour gérer les fonds en provenance des fonds de l’Initiative des pays pauvres et très endettés, IPPTE. C’était une somme qui oscillait autour de 2 000 milliards de BIF. Le comité comprenait le ministre des Finances et celui de la Bonne gouvernance, les représentants des partenaires techniques et financiers ainsi que la société civile représentée par l’Olucome.
M. Rufyiri parle de plusieurs irrégularités comme dans d’autres programmes du gouvernement. Il cite notamment la surfacturation et le paiement des factures pour des services qui n’auraient pas été consommés.
Il fait savoir que le programme n’a pas été bien étudié. Pour lui, le gouvernement ne peut pas prendre en charge le 4e, le 5e, le 6e, le 7e jusqu’au 13e enfant. « C’est une politique généreuse à soutenir mais à condition qu’il y ait une révision pour l’adapter au contexte et aux orientations politiques du pays. Il faut cibler en toute transparence les groupes vulnérables à soutenir. »
Gabriel Rufyiri indique que beaucoup de politiques mises en place permettent le détournement des fonds publics. Il appelle à la réforme de la politique du charroi zéro, la politique de plantation des plants fruitiers, la politique de réforme des secteurs café, minier, de l’administration. « Toutes les politiques qui ont été engagées doivent être revisitées et réformées à l’image de l’Office burundais des recettes, OBR. C’est à ce moment qu’on pourra espérer des retombées positives en ne mettant pas en avant les intérêts sectaires au détriment de l’intérêt général. »
Faustin Ndikumana: «Une réflexion profonde mérite d’être menée pour que le gouvernement ne soit pas asphyxié. »
Selon Faustin Ndikumana de Parcem, la mesure de gratuité des soins est salutaire même si elle a suscité beaucoup de controverses au fil des années. « Il y avait beaucoup d’aspects qui n’avaient pas été pris en compte, ou du moins n’avaient pas été considérés à travers une projection, une planification d’avenir bien ficelée. »

Il rappelle que cette mesure a été prise au lendemain de la mise en application de l’initiative qui concernait l’annulation des dettes des pays fragiles et post-conflit, comme le Burundi. C’était aussi dans le cadre de l’aboutissement des objectifs du Millénaire pour le développement qui consacraient une grande part des financements à la promotion de l’éducation et de la santé.
L’initiative PPTE avait comme exigence d’allouer les fonds, au départ destinés aux services de la dette, au secteur social pour l’amélioration des conditions de vie des catégories les plus vulnérables.
Il déclare que le gouvernement de l’époque a décrété la gratuité des soins de santé pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes qui accouchent pour se conformer à cette exigence. Le Burundi, dit-il, venait de sortir de la guerre. Le pays avait retrouvé la confiance des bailleurs et il y avait beaucoup d’appuis substantiels, y compris les appuis budgétaires. « Le Burundi avait beaucoup de marges d’aisance financière permettant de financer et d’obtenir des mesures, des subventions des services aussi importants comme les services sociaux dont la santé et l’éducation. »
D’après M. Ndikumana, tout bascule avec la crise de 2015. Comme conséquence directe, le gel des appuis directs des bailleurs de fonds, y compris les appuis budgétaires. Il fait savoir que même les appuis aux projets étaient accordés de façon parcimonieuse. Par conséquent, la marge de manœuvre du gouvernement s’en est trouvée réduite pour faire face aux besoins grandissants liés à cette mesure de gratuité de soins de santé. « Le gouvernement a recouru à un endettement intérieur excessif financé surtout par des avances de la Banque centrale. Ce qui avait des conséquences inflationnistes énormes. »
Il fait savoir qu’un autre problème majeur est la démographie galopante. Cette croissance incontrôlée avec un taux de fécondité estimé actuellement à 6 enfants par femme fait que ces subventions augmentent démesurément sans contrôle. « La population était, en 2005, à environ 8 millions d’habitants. Maintenant, on est à environ 13 millions. On pressentait que le gouvernement pouvait avoir des difficultés pour couvrir ces soins parce qu’au niveau de la planification, on n’en avait pas tenu compte. »
D’après M. Ndikumana, la situation est devenue de plus en plus préoccupante car il y a beaucoup de factures impayées aux hôpitaux et formations sanitaires. Cette situation paralyse la capacité des hôpitaux et formations sanitaires à faire face à leurs besoins, parce que le gouvernement ne parvient pas à payer à temps. « Certains hôpitaux ont même commencé à refuser de dispenser certains soins. Il n’y a pas de médicaments suffisants. La population a commencé à se lamenter par rapport à des services de santé de très mauvaise qualité. »
Il considère que cette politique ne distingue pas les familles vulnérables et aisées. Ce qui implique des fonds colossaux. « Une réflexion profonde par rapport à cette mesure mérite d’être menée pour que le gouvernement ne soit pas asphyxié. »
Pierre Nindereye : « L’assurance maladie obligatoire, une nécessité pour tous »

Selon Pierre Nindereye, représentant légal de l’Association burundaise pour la défense des droits des malades (ABDDM), les propos du ministre Ndikumana invitant à revoir la politique de gratuité des soins méritent une réflexion approfondie.
Il reconnaît que le programme mobilise d’importants moyens publics et que certaines familles disposent de ressources nécessaires pour payer les soins. Toutefois, il estime que tout citoyen burundais doit bénéficier d’un accès équitable à des soins de qualité.
Selon lui, la meilleure alternative serait la mise en place d’une couverture sanitaire universelle, à travers une assurance maladie obligatoire. Une telle mesure permettrait, d’après lui, de réduire les inégalités dans le secteur de la santé, les plus riches contribuant au profit des plus démunis.
Il soutient enfin que le gouvernement devrait adopter une loi instituant cette assurance qu’il considère comme la seule solution durable pour garantir l’équité et limiter les irrégularités observées dans le dispositif actuel.
Marie Bukuru : « Les conséquences d’une réforme mal préparée pourraient être graves »
Selon Marie Bukuru, présidente du Syndicat national des travailleurs de la santé (SNTS) et vice-présidente de la Fédération nationale des syndicats du secteur de la santé (FNSS), la gratuité des soins représente une contrainte. La population doit prendre le relais pour assurer la prise en charge par des organismes de santé.
 Elle rappelle que ce dispositif s’inscrit dans un objectif mondial, initialement appelé Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), aujourd’hui transformé en Objectifs de développement durable (ODD). Elle souligne que toutes les parties prenantes, y compris les partenaires sociaux, la société civile et les partenaires au développement, devraient être impliquées dans toute révision du programme. Selon elle, cette révision doit donc se faire en synergie avec l’ensemble des partenaires.
Elle rappelle que ce dispositif s’inscrit dans un objectif mondial, initialement appelé Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), aujourd’hui transformé en Objectifs de développement durable (ODD). Elle souligne que toutes les parties prenantes, y compris les partenaires sociaux, la société civile et les partenaires au développement, devraient être impliquées dans toute révision du programme. Selon elle, cette révision doit donc se faire en synergie avec l’ensemble des partenaires.
Pour Mme. Bukuru, les conséquences d’une réforme mal préparée pourraient être graves. Elle estime qu’il est essentiel de mener un dialogue large et inclusif avant toute décision. La santé n’est pas une marchandise et représente une condition indispensable à une activité économique productive et soutenue.
Elle précise que le gouvernement a de la latitude de prendre les mesures jugées pertinentes mais, il faut un audit approfondi afin d’identifier la cause des problèmes de gestion et de manque de transparence. Elle recommande également d’envisager une stratégie socialement acceptable, basée sur un suivi rigoureux par des gestionnaires technocrates engagés.
Réflexion de Jean Ndenzako
« L’enjeu n’est pas seulement technique mais profondément politique. »
Selon M. Ndenzako, le Burundi se tient aujourd’hui à la croisée des chemins en matière de politique sanitaire. La gratuité des soinsintroduite en 2006 grâce aux marges budgétaires ouvertes par l’IPPTE, a marqué une rupture positive avec le passé. « Elle a dopé la fréquentation des centres de santé – de 0,4 consultation par habitant en 2005 à plus de 1,2 en 2023 selon les rapports du ministère de la Santé –, réduit la mortalité infantile de 104 à 48 pour mille naissances vivantes et la mortalité maternelle de 1 200 à 548 pour 100 000 naissances vivantes (Enquête démographique et de santé, 2016-2023). »
 Surtout, poursuit Jean Ndenzako, elle a ancré dans la conscience collective l’idée que la santé est un droit fondamental et non une marchandise réservée aux plus aisés. Jean Ndenzako fait un constat. « Pourtant, après deux décennies, les failles du système sautent aux yeux : ruptures de stocks récurrentes (médicaments essentiels indisponibles dans 42 % des centres de santé en 2024, Isteebu), infrastructures saturées (taux d’occupation des lits dépassant 120 % dans les hôpitaux de référence), paiements informels qui réintroduisent l’exclusion (jusqu’à 15 000 BIF) par accouchement dans certains districts, selon des enquêtes de terrain), et surtout une charge budgétaire qui croît plus vite que les recettes publiques dans un pays où le PIB par habitant stagne autour de 200 dollars et la pression fiscale reste l’une des plus faibles du continent (9,8 % du PIB en 2024). »
Surtout, poursuit Jean Ndenzako, elle a ancré dans la conscience collective l’idée que la santé est un droit fondamental et non une marchandise réservée aux plus aisés. Jean Ndenzako fait un constat. « Pourtant, après deux décennies, les failles du système sautent aux yeux : ruptures de stocks récurrentes (médicaments essentiels indisponibles dans 42 % des centres de santé en 2024, Isteebu), infrastructures saturées (taux d’occupation des lits dépassant 120 % dans les hôpitaux de référence), paiements informels qui réintroduisent l’exclusion (jusqu’à 15 000 BIF) par accouchement dans certains districts, selon des enquêtes de terrain), et surtout une charge budgétaire qui croît plus vite que les recettes publiques dans un pays où le PIB par habitant stagne autour de 200 dollars et la pression fiscale reste l’une des plus faibles du continent (9,8 % du PIB en 2024). »
Il ajoute que « la question n’est plus de savoir s’il faut réformer, mais comment passer d’une gratuité généralisée à une couverture sanitaire universelle (CSU) qui soit à la fois équitable et fiscalement soutenable. Cette transition repose sur l’articulation de deux principes indissociables : protéger les plus vulnérables sans compromettre la viabilité des finances publiques, et contenir les dépenses sans sacrifier la qualité ni l’accès. »
D’après l’économiste, l’enjeu n’est pas seulement technique, mais profondément politique. « Il s’agit de transformer un acquis social en un système résilient, capable de survivre aux chocs exogènes – volatilité de l’aide, fluctuations des cours des matières premières, crises climatiques – et de s’auto-alimenter à long terme. »
Diagnostic économique : les pièges de la gratuité non ciblée
Le ratio santé/PIB oscille autour de 6 %, un chiffre respectable en apparence, mais qui cache une réalité plus préoccupante. Sur les 1 200 milliards de BIF alloués au secteur en 2024, près de 60 % proviennent de l’aide extérieure (Banque mondiale, OMS), rendant le système vulnérable à tout retrait de partenaires. La contribution domestique, elle, est étouffée par une économie largement informelle : 83 % de l’emploi, selon l’Enquête nationale sur l’emploi 2023, échappe à l’impôt.
La gratuité non ciblée génère trois distorsions majeures.
1. L’aléa moral : la suppression totale des barrières financières entraîne une surconsommation de soins à faible valeur ajoutée. Une étude pilote menée à Gitega en 2022 a révélé que 28 % des consultations pédiatriques concernaient des pathologies bénignes (rhumes, diarrhées simples) qui auraient pu être gérées à domicile avec une éducation sanitaire renforcée.
2. L’asymétrie d’information : en l’absence de régulation, les prestataires orientent la demande vers des actes plus coûteux ou prescrivent des médicaments indisponibles, obligeant les familles à se tourner vers le marché parallèle.
3. L’effet d’éviction : chaque franc dépensé en soins gratuits est un franc qui n’ira pas à l’éducation (où le taux de redoublement au primaire dépasse 35 %) ou à l’agriculture (où les rendements céréaliers stagnent à 1,2 t/ha contre 3,5 t/ha au Rwanda). Or, la littérature sur le capital humain (Becker, 1964 ; Lucas, 1988) montre que ces secteurs génèrent des externalités positives bien supérieures à court et à moyen termes.
Trois leviers pour une réforme crédible
Une CSU viable doit reposer sur trois piliers complémentaires, séquencés dans le temps et adaptés au contexte burundais.
1. Ciblage socio-économique et tickets modérateurs progressifs
Un registre national unifié des ménages, basé sur des critères objectifs (revenus, actifs, localisation, taille du ménage), permettrait d’identifier les 40 % les plus pauvres avec une précision supérieure à 85 % (méthode Proxy Means Testing, validée au Rwanda et en Ouganda). Pour ces ménages, la gratuité intégrale serait maintenue. Pour les 60 % restants, un système de tickets modérateurs progressifs serait introduit :
• 0 FBu pour les deux premiers quintiles ;
• 1 000 FIB par consultation pour le 3ᵉ quintile ;
• 2 000 FIB pour le 4ᵉ ;
• 5 000 BIF pour le 5ᵉ.
Un plafond annuel (par exemple 50 000 BIF par ménage) éviterait les dépenses catastrophiques. Ce dispositif, testé avec succès au Ghana (National Health Insurance Scheme), réduit la demande inutile de 15 à 20 % tout en préservant l’accès des plus démunis.
2. Mutuelles communautaires subventionnées et obligatoires
Les mutuelles de santé existantes (MUSA, CAM) couvrent aujourd’hui moins de 5 % de la population. Leur généralisation à l’échelle des collines, avec une cotisation annuelle de 3 000 F par adulte (subventionnée à 100 % pour les indigents, 50 % pour le 2ᵉ quintile), permettrait de mutualiser les risques à un niveau géographique pertinent. Un fonds de réassurance national, financé par l’État et les partenaires, absorberait les chocs épidémiques (paludisme, choléra). L’expérience rwandaise montre qu’une adhésion obligatoire, couplée à des campagnes de sensibilisation, peut atteindre 85 % de couverture en cinq ans.
3. Financements innovants et gouvernance renforcée
• Taxes comportementales : une taxe de 10 % sur les boissons sucrées et 50 % sur le tabac générerait environ 25 milliards de BIF par an (estimation Banque mondiale, 2023), soit 8 % du budget santé actuel.
• Performance-based financing (PBF) : lier 30 % des subventions aux districts à des indicateurs vérifiés (taux de vaccination, accouchements assistés, gestion des stocks) a permis au Rwanda d’augmenter la qualité des soins de 22 % en trois ans.
• Partenariats public-privé (PPP) : confier la gestion des hôpitaux de district à des opérateurs privés sous contrat de performance (comme au Lesotho) libérerait des ressources publiques pour les soins primaires.
La gouvernance doit suivre. Décentraliser réellement les budgets vers les districts sanitaires (actuellement, 70 % des fonds restent à Bujumbura), installer des tableaux de bord numériques pour suivre les stocks et les indicateurs de performance, former les agents à la gestion des données et numériser les dossiers médicaux : autant de mesures qui réduisent les fuites (estimées à 18 % du budget selon l’Inspection générale des finances, 2022) et améliorent la réactivité. Sur le plan macroéconomique, formaliser progressivement les micro-entreprises via un guichet unique et optimiser la collecte dans les centres urbains (où 60 % des recettes fiscales sont générées) élargira la base fiscale, créant un cercle vertueux où une population en meilleure santé produit davantage et finance mieux son propre système.
Le Rwanda comme miroir, pas comme modèle
Le Rwanda voisin montre la voie : couverture à plus de 90 % en moins de vingt ans grâce à un modèle hybride de subventions ciblées, mutuelles obligatoires et incitations à la performance. Le Burundi n’a pas les mêmes moyens institutionnels mais, il dispose d’atouts : une démographie jeune (médiane d’âge 17 ans), une couverture géographique des centres de santé déjà dense (un centre pour 25 000 habitants), et une population désormais habituée aux soins préventifs.
L’adaptation, et non la copie, est la clé : des mutuelles ancrées dans les associations collinaires, un ciblage basé sur les réalités rurales, une progressivité des réformes pour éviter les ruptures brutales.
Une vision politique : la santé comme moteur d’émergence
Au-delà des chiffres, la CSU est un projet politique. Réduire la vulnérabilité sanitaire des ménages libère des ressources cognitives et financières : une mère qui ne craint plus la mort en couches investit dans l’éducation de ses enfants ; un agriculteur qui n’est plus ruiné par une crise de paludisme peut acheter des semences améliorées.
C’est un investissement dans le capital humain, condition sine qua non d’une croissance inclusive capable de briser le cycle de la pauvreté. Les acquis de 2006 – une population désormais convaincue de la valeur des soins préventifs – sont un capital social précieux. Il appartient aux décideurs, aux experts et à la société civile de le transformer en un système résilient où équité et soutenabilité se renforcent mutuellement. La route est longue, mais elle est tracée. Une CSU burundaise, progressive, inclusive et endogène, n’est pas un rêve : c’est une nécessité. Et c’est, peut-être, la plus belle promesse que le pays peut faire à sa jeunesse.














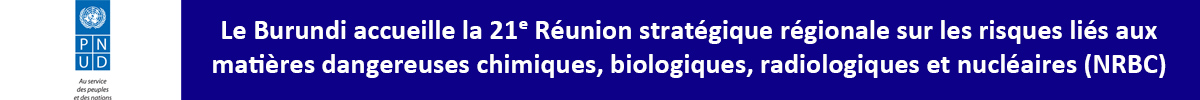







La croissance démographique burundaise est exponentielle et aucun gouvernement au monde ne pourrait tenir le rythme en termes d’éducation, de création d’emplois et de soins de santé. Lorsque je sillonne la campagne ou les rues de Bujumbura, j’ai comme l’impression que chaque fille pubère a obligation de produire un bébé. Souvent ce sont des bébés qui font des bébés perpétuant de ce fait le cycle de misère de mère à enfant. Chaque fois que je les vois je suis peiné par cette condition féminine qui ne laisse pas aux petites filles le temps de vivre leur enfance avant d’endosser la terrible responsabilité de procréation. Que faire ? La seule solution ce sont des niveaux élevés d’éducation et de développement qui seuls peuvent juguler et inverser l’explosion démographique. A l’indépendance, nous étions 2 millions. En soixante ans, la population a été multipliée par 6 sans que les services scolaires, sanitaires et développementaux croissent au même taux. Les interminables guerres qui nous affligent s’expliquent par cette situation intenable. Des rats affamés se mangent entre eux.
La proposition du Ministre des finances doit être entendue avec intérêt, attention et réalisme, tenant compte du contexte et de la vision 2040/2060.
Ainsi nous le comprendrons tous.