Pour cet économiste, la fixation autoritaire des prix des logements dans un contexte de pénurie est comme appliquer un garrot sur une jambe blessée. Selon lui, ça semble agir sur le problème (l’hémorragie/le prix), mais cela cause des dégâts bien pires (la nécrose/la pénurie) à long terme. La véritable solution, bien que plus complexe et à long terme, passe par l’augmentation de l’offre et des aides ciblées aux ménages plutôt que par le contrôle des prix.
Que pensez-vous de la régulation des prix des logements ?
Dans le débat sur les politiques publiques visant à remédier à la crise du logement, la fixation autoritaire des loyers apparaît souvent comme une solution séduisante. Pourtant, cette mesure, lorsqu’elle est appliquée dans un contexte de pénurie initiale, tend non seulement à manquer son objectif, mais aussi à aggraver les déséquilibres qu’elle prétend corriger.
Loin d’être une réponse efficace, le plafonnement des loyers constitue une entrave aux dynamiques fondamentales du marché immobilier, compromettant à la fois l’offre, la qualité du parc locatif et l’équité dans l’accès au logement.
Quelles sont les conséquences du contrôle des prix des loyers ?
La première conséquence d’un contrôle strict des loyers est la dissuasion de l’investissement dans la construction neuve. Les promoteurs, confrontés à des rendements artificiellement réduits, réévaluent la viabilité économique de leurs projets. Lorsque les loyers ne permettent plus de couvrir les coûts de construction, d’entretien et de gestion, l’incitation à bâtir s’effondre.
Ce phénomène est particulièrement préoccupant dans les zones urbaines à forte densité, où la demande excède déjà largement l’offre. En outre, les propriétaires existants, incapables de maintenir leurs biens sans rentabilité suffisante, tendent à négliger les réparations ou à retirer leurs logements du marché. Certains choisissent même de les laisser vacants, aggravant ainsi la rareté des unités disponibles.
Sur le plan économique ?
Le plafonnement des loyers introduit une distorsion majeure dans le mécanisme d’ajustement entre l’offre et la demande. En fixant un prix inférieur au niveau d’équilibre, on stimule artificiellement la demande tout en décourageant l’offre. Ce déséquilibre engendre une pénurie plus sévère, où le nombre de demandeurs excède largement celui des logements accessibles.
Ce phénomène, bien documenté dans la littérature économique, conduit à une allocation inefficace des ressources : les logements ne sont plus attribués en fonction des besoins ou de la capacité à payer, mais selon des critères arbitraires ou informels.
Cela engendre d’autres problèmes ?
Cette inefficacité se traduit également par une rigidité croissante du parc locatif. Les locataires bénéficiant de loyers avantageux n’ont aucun intérêt à quitter leur logement, même lorsque celui-ci ne correspond plus à leur situation familiale ou professionnelle.
Cette immobilité bloque la circulation naturelle des biens immobiliers et empêche une répartition optimale des logements. Par ailleurs, la pénurie induite favorise l’émergence de pratiques informelles : loyers au noir, cautions abusives, favoritisme dans l’attribution. Ces dérives excluent les ménages les plus vulnérables, que la mesure était censée protéger, et renforcent les inégalités sociales.
Quel est l’impact sur le parc locatif ?
La qualité du parc locatif subit elle aussi les effets délétères du contrôle des loyers. Faute de revenus suffisants, les propriétaires reportent les travaux d’entretien, compromettant la salubrité et la sécurité des logements. À long terme, cette dégradation nuit à la santé des occupants et alourdit les coûts de réhabilitation pour la collectivité.
Quelles sont les pistes de solution ?
Face à ces constats, il apparaît nécessaire de privilégier des politiques structurelles visant à accroître l’offre de logements. Cela implique une simplification des procédures d’urbanisme, des incitations fiscales à la construction et une mobilisation des terrains publics.
Parallèlement, des aides ciblées aux ménages, telles que les allocations logement, permettent de soutenir la demande sans entraver l’investissement. Enfin, un encadrement souple et localisé des loyers, limité aux hausses excessives dans les zones en tension, peut offrir une protection aux locataires sans compromettre l’équilibre du marché.
Quid d’une politique du logement efficace ?
Le contrôle autoritaire des loyers constitue une réponse illusoire à une problématique complexe. En masquant les symptômes sans traiter les causes, il aggrave les déséquilibres qu’il prétend résoudre. Une politique du logement efficace doit s’appuyer sur une vision à long terme, fondée sur l’augmentation de l’offre, la régulation intelligente et le soutien ciblé aux ménages. C’est à ce prix que l’on pourra restaurer un marché locatif dynamique, équitable et durable.
Le financement du logement à travers les âges
Dans son étude intitulée « Le Financement du logement au Burundi : défis et réponses possibles. » (Université du Burundi, FSEA-CURDES), Déo Banderembako revient sur l’évolution du financement du logement au Burundi et les contraintes rencontrées.
•De l’époque coloniale à 1970 : La politique du logement a consisté à loger gratuitement les fonctionnaires de l’État. Des quartiers ont été lotis et des logements de standing varié ont été réalisés (Kiriri, OCAF, Quartier belge, Fonds d’avance). Certaines de ces maisons, en particulier celles de Kiriri, devaient être équipées et entretenues par l’État.
•De 1970 à 1979 : A cette époque, la formule de cession des logements à leurs occupants était mise en œuvre. Comme toutes les maisons occupées par les fonctionnaires devaient être équipées et entretenues par l’État, les frais d’entretien des maisons, de réparation et de remplacement du mobilier n’ont cessé de croître jusqu’à atteindre des sommes faramineuses. En 1973, le gouvernement a pris la décision de céder les maisons à leurs occupants en leur accordant une indemnité de logement égale à 60 % du salaire pour leur permettre de rembourser le coût de la maison.
•De 1979 à 1986 : C’est l’époque de la politique d’assistance à l’acquisition du premier logement par les fonctionnaires. Le gouvernement a créé la SIP (Société immobilière publique), qui a aussitôt aménagé de nouveaux quartiers, mais pour les seuls hauts fonctionnaires de l’État, excluant les agents du secteur privé et les autres catégories inférieures de la Fonction publique.
L’État du Burundi s’est engagé à cette époque à subventionner à 100 % les intérêts des crédits au premier logement consentis à ses cadres et agents ; verser 20 % du capital qui devait être plafonné à 3 600 000 BIF ; abandonner sa formule de loger gratuitement les fonctionnaires.
Cette politique a été abandonnée en 1986 avec l’entrée du Burundi dans le Programme d’Ajustement structurel où l’État a été soumis à une rigueur stricte de gestion budgétaire par ses partenaires extérieurs.
Depuis cette période, l’État a essayé de mettre en place un mécanisme de financement du logement urbain avec la création en 1989 du Fonds de promotion de l’Habitat urbain (FPHU) dont l’objectif est la mobilisation de l’épargne du secteur institutionnel et des ménages pour financer les opérations d’habitat et l’investissement immobilier principalement dans les centres urbains du pays.
Pendant que la SIP aménageait les terrains et construisait pour les cadres supérieurs et les cadres moyens, l’État a créé l’Ecosat (Encadrement des constructions et Aménagement des terrains et construction de maisons) pour les agents du secteur public et privé, mais à bas revenus. Faute de réserves foncières suffisantes, leurs activités se déroulent de façon discontinue et ces sociétés connaissent de sérieuses difficultés financières actuellement.
Avec le désengagement de la SIP et de l’Ecosat dans la production du logement, presque tous les logements sont réalisés en auto-construction, c’est dire que c’est le bénéficiaire final du logement qui cherche la parcelle, mobilise les financements, fait les études du sol, fait le choix des matériaux, recrute et rémunère la main-d’œuvre. Concernant le financement du logement, il n’y a que le FPHU qui accorde des crédits. La plupart des projets entrepris par le passé portaient sur des réalisations de grand standing qui n’étaient pas accessibles aux personnes à revenus moyens dans un pays où la majorité des clés se trouvent dans cette catégorie.
En 2023, le gouvernement, à travers le ministère des Infrastructures, de l’Equipement et des Logements sociaux (MIELS), avait signé des contrats avec trois sociétés immobilières pour lancer la construction de logements collectifs. L’objectif était de construire plus de 5 000 à 6 600 appartements pour faire face à une forte demande de logements urbains et à l’exode rural. La stratégie prévoyait la mise à disposition de terrains viables, des constructions en hauteur, le système de location-vente, un financement encadré par la Banque centrale et l’implication claire de chaque acteur. Des sites avaient même été identifiés, comme Kizingwe-Bihara et Socarti, et des maquettes de modèles annoncées.
Mais alors que près de 50 000 citadins s’étaient inscrits pour bénéficier de cette politique, les travaux annoncés pour la saison sèche 2023, puis reportés à septembre 2024, n’ont jamais réellement commencé. L’appel lancé aux investisseurs privés par le ministre Dieudonné Dukundane n’a pas suffi.
Aujourd’hui, dans un contexte d’explosion des loyers, ces objectifs semblent sombrer dans l’oubli tandis que les habitants de Bujumbura attendent toujours la concrétisation de cette promesse de logements sociaux.














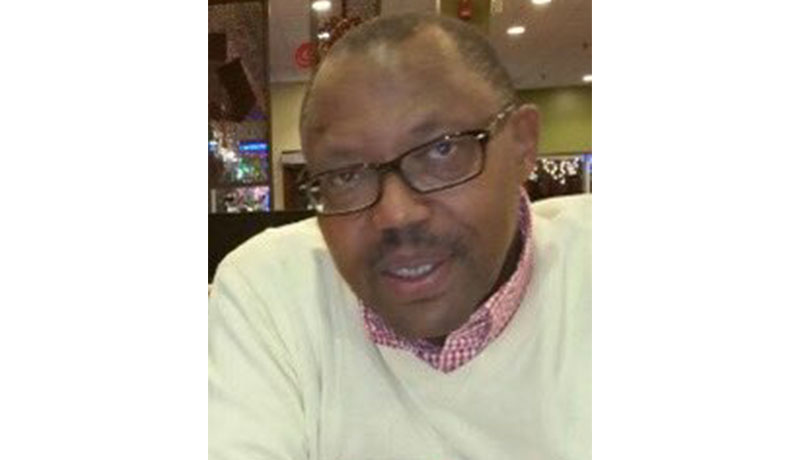
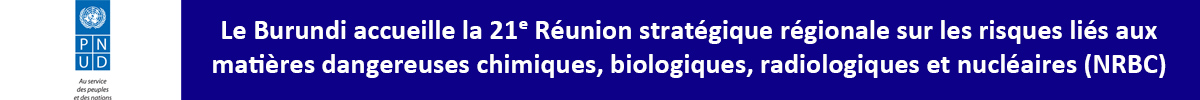


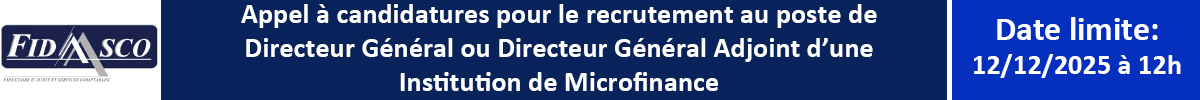






Si vous voulez savoir ce qui se passe quand on essaye de contrôler la nature des choses, essaye de prendre un ballon, pose le sur l’eau d’un lac ou piscine, vous remarquerez que le ballon flotte juste sûr la surface de l’eau. Mainant essayer de presser le même ballon sous l’eau, disons 50cm de profondeur. Vous remarquerez que, vous ne pourrez pas garder le ballon sous l’eau pour longtemps. une fois fatigué, que vous allez relâcher le ballon, il va monter d’un mètre!
Pour moi, Mr le Grand pense qu’il est dieu depuis qu’il est tombé sur la planche à billets, imprime pour payer les imbonerakura, PAEEJ, Les coopératives Sangwe qui finissent par être insolvables et tout ce qu’il veut au Burundi, fixer les prix des energies fossiles(essence, diesel, pétrole), puis les produits alimentaires, etc…. Vous savez tous comment cette histoire a fini. Aujourd’hui, c’est les loyers des maisons qui lui appartiennent pas.
Qui sont les conseilets économiques des DD?
Il pourrait construire des maison mais, il ne peut pas car cela demande des devises. Tout argent qu’il imprime pour payer ses projets des « ponds qui vont nul part » finissent a créer une inflation. Autrement dit, dilue le pouvoir d’achat des épargnes, ce qui rend difficile l’investissement immobilier, etc… Donc ses solutions finissent par rendre prie le problème dont il essaye de résoudre .
Pas besoin d’un doctorat en économie . Peu de choses sont nouvelles sous le soleil. Vous n’êtes pas obligé de me croire. Si vous avez l’internet aller chercher les pays qui ont appliqué ces idées et revenez nous avec la liste de ceux qui ont réussi svp.