Pour cette deuxième partie de l’interview, le politologue Julien Nimubona analyse, sans détours comme d’habitude, les dernières élections législatives et sénatoriales, l’architecture du nouveau Parlement, le « balayage » de l’opposition, le mode de gouvernance du parti de l’aigle et ses dangers, le nouveau redécoupage administratif, etc.
Professeur Nimubona, comment analysez-vous l’architecture du nouveau Parlement burundais dans le contexte des systèmes politiques mondiaux ?
J’ai énormément réfléchi sur l’élection du nouveau Parlement. Dans le monde, on a expérimenté trois sortes de systèmes. Le premier système est connu aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ce sont les pays qui connaissent soit un régime présidentiel, soit un régime parlementaire, mais un mode de scrutin commun, un mode de scrutin majoritaire, qui fait que lorsqu’il y a des élections, on doit obtenir une majorité qui se dégage pour gouverner. Voilà pourquoi aux États-Unis, on fait un nettoyage qu’on appelle le « spoil system » au niveau de la haute administration publique.
En quoi la situation burundaise diffère-t-elle de ces systèmes démocratiques occidentaux que vous venez de décrire ?
Attention ! Dans ces pays-là, non seulement les élections sont extrêmement libres, transparentes, donc non discutables, et surtout, les individus ne vivent pas de l’État ou de la politique. Il y a des secteurs privés, socio-économiques, hyper développés, qui font vivre plus que l’État. Les gens font la politique par conviction, par réalisation des valeurs. Au Burundi, on n’est pas dans cette configuration d’un mode de scrutin qui aurait permis à une majorité unique de se constituer.
Vous évoquiez trois systèmes. Quel est ce deuxième modèle politique et comment fonctionne-t-il ?
On a le système à la soviétique ou à la chinoise, où on a un parti unique qui a triomphé d’une élection où il n’y avait pas de concurrence. Au départ, on a averti les candidats éventuels de s’abstenir. Donc, on confirme les candidats choisis par les états-majors des partis. Là, on parle de démocratie populaire. D’autres auteurs parlaient même de démocratie totalitaire. On n’est pas dans ce type de système non plus parce que, y compris le CNDD-FDD, on dit qu’on est dans le pluralisme politique, on est dans la démocratie, etc. On voudrait bien masquer toutes les opérations politiques par la démocratie, donc par les élections.
Dans quelle catégorie situez-vous alors le système politique burundais actuel ?
Enfin, le troisième système, c’est le nôtre, où les élites au pouvoir organisent les élections pour confirmer leur domination. Autrement dit, les élections sont un instrument de domination politique parmi les autres instruments de domination. Donc, rien n’est étonnant.
Nous, on est, depuis les indépendances d’ailleurs, dans une logique monopartiste. Le multipartisme n’est qu’un modèle imposé de l’Occident, manipulé, instrumentalisé juste pour plaire aux Occidentaux. Mais en réalité, c’est vraiment un instrument au service de la domination d’un groupe sur le reste de la société.
Cette logique de non-partage du pouvoir que vous décrivez semble être une stratégie délibérée. Comment se manifeste-t-elle concrètement ?
On n’est pas dans une logique de partage du pouvoir. La preuve : la Constitution de 2018 a consacré la fin du consociationalisme, c’est-à-dire la philosophie du partage du pouvoir. Ce que j’ai noté de ces élections du 5 juin, c’est cette intention du CNDD-FDD de balayer partout, balayer partout. Ce n’est pas seulement le balayage du partage du pouvoir sur base ethnique, non, balayer sur base de diversité politique.
Pouvez-vous nous donner des exemples concrets de cette stratégie de « balayage » que vous mentionnez ?
Nous ne voulons pas partager le pouvoir, nous voulons que tous les pouvoirs, y compris les pouvoirs à la base, nous appartiennent. Vous vous rendez compte : même les élections des conseillers collinaires et des chefs de quartiers, alors que la loi dit qu’elles sont organisées en dehors des compétitions partisanes, on sent une ingérence énorme du parti au pouvoir. C’est-à-dire qu’on voudrait bien que tout le pays soit quadrillé politiquement et que ce soit une sorte de parti-État à tous les niveaux. C’est tout ce que je retiens.
Cette intention de « balayage » total que vous décrivez constitue-t-elle une nouveauté dans la stratégie du CNDD-FDD ou s’inscrit-elle dans une évolution plus ancienne ?
L’architecture du Parlement n’est que le reflet d’un aboutissement, d’une volonté qui a cheminé depuis à peu près 2015. Jusqu’en 2015, je pense que le parti CNDD-FDD avec le président Nkurunziza tentait tant bien que mal d’accepter sans plaisir la philosophie imposée, car ce n’était pas vécue et c’est ce que nous appelons un problème d’appropriation institutionnelle : le modèle d’Arusha du partage du pouvoir. C’est tout. Donc, il ne fallait rien attendre des élections de 2025, sinon l’aboutissement total de ce cheminement.
Vous semblez inquiet de cette évolution. Quels sont les risques que vous identifiez pour l’avenir du pays ?
C’est cela qui me fait peur, car nous n’avons pas la culture institutionnelle, la culture de l’État de droit, la culture de séparation de l’État et de la politique. À plusieurs reprises, le secrétaire général du parti Cndd-Fdd a déclaré que l’État, c’était le CNDD-FDD et le CNDD-FDD, c’est l’État. Cette confusion entre l’État et le parti au pouvoir, ce qui est très grave, entraînera quoi ?
Concrètement, comment cette confusion entre l’État et le parti pourrait-elle affecter la vie quotidienne des citoyens burundais ?
Toute la chaîne de distribution du service public. Imaginez-vous : pour avoir une carte d’assurance maladie, pour avoir une école, pour avoir des soins de santé, pour avoir une attestation de naissance, pour avoir de l’emploi à tous les niveaux, on vous demande d’appartenir au parti. C’est cela que je crains. Ce sera un État exclusionnaire. Plus qu’un système politique monopartisan. Un système politique exclusionnaire.
Quelles seraient les implications politiques et sociales d’un tel système exclusionnaire ?
C’est pire. Sur le plan des représentations du pouvoir et sur le plan de la culture politique, cela signifie que ceux qui ne sont pas « in », ceux qui ne sont pas dans l’État, c’est-à-dire qui ne sont pas dans le parti au pouvoir, sont « out ». Qualifiés par ceux qui sont « in » comme des ennemis de la Nation, combattus comme tels. Eux aussi vont se représenter l’État, non plus comme une chose publique, mais comme une chose de certains, donc de ceux qui sont dedans, donc de ceux qui sont du Cndd-Fdd.
Cette dynamique d’exclusion pourrait-elle déboucher sur des conséquences plus graves pour la stabilité du pays ?
Quand vous avez beaucoup de gens qui commencent à se dire que ce n’est pas notre chose publique, nous n’avons rien en commun, on peut alors la détruire. C’est l’origine de la violence politique. C’est-à-dire que les gens peuvent porter des armes contre cet État-là. C’est cela l’origine des rébellions. C’est cela que je crains. La dérive finale d’un système ainsi construit.
Les résultats des élections du 5 juin 2025 vous ont-ils surpris, compte tenu de vos analyses antérieures ?
Je vous ai donné une interview, c’était l’année passée. C’était longtemps avant les élections. Je vous ai dit : on ne tend pas vers le monopartisme, on y est déjà. J’ai senti le monopartisme s’installer depuis les élections de 2020.
Vous dites avoir senti cette évolution dès 2020. Quels ont été les signaux précurseurs qui vous ont alerté ?
J’ai couvert les élections de 2020 pour le compte de l’Union européenne. J’ai senti qu’à partir du moment où, dans le processus électoral concernant les chefs de colline, les conseillers de colline et de quartiers, il y avait immixtion du politique, avec une campagne électorale très politisée, on perdait complètement les pédales. Et cela c’est après que les élections présidentielles, législatives et communales, aient été mélangées, ce qui est normalement non-assimilable, c’est-à-dire qu’on a réduit le peuple à un vote plébiscite. En 2020, on a fait un vote plébiscite. Vous acceptez le président de la République et son parti, et tous ceux qui sont sécrétés par lui ou c’est rien. Le peuple n’avait pas beaucoup de choix.
Vous parlez de vote plébiscite, mais il y avait l’opposant Agathon Rwasa comme figure d’opposition en 2020 ?
Dès 2020 déjà, l’opposition était balayée. Il n’y a eu qu’une petite résistance qui a soutenu Agathon Rwasa. Ce danger-là a été vite vu par le CNDD-FDD, et voilà comment on a mis les bâtons dans les roues de Rwasa pour prévenir que cela revienne en 2025. À partir de ce moment-là, j’ai dit : l’intention, la volonté, c’est de construire un parti unique parfait.
En tant que politologue, comment évaluez-vous l’hypothèse d’une participation d’Agathon Rwasa aux élections de 2025 ? Cela aurait-il pu changer la donne ?
En sciences politiques, nous ne spéculons pas comme cela en disant « si » … Non. Il fallait laisser pour voir. On ne sait pas. Ce n’est pas seulement Agathon Rwasa. On peut dire aussi : si on avait laissé les élections libres, transparentes, qu’est-ce qui se serait passé ? Cela, je ne peux pas vous le dire. Je note simplement que, sur ces élections, pèsent énormément de suspicions. C’est tout ce que nous nous retenons au niveau des scientifiques.
Au-delà des résultats, quels sont les principaux enseignements que vous tirez du processus électoral du 5 juin 2025 ?
L’absence de consensus général sur le déroulement des élections. On a senti que dans la gestion du contentieux électoral, le ministre de l’Intérieur, le président de la République sans parler du Secrétaire général du CNDD-FDD qui était une partie au conflit, ils ont été amenés, obligés de convoquer la menace de la violence, la menace du chantage sur les acteurs de l’opposition, sur l’Église catholique qui avait constaté les fraudes.
Lorsque vous avez un gestionnaire d’un contentieux qui s’érige en partie et qui, en plus, utilise la menace, c’est qu’il y a un malaise. C’est tout ce que nous notons.
Dans notre précédent entretien, vous qualifiez l’ancien Parlement de « croupion ». Quel terme utiliseriez-vous pour caractériser cette nouvelle assemblée ?
Lorsque nous parlons de Parlement croupion, c’est un reproche à quelqu’un qui était attendu dans la bonne norme. Mais là, lorsque le nouveau président de l’Assemblée nationale, qui était président de l’Assemblée sortante, dit dans son discours d’investiture : « Nous sommes en place pour aider le gouvernement », tout est compris. Donc, c’est une partie de l’exécutif qui est à Kigobe.
Ce n’est pas un Parlement croupion, cela sera l’acteur clé de l’ensemble du système. N’attendez pas les deux grandes missions de contrôleur de l’action gouvernementale ou de vote de loi efficace et bien analysée au niveau de cette Assemblée nationale-là. Ce que j’attends le plus et le mieux, c’est plutôt au niveau du Sénat.
Vous semblez placer plus d’espoirs dans le Sénat que dans l’Assemblée nationale. Sur quoi repose cette différence d’appréciation ?
Cette fois-ci, l’intention qu’a eue le constituant de 2018 va se jouer contre lui. En réduisant le nombre de sénateurs, il a finalement transformé l’ancien Sénat en une sorte de Cour des comptes de l’action gouvernementale. On verra bien.
Si les sénateurs jouent leur rôle, tel que je vois les personnalités qui y sont, je trouve que le Sénat pourra jouer un rôle beaucoup plus important que l’Assemblée nationale. L’Assemblée nationale est un fourre-tout.
Pouvez-vous développer cette analyse comparative entre le Sénat et l’Assemblée nationale en termes d’efficacité institutionnelle ?
C’est beaucoup de monde qui se ressemble. Il est toujours difficile de négocier un consensus à 111 qu’à 13. Il y a toujours un bon leadership à moins de 20 qu’à plus de 100.
Les difficultés qu’ont éprouvées les nouveaux députés à désigner leur président vont continuer jusqu’à la fin de la législature lorsqu’il s’agira de chercher un consensus sur l’une ou l’autre action à mener contre le gouvernement. Mais je ne me fais aucune illusion. Triomphera toujours la volonté du parti.
On observe effectivement la présence d’épouses et de proches de généraux ou de ténors du parti à l’Assemblée nationale. Comment interprétez-vous cette composition particulière ?
C’est le noyautage du Parlement. En fait, il y a trois mécanismes pour contrôler les députés, afin qu’ils soient inefficaces.
Quels sont concrètement ces mécanismes de contrôle que vous évoquez ?
Le premier mécanisme, c’est le fameux mode de scrutin de listes bloquées. En fait, on n’a pas voté pour des députés, on a voté pour le parti au pouvoir. La conséquence est que c’est le parti qui contrôle le député, et pas l’inverse. L’histoire du mandat national ou du mandat impératif dont on parle dans la Constitution, elle est violée à partir même de ce mode de désignation qui lie les députés. C’est la première façon de faire.
Finalement, comme c’est le Conseil des sages qui est présidé par le président de la République, donc chef de l’exécutif, c’est le Conseil des sages qui approuve les listes, cela veut dire que c’est le président qui a constitué les listes. Donc, vous n’avez pas le droit de contester celui qui vous a mis sur la liste.
Cette logique de contrôle signifie-t-elle que le vote parlementaire est acquis d’avance au pouvoir exécutif ?
Le seul avantage qui pourrait se retourner contre l’état-major du parti, c’est qu’en laissant passer tout le monde, du moins quasiment la première partie de la liste puisqu’il n’y avait pas de députés de l’opposition, ceux que l’on croyait qu’ils ne seraient pas élus ou qui étaient dans des positions inéligibles ont été élus. Ce n’étaient pas les mieux aimés de l’état-major du parti. Ceux-là, ils peuvent être efficaces au niveau de la contestation, au niveau de la mobilisation.
Quel est le deuxième mécanisme de contrôle que vous identifiez dans cette architecture parlementaire ?
C’est justement lors de la composition de ces listes. Qui a parrainé qui dans le poste X ? C’est comme cela que vous avez des généraux qui ont placé leurs femmes ou d’autres très fortes personnalités qui ont influencé les états-majors du parti pour placer telle ou telle personne. C’est cette femme-là, députée du général, qui ne va pas combattre le général parce que ce dernier fait partie du système. Donc, vous n’aurez pas d’action dirigée contre le gouvernement à partir du Parlement.
Et ce troisième mécanisme de contrôle ?
Le troisième mécanisme de contrôle du Parlement, c’est l’idéologisation poussée, le respect strict. J’allais dire l’obéissance stricte à l’égard de l’idéologie dominante. C’est mon parti ou rien. C’est comme ma cathédrale, c’est comme ma religion. Or, j’ai l’impression que le parti au pouvoir fonctionne de cette manière. Les gens ne se voient pas vivre en dehors de leur parti. Il y a même le dernier mécanisme.
Vous mentionnez un « dernier mécanisme ». De quoi s’agit-il exactement ?
On propose au nouveau député un crédit solidaire dans une banque X avec un taux d’intérêt préférentiel. Il va le payer sur le temps de la législature. Si vous vous soulevez contre l’idéologie du parti ou la stratégie globale du parti, on vous fait sortir du Parlement et vous allez payer une somme. C’est une sorte de dette que vous avez à l’égard du parti.
C’est effectivement un système qui ressemble à un piège financier…
C’est comme cela que le président Gélase Daniel Ndabirabe se moquait des députés à la fin de leur législature en disant : « Je vois des députés malheureux qui ont pris des crédits. Je leur avais conseillé de ne pas faire cela. Maintenant, comment est-ce que vous allez payer ? Maintenant, c’est la fin du mandat. »
Effectivement, lorsque j’ai analysé le temps que passe un député à l’hémicycle de Kigobe, le taux de renouvellement des élites parlementaires au sein du CNDD-FDD avoisine les 80 %. En fait, ils savent maintenant qu’on est candidat député pour 5 ans et puis c’est tout, vous retournez au village. En quelque sorte, vous avez 5 ans pour vivre, si vous ne vivez pas, après c’est la mort.
En somme, ces différents mécanismes privent-ils le député de toute marge de manœuvre et de libre arbitre ?
Avec tous ces mécanismes-là, le député est docile. Il va écouter les orientations générales qui lui sont suggérées d’ailleurs. Il perd sa liberté.
Revenons sur le choix du président de l’Assemblée nationale. Trouvez-vous qu’il y a une lutte d’influence au sein du CNDD-FDD ?
Je ne sais pas parce que tout est très secret au sein du CNDD-FDD. Nous, ce qu’on regarde dans la cohérence ou l’incohérence au niveau des organisations politiques, sachant très bien que ce parti au pouvoir est un parti normalement caractérisé par la cohérence, c’est quand il y a eu un débat autour de la fameuse disposition de la composition du bureau de l’Assemblée nationale.
Là, on a senti qu’il y avait des courants. Et qu’à la fin, triomphe la proposition de Gélase Ndabirabe. C’est à ce moment-là, quand tous les députés sont obligés de s’aligner, que l’on comprend la force qui triomphe et que c’est lui qui sera élu le lendemain. Mais dans sa proposition initiale, on sent qu’il y avait des orientations différentes.
Quelles étaient ces orientations divergentes que vous avez pu identifier ?
On peut sentir qu’il y avait une orientation qui est pro-présidentielle et une orientation qui était contre. C’était notamment la question de l’affirmation du pluralisme ou l’adoption d’un article qui confirmait ce qui est, c’est-à-dire le fait qu’il n’y a pas un autre parti à l’Assemblée nationale. Finalement, on a cheminé vers une voie qui articulait les deux. Qui réconciliait en quelque sorte les deux tendances. Mais si vous lisez bien les deux premières tendances initiales et ceux qui portaient ces tendances, on sent qu’il y avait effectivement deux camps qui s’affrontaient.
Observez-vous des signes de mécontentement liés aux déséquilibres dans la représentation régionale au sein du parti au pouvoir ?
Au niveau du gouvernement, la représentation est beaucoup plus Centre-Est moins que sud, nord-ouest et nord. C’est pour vous dire qu’il faut faire attention à cela. J’ai l’impression que plus on joue sur les influences des groupes d’intérêt, influençant les décisions au plus haut sommet, moins on fait attention à l’équilibre national.
Au niveau de la représentation des députés, c’est une configuration qui se gère au sein des partis politiques. Une des erreurs que j’ai constatées au sein du CNDD-FDD, c’est de penser qu’on met toujours en avant ceux qui votent plus pour lui.
Cette logique de privilégier les régions acquises au parti constitue-t-elle, selon vous, une erreur stratégique ?
En réalité, on conquiert ceux qui ont tendance à ne pas voter en votre faveur plutôt que ceux qui sont déjà acquis. C’est une erreur. Sous feu Pierre Nkurunziza, par exemple, on voyait très bien que les provinces de Mwaro, Bururi, Rutana et Rumonge étaient peu représentées.
Vous vous souvenez que Pierre Nkurunziza s’était mis en colère contre Mwaro en disant que c’était la province la plus sale, etc. Mais en réalité, c’était par rapport au nombre de voix qu’il avait obtenues lors des scrutins.
C’est comme le secrétaire général du parti au pouvoir qui déclare, dans une interview, qu’on a fusionné les provinces afin de diluer certaines parties du territoire qui étaient hostiles à son parti.
Comment réagissez-vous à cette déclaration du secrétaire général du parti selon laquelle le redécoupage vise à « diluer » les territoires hostiles ?
C’est inacceptable comme déclaration. Elle n’est pas intelligente comme déclaration parce qu’elle n’égalise pas les citoyens de l’ensemble du territoire. Donc, c’est cela que l’on peut constater. Il n’y a pas suffisamment de prise en compte de cet équilibre national global et de cette égalité des citoyens et des régions. Il y a des banalités chez nous qui passent.
Pouvez-vous nous donner des exemples concrets de ces « banalités » qui passent inaperçues dans la gestion publique ?
Quand un chef de l’État, son épouse, le président de l’Assemblée nationale ou du Sénat, le secrétaire général du parti, investissent dans leurs provinces d’origine, dans leurs communes d’origine, on pense que c’est normal.
En quoi ces pratiques posent-elles problème dans la gestion d’un État moderne ?
Mais on ne pense pas aux autres communes, aux autres provinces qui n’ont pas la chance d’avoir un président de quelque chose. Or, en réalité, ces présidents dont je viens de parler, ils tirent leurs revenus sur quoi ? Sur les impôts et taxes de tout le monde.
Normalement, dans la gestion des biens publics, on doit égaliser l’ensemble des régions. Il en est de même dans la désignation des autorités au niveau des députés et sénateurs, au niveau également des membres du gouvernement.
Des gens, même au sein du parti au pouvoir, critiquent le score de 100 % qu’on voit partout. D’après eux, c’est une erreur politique. Votre avis ?
Erreur politique par rapport à la conception éthique de la politique. C’est-à-dire ceux qui pensent qu’on a la paix, la stabilité, qu’on échappe à la guerre en adoptant une philosophie de partage du pouvoir, de communion sociale dans toutes les instances de la gestion de l’État.
C’est juste. Dans les facteurs de stabilisation politique, il y a notamment cet équilibre politique et social afin que l’on ne voie pas le développement de forces hostiles à l’État, à la Nation. Mais ce n’est pas une erreur.
Vous ne considérez donc pas ces scores parfaits comme problématiques ?
Les gens qui sont au pouvoir vous diront que ce n’est pas une erreur. L’objectif des acteurs politiques, ce n’est pas toujours de faire la paix. Qui vous dit qu’ils veulent la paix ? Eux, ce qui les intéresse, c’est la domination. Point. Ils sont machiavéliens, c’est-à-dire que tous les moyens sont bons pour que l’on atteigne le but.
Quel est donc l’objectif ultime que poursuivent ces acteurs politiques selon vous ?
C’est la domination politique avec tous les dividendes que cela procure.
Passons au nouveau redécoupage administratif. En tant qu’expert ayant contribué aux réflexions sur ce sujet, quelle est votre évaluation de la réforme mise en œuvre ?
En tant qu’expert-consultant de la Banque mondiale, ensuite du PNUD, du GIZ et de la Coopération suisse, j’avais contribué et j’ai inspiré la politique du regroupement des entités administratives. À l’époque, j’avais proposé un processus en crescendo. J’avais proposé qu’on commence par un regroupement des communes, mais qu’on garde les provinces afin de maîtriser un processus incertain qui est en train de poser problème à savoir le processus de gestion des personnels communaux.
J’avais même proposé, dans mon dernier rapport à la Banque mondiale, que la politique de décentralisation, qui concernait le remembrement territorial, soit gérée au niveau de la présidence de la République.
Qu’est-ce qui justifiait, selon votre expertise, cette centralisation au niveau présidentiel ?
C’est un domaine où il y a l’intervention de plusieurs ministères, où il y a conflit de compétences, d’intérêts. Conflit entre ministère de l’Intérieur et ministère du Développement communautaire à l’époque, concernant les projets de développement local. Conflit entre le ministère de la Fonction publique, qui gère les personnels déconcentrés de l’État, et les autres ministères en général puisque l’intention c’était de faire de l’administrateur ou du gouverneur le coordonnateur, l’animateur de l’entité administrative dans sa totalité. Mais on se rendait compte que s’il n’a pas d’autorité sur l’enseignant, sur le directeur provincial de l’enseignement, sur le directeur provincial de l’agriculture, de l’élevage et de l’environnement, sur le chef de district ou le directeur de l’hôpital provincial, ce gouverneur-là, il le contrôle comment ?
D’où, il fallait une politique cohérente. Au Rwanda par exemple, où je participais aussi à cette expertise, on avait localisé, pendant toute la période de réformes administratives et du territoire, le ministère à la présidence. Afin que le président lui-même, ayant une vision de fonctionnement de l’ensemble du territoire, ait des services dépendants de l’autorité du chef de l’État, et impulse toute la politique.
Votre proposition d’une approche graduée a-t-elle été prise en compte par les autorités ?
Ici, si le chef de l’État acceptait cette proposition, nous allions élaborer une loi conséquemment. Je vous assure, si on avait accepté cette réforme, on n’allait pas voir les problèmes que maintenant le redécoupage territorial pose. Ce dernier ne venait que pour concrétiser une vision déjà comprise par le gouvernement tout entier.
Aujourd’hui, on nomme un gouverneur sur des provinces dont les anciens fonctionnaires sont là, non affectés. Les communes, on les a regroupées. À l’époque, quand on a proposé le regroupement communal, c’était sur un critère précis, c’était sur le critère d’efficacité socio-économique.
Quelle méthodologie préconisiez-vous pour ce regroupement des entités administratives ?
On allait regrouper les communes en fonction des ressources économiques de chaque commune. Pour qu’une commune faible économiquement soit compensée par une commune forte économiquement. Vous ne pouvez pas regrouper deux communes qui n’ont comme richesses que les pierres ou les arbres.
Pouvez-vous illustrer cette approche par des exemples concrets issus de vos études ?
La Banque mondiale avait financé, tout au long de l’année 2013-2014, une grosse étude sur les finances communales. J’ai participé à cette excellente étude où nous comparions les communes sur base de ressources économiques. Nous avons constaté qu’on ne peut pas mettre ensemble, dans Bujumbura par exemple, Mukike et Mugongomanga. Cela ne donnait rien.
Mais si on mettait Mukike et Mutambu, Mugongomanga et Mutimbuzi. Économiquement, c’était rentable. Aujourd’hui, on a regroupé des communes, on a supprimé en même temps les provinces et on tombe dans le vide.
Le redécoupage actuel souffre-t-il donc d’un défaut de préparation et de planification ?
L’écueil majeur, c’est qu’il n’y a pas de loi de la fonction publique communale. Donc, les communes n’ont pas de personnel. Y aura-t-il un redéploiement des fonctionnaires de l’État vers les communes, vers les zones ? Dans les zones, on aura besoin d’autant de compétences, sinon plus que dans les communes. Il y a vraiment des problèmes incroyables en ce moment et je ne sais pas comment ils vont s’en sortir.
J’avais personnellement proposé au PNUD, avec des collègues de la faculté, de mener une étude sur la dimension institutionnelle de ce remembrement administratif. Cela n’est pas venu. Mais c’est très urgent.
Au-delà des considérations techniques, soupçonnez-vous des motivations politiques derrière ce redécoupage ?
Pourquoi ne pas le soupçonner ? À partir du moment où le secrétaire général du parti au pouvoir lui-même dit : « Nous avons regroupé certaines provinces qui étaient favorables à nous avec des provinces qui étaient défavorables. » Et cela donne des résultats. Notamment, il parlait de certaines communes de la mairie de Bujumbura qui sont maintenant diluées dans les anciennes provinces de Bujumbura, de Cibitoke et de Bubanza, etc.
Ces dysfonctionnements que vous décrivez représentent-ils un danger existentiel pour l’avenir du pays ?
Ce n’est pas fatal. Je considère toujours qu’on peut redresser les choses à condition de confier ces réflexions stratégiques à des experts qui connaissent et qui sont dépassionnés par rapport aux stratégies des acteurs politiques.
L’administration du territoire, c’est technique. Maintenant, le gouvernement est face à une question technique précise. La gestion territoriale, c’est-à-dire la gestion quotidienne de la population, c’est technique. Cela n’a rien à voir avec les partis politiques.
Revenons à votre analyse du système politique global. Estimez-vous qu’actuellement le CNDD-FDD exerce un contrôle absolu sur tous les leviers du pouvoir ?
C’est clair. Du point de vue du droit, c’est le Cndd-Fdd qui a la responsabilité devant le peuple et devant l’opinion internationale.
Pouvez-vous expliciter cette notion de responsabilité totale que vous attribuez au parti au pouvoir ?
À partir du moment où vous nettoyez tout le monde à tous les niveaux de responsabilité, c’est vous qui êtes responsable dans le bien comme dans le mal, dans l’efficacité comme dans l’inefficacité. Si vous gérez bien, vous avez une légitimité d’une longue durée. Si vous ne gérez pas bien, vous exposez le pays à une instabilité incroyable.
Comment cette logique du « tout ou rien » peut-elle pousser la population vers des solutions extrêmes ?
Les gens sont tentés par la révolution en se disant que si on ne change pas tout, on n’a rien. Nous sommes confrontés à ce genre de situation.
C’est pourquoi, je le dis avec gravité, le CNDD-FDD a la lourde responsabilité de gérer seul ce pays pendant les cinq ans qui viennent. L’histoire de dire « la sécurité, la politique, cela appartient à tout le monde, nous sommes tous des citoyens », il faut oublier ce genre de discours. Il y a les premiers responsables qui sont appelés à décider et à prendre l’initiative.
Face aux difficultés économiques croissantes et aux pénuries que connaît le pays, observez-vous des signes de désespoir chez les Burundais ?
Je ne suis pas de nature pessimiste. Je pense que l’on peut toujours retourner les situations. Je crois en la capacité de l’homme à changer, à se remettre en cause et à initier de bonnes initiatives. Je pense qu’au sein du CNDD-FDD, il y a des gens de bon esprit, intelligents, qui peuvent absolument raisonner et redresser la situation, à condition de développer une autre attitude d’ouverture et d’intégration des stratégies que propose tout le monde.
Dans ce contexte de monopolisation du pouvoir, quel est selon vous le principal défi que doit relever le CNDD-FDD ?
C’est sa capacité à aller mobiliser au-delà de lui-même. D’aller conquérir ceux qui ne sont pas avec lui. Tomber dans l’autosatisfaction, que tout le monde est d’accord avec moi, que nous avons été élus par tout le monde… Attention ! C’est pourquoi j’insiste beaucoup sur le consensus, sur le dialogue. C’est la meilleure façon d’échapper au risque du régime absolu, qui contraint et qui condamne tous les régimes à une contestation absolue aussi.
Malgré cette situation de force apparente du pouvoir, maintenez-vous que le dialogue avec l’opposition en exil reste possible et même nécessaire ?
Franchement, je n’ai jamais compris. C’est maintenant ou jamais que le président de la République a toutes les armes pour négocier avec l’opposition. C’est lorsque vous pensez que vous avez une majorité suffisante à l’intérieur, que vous pouvez aller à la discussion avec tout le monde, y compris vos ennemis. Je pense que la seule stratégie qui reste pour la survie de son régime, c’est absolument l’ouverture.
Un détail symbolique a retenu l’attention lors de la prestation de serment du nouveau gouvernement : l’absence du drapeau de l’Unité nationale. Comment interprétez-vous cet élément ?
Cela par contre, c’est une erreur symbolique. Le drapeau, le serment, cela donne au pouvoir et à l’autorité qui entend l’incarner une force symbolique, une force de croyance. Un drapeau représente quelque chose. L’absence du drapeau de l’Unité nationale, au moment où dans le même serment on dit pouvoir agir au nom de l’unité nationale, cela fait désordre. Mettons cela sur le compte d’une erreur du protocole d’État qui n’a pas fait son travail à Kigobe. Je préfère le dire comme cela pour ne pas prêter une mauvaise intention au chef de l’État.















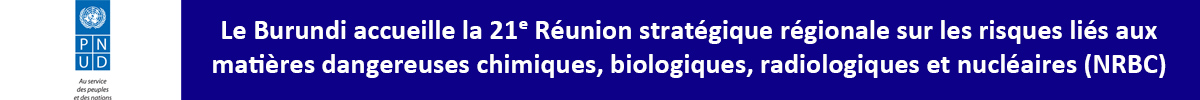







@Gacece, je note que la ‘honte’ c’est tout ce que vous avez retenu de mon commentaire. Puisqu’il s’agit de cela, disez-le haut et fort pour que meme les gouvernants l’entendent. Et comme vous le disez si bien, n’oubliez pas de leur dire que “la vie, toute vie, est sacrée” Le peuple burundais dans son ensemble en a marre et sa patience se meurt.
Si vous habitez dans ce pays vous êtes au courant que les stations-service sont à sec. Le chômage a atteint des niveaux sans precedent. Les prix des denrées alimentaires de base augmentent de façon spectaculaire. La qualité de l’éducation nationale laisse à desirer. La corruption fait la loi. Le droit à la libre expression d’opinion est quasiment inexistant. La violence contre toute différence d’opinion est institutionnalisée. Le parti présidentiel s’est approprié des prérogatives de l’exécutif, du judiciaire et du parlement etc. Laissons la ‘honte’ de côté – pensez-vous que tout ceci soit tenable?
Sans aucune autre forme d’opposition, le gouvernement devrait peut-être écouter les quelques voix de la raison qui subsistent, comme celle du professeur Nimubona.
@A. N.
« Et comme vous le disez si bien, n’oubliez pas de leur dire que “la vie, toute vie, est sacrée” Le peuple burundais dans son ensemble en a marre et sa patience se meurt. »
Drôle de façon d’exprimer une chose et son contraire!
Juste pour vérifier : selon vous, « le peuple Burundais dans son ensemble (j’insiste!) en a marre et sa patience se meurt. »… et il serait prêt à prendre les armes pour mettre en danger les vies d’eux-mêmes et celles des autres?
Nuance : Les militants du CNDD-FDD, incluant leurs leaders, font partie du peuple burundais… dans son ensemble et dans sa particularité… sauf si on ne parle pas du même « peuple burundais ».
Vous prêtez des intentions aux gens (à moi-même et au peuple burundais), exactement de la même manière que le fait le professeur dans son interview à l’égard du CNDD-FDD, et vous n’êtes même pas capable de saisir toute la nuance de mon propos. En quoi êtes-vous différent de lui? Qui se ressemble s’assemble… ou qui s’assemble finit par se ressembler.
Je le redis : “La vie, toute vie, est sacrée”! Et cela s’adresse à tout le monde et vaut pour tout le monde, incluant vous et moi. Êtes-vous d’accord?
Ce monsieur n’est plus membre du CNDD-FDD depuis plus de 10 ans, avoue lui-même que tout est secret dans ce parti, et se permet d’affirmer ce qui s’y passe! Puis-je affirmer à mon tour qu’il s’agit d’un ramassis d’élucubrations et d’opinions personnelles?
Mais je me dois d’ajouter que sa façon progressive à persuader les gens à penser que la prise d’armes (ou la violence) pour combattre le régime en place, est justifiable et acceptable, reste inquiétante. J’avais indiqué dans un autre commentaire que cet home est un extremiste ethnique :
https://www.iwacu-burundi.org/interview-exclusive-avec-le-pr-julien-nimubona-prendre-le-pouvoir-cest-different-de-gouverner/.
Je le maintiens toujours.
Cher Gacece, l’exercice intellectuel du professeur Nimubona dans cet article semble vous irriter et je vous comprends, croyez-moi. Cela étant, permettez-moi de dire que j’ai honte de votre commentaire. Une petite suggestion pour vous: relisez l’article en même temps que votre commentaire, et je vous assure que vous arriverez à la même conclusion que moi. La honte. Soit!
Cher Monsieur, vous pouvez insulter cet homme comme vous le souhaitez, mais de part votre commentaire je constate que son analyse demeure sans contradiction. De plus, « abene igihugu si abana » – un gouvernement qui tyrannise le peuple ne fait que remettre en question sa propre raison d’être. Je ne vous apprends rien (je pense) si je dis que l’oppression d’un peuple souverain ne peut être perpétuelle. L’oppression ne peut être sans consequences et le CNDD-FDD en sait quelque chose. Le fait est que pour le CNDD-FDD, depuis son arrivée au pouvoir, son objectif ultime était de transformer le système politique burundais en un système monopartite calqué sur le décret royal du 23 novembre 1966 instituant l’UPRONA comme parti unique. Et c’est désormais chose faite. Au Burundi, la démocratie, qu’elle soit représentative ou de concordance, est morte. Ses funérailles ont eu lieu le 5 juin 2025.
Comme l’UPRONA son prédécesseur, le CNDD-FDD a maintenant son propre système politique de parti unique. Et comme l’UPRONA, le CNDD-FDD finira par comprendre. Le parti presidentiel est à l’œuvre, de grace, que l’on ne l’interrompe pas! Du reste, l’éspoir c’est tout ce qui nous reste et on le gardera. Je vous salue chaleuresement, cher Gacece.
@V. N.
Tout comme mon commentaire m’appartient, votre commentaire vous appartient à votre tour. Je maintiens toujours le mien, et j’en suis fier et content!
Voyez-vous? J’aurais aimé que notre éminent professeur (constatez le respect) cite au moins une source interne (personne aussi anonyme soit-elle ou document) du parti qui fait l’objet de son « exercice intellectuelle ». Mais… Non! Il émet (ou plutôt il inventé) des hypothèses qu’il défend lui-même, à sa manière… insidieuse, haineuse et malhonnête.
Une seule lecture m’a suffi. Je ne perdrai pas plus temps sur des inventions!
Si vous êtes d’accord avec lui, c’est votre choix! Et… N’avez-vous pas honte de vouloir m’imposer votre honte? Celui qui le dit, c’est lui qui l’est!
La vie, toute vie, est sacrée! Toute personne qui encourage ou milite pour mettre des vies en danger n’est pas une bonne personne! C’est mon opinion.
Même vos ennemis ont le droit de vivre… et d’exprimer des opinions contraires aux vôtres… Sans/Sens la honte! Et allez-vous-en avec votre honte!