Alors que le Burundi bénéficie des financements de plusieurs milliards de dollars (USD) de la part de ses partenaires au développement, une réalité inquiétante émerge. Une grande partie de ces ressources reste inutilisée alors que la population attend des projets concrets.
Dans une réunion tenue le 9 octobre 2025 avec les unités de coordination des projets financés par les partenaires au développement, le ministre des Finances, du Budget et de l’Économie numérique, Alain Ndikumana, a dénoncé le faible taux de décaissement des fonds comme un frein majeur à la croissance du pays.
Selon lui, sur près de deux milliards USD alloués par la Banque mondiale, seuls 21,4 % ont été décaissés laissant plus de 1,6 milliard USD inutilisés. Le ministre a également cité d’autres institutions comme la Banque africaine de développement (BAD) et le Fonds international de Développement agricole (FIDA), où les taux de décaissement restent également très faibles.
M. Ndikumana estime que cette situation découle avant tout d’une mauvaise identification des projets beaucoup étant conçus sans hiérarchiser les priorités nationales. « Certains projets sont lancés sans tenir compte de leur véritable impact sur le développement du pays ».
Il a par ailleurs souligné la nécessité pour les bénéficiaires de s’approprier pleinement les projets et pour les unités de coordination de faire preuve de compétence et de rigueur. Il a pris pour exemple le projet du barrage hydroélectrique Jiji-Murembwe, initié en 2011 mais toujours en retard alors qu’il devait être achevé depuis plusieurs années.
Le ministre des Finances a appelé à revoir la méthode de sélection et de gestion des projets en insistant sur la volonté politique et la discipline comme clés du changement. Il a rappelé qu’une meilleure utilisation des financements extérieurs permettrait non seulement d’accélérer la mise en œuvre des programmes de développement mais aussi de renforcer la stabilité économique du pays, notamment en réduisant « la pénurie de devises étrangères ».
Réactions
Faustin Ndikumana : « Il est urgent de restaurer la crédibilité du pays à travers une gouvernance axée sur les résultats »
 Pour le directeur national de Parcem, le faible capacité d’absorption des financements extérieurs résulte d’un problème ancien et structurel. Il estime que cette situation perdure depuis plus d’une décennie, rappelant qu’en 2012, lors du Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP II) à Genève, à peine 20 % des engagements avaient été mobilisés.
Pour le directeur national de Parcem, le faible capacité d’absorption des financements extérieurs résulte d’un problème ancien et structurel. Il estime que cette situation perdure depuis plus d’une décennie, rappelant qu’en 2012, lors du Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP II) à Genève, à peine 20 % des engagements avaient été mobilisés.
Selon lui, le Burundi accuse depuis longtemps un retard considérable dans l’accès et l’utilisation des fonds internationaux. Alors que d’autres pays avaient déjà bénéficié des huitième ou neuvième Fonds européens de développement (FED), le Burundi, lui, en était encore à sa deuxième phase. Les décaissements restaient faibles. Ce qui rend difficile la mise en œuvre effective des projets prévus.
D’après M. Ndikumana, cette lenteur a des conséquences directes sur les infrastructures, l’énergie, la santé, l’eau, l’internet et même sur l’approvisionnement en carburant. Il estime que ces projets auraient pu renforcer la production nationale et contribuer à améliorer les recettes en devises et si les financements avaient été correctement utilisés.
Il considère que les causes principales de cette situation résident dans « la corruption et le clientélisme » qui gangrènent la gestion publique.
Pour lui, il est urgent de restaurer la crédibilité du pays à travers une gouvernance axée sur les résultats. Il plaide pour un recrutement transparent et compétitif des cadres chargés de la gestion des projets, qu’ils soient nationaux ou étrangers, en vue de garantir l’efficacité et la rigueur dans l’exécution des programmes.
L’économiste estime également que le Burundi doit reconnaître qu’il a encore « besoin de l’aide publique au développement pour son démarrage » afin de financer ses projets d’infrastructures et soutenir sa croissance. Il rappelle qu’au sein du budget de l’Etat, une rubrique consacrée aux appuis-projets prévoit plus de 1 300 milliards de FBu.
Il juge indispensable d’améliorer la note du pays dans le rapport de l’évaluation des politiques et des institutions nationales (CPIA) de la Banque mondiale, en travaillant sur les critères de gouvernance et de gestion des institutions publiques.
Gabriel Rufyiri : « Ce problème découle avant tout d’une gestion politisée des projets »
 Le président de l’Olucome estime que la faible exécution des projets financés par les partenaires au développement s’explique principalement par l’incapacité d’absorption au sein des structures chargées de leur mise en œuvre.
Le président de l’Olucome estime que la faible exécution des projets financés par les partenaires au développement s’explique principalement par l’incapacité d’absorption au sein des structures chargées de leur mise en œuvre.
Selon lui, ce problème découle avant tout d’une gestion politisée des projets. Il déplore que des postes de responsabilité soient confiés à des personnes nommées pour leur appartenance politique plutôt que pour leurs compétences.
Gabriel Rufyiri insiste sur la nécessité de recruter sur base des compétences et de l’expérience professionnelle. Il cite en exemple le mode de sélection pratiqué à l’Office burundais des recettes (OBR).
Kefa Nibizi : « Le clientélisme mine la gestion des projets »
 Le président du parti CODEBU déplore l’incapacité du gouvernement à exploiter les aides extérieures alors que le pays manque cruellement de devises. Il estime que cette situation traduit un manque de volonté et d’efficacité dans la conduite de l’action gouvernementale. Selon lui, les autorités se limitent trop souvent à des discours alarmistes au lieu de proposer des solutions concrètes et progressives pour améliorer la gestion des fonds.
Le président du parti CODEBU déplore l’incapacité du gouvernement à exploiter les aides extérieures alors que le pays manque cruellement de devises. Il estime que cette situation traduit un manque de volonté et d’efficacité dans la conduite de l’action gouvernementale. Selon lui, les autorités se limitent trop souvent à des discours alarmistes au lieu de proposer des solutions concrètes et progressives pour améliorer la gestion des fonds.
Il évoque également des difficultés liées au système de cogestion entre le gouvernement et les bailleurs, où certains décaissements sont retardés faute d’autorisations rapides.
Une autre cause réside, selon lui dans le manque de réalisme dans la conception des projets souvent élaborés pour plaire plutôt que pour répondre aux besoins concrets du pays. Ce qui rend leur exécution difficile dans les délais prévus.
Le président du Codebu estime que les conséquences sont graves : retard du développement, aggravation de la crise économique et accentuation de la carence en devises.
Il appelle le gouvernement à analyser en profondeur les causes de ces blocages, à renforcer la rigueur dans le recrutement des cadres des unités de gestion et à s’inspirer des pays performants pour améliorer le taux de décaissement.
Olivier Nkurunziza :« Certains responsables privilégient l’enrichissement personnel »
 Le président de parti Uprona estime que l’incapacité à absorber les financements extérieurs découle du recours à des critères partisans dans la nomination des responsables des projets. Ces responsables sont souvent recrutés parce qu’ils sont militants du parti au pouvoir et non pas parce qu’ils sont capables de suivre rigoureusement les consignes des bailleurs ou de gérer correctement les projets.
Le président de parti Uprona estime que l’incapacité à absorber les financements extérieurs découle du recours à des critères partisans dans la nomination des responsables des projets. Ces responsables sont souvent recrutés parce qu’ils sont militants du parti au pouvoir et non pas parce qu’ils sont capables de suivre rigoureusement les consignes des bailleurs ou de gérer correctement les projets.
Il déplore que certains responsables privilégient l’enrichissement personnel aux dépens de l’exécution efficace des programmes en ignorant les besoins concrets de la population. Selon lui, cette situation est renforcée par le dysfonctionnement du marché public, les lourdeurs administratives et la corruption, qui ont freiné la mise en œuvre des projets depuis plusieurs années.
Pour M. Nkurunziza, il est essentiel que le gouvernement recrute des personnes de valeur, compétentes et honnêtes, indépendamment de leur appartenance politique. Il estime nécessaire de former ces responsables et de remplacer sans tarder ceux qui ne sont pas à la hauteur, afin d’éviter la perte des financements vitaux.
Le président de l’UPRONA estime que ces mesures sont essentielles pour accélérer les projets et assurer que les fonds profitent réellement aux Burundais.
Analyse de Jean Ndenzako : « Le faible taux de décaissement traduit un double blocage administratif et politique. »
Comment expliquez-vous le faible taux de décaissement des projets financés par la Banque mondiale au Burundi ?
 Ce faible taux traduit un déséquilibre profond entre les ambitions affichées des programmes de développement et la réalité institutionnelle du pays. Le problème ne se limite pas à la lenteur bureaucratique. Il touche à la gouvernance publique, à la faiblesse de la planification et à une perte de crédibilité vis-à-vis des bailleurs.
Ce faible taux traduit un déséquilibre profond entre les ambitions affichées des programmes de développement et la réalité institutionnelle du pays. Le problème ne se limite pas à la lenteur bureaucratique. Il touche à la gouvernance publique, à la faiblesse de la planification et à une perte de crédibilité vis-à-vis des bailleurs.
Quels sont les principaux freins sur le plan administratif ?
Le premier frein, c’est la gouvernance administrative. Le système public burundais reste marqué par une centralisation extrême : chaque décision, qu’il s’agisse d’un appel d’offres ou d’une nomination, doit remonter très haut dans la hiérarchie.
Cette verticalité ralentit tout le processus de mise en œuvre. Les retards dans la signature des conventions, les changements fréquents de ministres ou de directeurs, et la faible autonomie des unités de gestion bloquent l’exécution des projets. Souvent, les fonds sont disponibles, mais les conditions administratives locales pour les mobiliser ne le sont pas.
Qu’en est-il de la capacité institutionnelle ?
Elle demeure très fragile. Les unités de gestion des projets manquent de compétences techniques, de personnel qualifié et d’outils modernes.
Les spécialistes en passation de marchés ou en suivi-évaluation sont rares et souvent attirés par de meilleures opportunités dans les ONG ou les agences internationales. Cette instabilité du personnel nuit à la continuité et compromet l’application rigoureuse des procédures exigées par la Banque mondiale.
Et sur le plan politique, quel rôle joue la relation entre l’Etat et les bailleurs ?
La dimension politique est déterminante. Depuis la crise de 2015, la méfiance entre l’État et les bailleurs s’est accentuée. Certains décaissements ont été suspendus ou ralentis par précaution, faute de garanties sur la transparence et l’utilisation des fonds.
La politisation de l’administration et le favoritisme dans l’attribution des marchés publics ont également sapé la confiance. La Banque mondiale exige des audits indépendants et des preuves de conformité, mais leur validation traîne souvent dans les circuits administratifs. Ce qui retarde encore les paiements.
Les projets de la Banque mondiale sont-ils bien intégrés dans les priorités nationales ?
Beaucoup de projets sont conçus avec une forte composante technique, mais aussi avec une faible intégration dans les priorités réelles du pays. Certains ministères les perçoivent comme des initiatives imposées de l’extérieur plutôt que comme des instruments de politique publique nationale.
Cela entraîne une faible appropriation, un manque de coordination et un suivi limité après le lancement.
Comment résumeriez-vous la situation actuelle ?
Le Burundi se trouve face à un double verrouillage : administratif et politique. Le pays dépend de l’aide extérieure mais peine à absorber les financements disponibles, à cause de la rigidité des circuits internes, du manque de contrôle budgétaire et de la coexistence de plusieurs systèmes de gestion qui ne communiquent pas entre eux.
Tant que la gouvernance ne sera pas plus transparente, que la chaîne de décision restera politisée et que les capacités d’exécution ne seront pas renforcées, les décaissements continueront à stagner malgré la disponibilité des fonds.







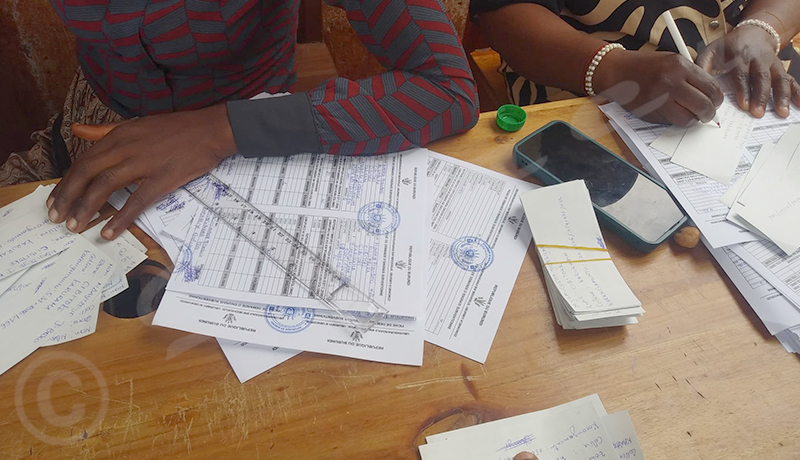











Si j’étais ce ministre, je dirais clairement que nous sommes incapables de gérer les aides et appuis financiers que nous recevons de la part de nos partenaires externes. Et dire pourquoi nous sommes dans cette incapacité. Et surtout pourquoi nous persistons à laisser pourrir la situation. Il y a vraiment un laisser aller qui ne semble pas gêner les autorités.
Ngira biragoye kurya ibiturire kuri ayo mahera ntimuronderere kure !
Le Cauchemar Bureaucratique Burundais : Quand l’État S’auto-Asphyxie
Le Burundi vit un paradoxe tragique : malgré d’importantes promesses de financements internationaux, le pays reste englué dans la pauvreté, victime de ses propres dysfonctionnements. Le cas emblématique de la fusion Environnement/Agriculture n’est que la partie émergée d’un iceberg de blocages administratifs et politiques qui frappe tous les secteurs clés du développement. La fusion contestée du Ministère de l’Environnement avec celui de l’Agriculture a créé une situation kafkaïenne : les projets environnementaux financés par des bailleurs comme la Banque Mondiale se retrouvent pris en étau entre des compétences diluées et des procédures opaques. Un projet de préservation de la biodiversité de 10 millions de dollars est ainsi resté bloqué pendant 18 mois, les fonds gelés dans les méandres bureaucratiques d’un ministère absorbant qui privilégie les impératifs agricoles à court terme.
Le Secteur de la Santé : Une Hémorragie Silencieuse
Dans le domaine sanitaire, la tragédie est particulièrement criante. Un financement de 15 millions de dollars du Fonds Mondial pour la lutte contre le VIH et le paludisme est resté partiellement gelé pendant deux ans. La cause ? Un conflit de compétences entre le Ministère de la Santé Publique et l’Office National des Pharmacies, chacun revendiquant la gestion des achats de médicaments. Pendant ce temps, des centres de santé manquaient de tests de dépistage et de traitements antirétroviraux, contraignant des patients à interrompre leur thérapie.
L’Éducation Nationale : Une Génération Sacrifiée
Le système éducatif burundais illustre également cette paralysie. Un programme de 20 millions de dollars de la Banque Mondiale pour la construction de salles de classe et la formation des enseignants a connu des retards considérables. La superposition des structures – le Ministère de l’Éducation, l’Institut de Statistiques et l’Office des Équipements Scolaires – a créé une impasse. Chaque entité exigeait son approbation préalable, et les comités de pilotage se réunissaient sans parvenir à des décisions, les représentants de chaque institution défendant des procédures incompatibles.
Les Infrastructures Routières : Des Projets en Impasse
Dans le domaine des infrastructures, le tableau est tout aussi sombre. Un projet crucial de réhabilitation de la route RN3, financé à hauteur de 50 millions de dollars par la Banque Africaine de Développement, a été suspendu pendant 18 mois. Le conflit opposait le Ministère des Infrastructures, l’Autorité de Régulation des Transports et l’Agence Burundaise des Travaux Publics, chacune contestant les prérogatives des autres en matière d’appels d’offres et de supervision des travaux. Sur le terrain, cette paralysie institutionnelle se traduisait par la dégradation continue d’un axe vital pour l’économie nationale.
Le Cercle Vicieux de l’Inertie
Ces exemples sectoriels révèlent un schéma récurrent : la prolifération d’entités aux compétences chevauchantes, l’absence de mécanismes de coordination efficaces, et la politisation des processus décisionnels. Les donateurs, confrontés à cette opacité, durcissent leurs conditions et multiplient les contrôles, ce qui ralentit davantage les décaissements. Dans le même temps, les responsables burundais dénoncent la lourdeur des procédures des bailleurs, créant un dialogue de sourds.
Une Urgence de Gouvernance
La solution à ce cauchemar bureaucratique ne réside pas dans de nouveaux financements, mais dans une réforme profonde de la gouvernance. Il devient urgent de clarifier les compétences de chaque institution, d’instaurer des mécanismes de coordination contraignants, et de dépolitiser la gestion des projets. Sans cette cure de désintoxication administrative, le Burundi continuera à s’appauvrir sur une montagne de fonds inaccessible, et sa population à payer le prix fort de l’inefficacité de son État.
Quelles solutions pour briser le cercle vicieux de la faible absorption ?
En définitive, la faible absorption des financements est bien plus qu’un simple problème de gestion ; c’est le symptôme d’une faillite de la gouvernance. Un cercle vicieux se met en place : la politisation des décisions entraîne une instabilité administrative et une mauvaise allocation des ressources, ce qui génère une prolifération de systèmes opaques et paralyse le contrôle budgétaire. Ce manque de transparence dissuade à son tour les bailleurs et bloque les décaissements, justifiant une politisation encore plus accrue de l’accès aux ressources restantes. Briser ce cycle nécessite des réformes systémiques, comme le renforcement des capacités de gestion au sein des administrations, l’appui aux réformes sectorielles plutôt que la création de structures parallèles, et l’alignement de l’aide sur des objectifs de transparence et de redevabilité mesurables. Sans une gouvernance plus transparente et une chaîne de décision dépolitisée, les fonds disponibles continueront de stagner, indépendamment des besoins pressants des populations.
La raison
Promotion de la médiocité.
Baha akazi ceux qui ont milité au lieu de recruter les compétents.
1. Vous ecrivez:« M. Ndikumana estime que cette situation découle avant tout d’une mauvaise identification des projets beaucoup étant conçus sans hiérarchiser les priorités nationales. « Certains projets sont lancés sans tenir compte de leur véritable impact sur le développement du pays ».
2. Mon commentaire
c’est vraiment scandaleux et incomprehensible apres tant de fora organises depuis des annees sur le developpement socio-economique du Burundi.
A QUOI ALORS SERT CE MINISTRE DU BUDGET?
Est-ce que la planification se ferait a la Presidence de la Republique?
Si le Burundi est classe parmi les derniers pays dans le monde (en tenant compte du produit interieur brut (PIB) par habitant), C’EST VRAIMENT DE NOTRE FAUTE, C’EST DU A NOTRE PROPRE INCOMPETENCE.
NTIDUKATE ISHAVU KUBAKOLONI BAVUYE MUBURUNDI KERA CANKE KUNTWARO ZARI ZIHARI IMBERE Y’IMYAKA 20 ISHIZE.
Absolument!Ubukene ni twebwe nyene tubwitera uhereye ku mvyaro zitagira urugero.None iminwa mishasha ica ifungura ibivuye hehe ko dufise amatongo aguma agenda yaga kubera kurwira kwacu ningoga hanyuma n’amashuri yotwigishije guca ubwenge tugaca tuburiramwo vyose.Ingorane yambere mu gihugu cacu ni surpopulation des familles et par conséquent surpopulation du pays.Iyo imfungurwa mu ngo zidakwiriye ku mugabo no kumugore imbere yuko bavyara none bongeyeko abana bica bigenda gute?Ubwo bujuju bwo kutumva ko la production d’enfants dans un ménage déjà pauvre ne fera que rendre encore plus pauvre.Planifions dans nos familles et ensuite uwo mu ministre du budget pourra aussi planifier!Ntaco yo planifia avec les petits moyens mis à dispositions alors que les naissances continuent d’augmenter en désordre.Le premier problème du burundi c’est son taux de natalité hors contrôle.Nta gihugu na kimwe cigeze gitera imbere sans commencer par contrôler les naissances!Iminwa myinshi ikenera imfungurwa nyinshi,amashuri,kuvurwa n’ibindi tudafitiye uburyo turavye ingene tuvyara tunyarutsa.
@Gasongo, soma neza ivyanditswe muri iyi article, ni kibazo co gukoresha amahera y’imfashanyo. Kutavyara ku rugero bihuriye he no kudashobora gukoresha amafaranga ategekanijwe ?
@Happy.
Mugabo rero n’aho umucecekesha ivy’avuga si ibintu vyoroshe.
1. Wiyumvire nk’umuryango urimwo abana bane aho Reta ariyo bitezeko iriha iyo abo bana bavukiye mubitaro, iyo biga mumashuri kandi abavyeyi atanico bashobora gushora mw’isoko kugirango komine ironkemwo namake y’ikori.
Hanyuma tugasigara gusa twidodomba ngo USAID yakuye imfashanyo yahora itanga mugisata c’amagara mu Burundi.
2. « À Singapour, la politique des deux enfants, mise en place jusque dans les années 1980, s’appelait « Stop at Two »… »
https://fr.wikipedia.org/wiki/Politique_des_deux_enfants