Exclusion, discrimination, entrave aux libertés publiques, retour au « monopartisme » … Voilà le tableau que dressent certains responsables politiques, trente-deux ans après l’assassinat du président Melchior Ndadaye, héros de la démocratie. Ils regrettent que la commémoration peine à mobiliser la population.
Contrairement aux années précédentes, la célébration du 32ᵉ anniversaire de l’assassinat du héros de la démocratie et de certains de ses proches collaborateurs a été segmentée. Elle a débuté par le dépôt de gerbes de fleurs par le couple présidentiel sur la tombe des Martyrs de la Démocratie, en présence des hauts dignitaires et de la famille du défunt président.
Une messe en mémoire de Ndadaye et de ses compagnons a été dite à la cathédrale Regina Mundi de Bujumbura. Dans son homélie, Mgr Gervais Banshimiyubusa, Archevêque de Bujumbura, a rappelé que « L’héritage que Melchior Ndadaye nous a légué reste d’actualité ».
Il a invité les Burundais à préserver cet héritage démocratique, en promouvant le respect de la dignité humaine, la paix et le développement. « Que nous le voulions ou non, nous sommes tous complémentaires ; nous partageons la vie, la souffrance et la mort. »
Selon lui, ce qui est arrivé au président Ndadaye fut l’œuvre d’un petit nombre de personnes, mais ses conséquences ont frappé tout le pays. Il a alerté les fidèles sur les effets destructeurs du mal, de l’injustice et de la discrimination, rappelant que « cela constitue la racine de tous les maux ».
Retour au palais des martyrs

En l’absence du couple présidentiel et d’autres hauts dignitaires, la famille du feu président Melchior Ndadaye et d’autres proches ont déposé des gerbes de fleurs sur les tombes des illustres disparues, à l’issue de la messe.
Les familles regrettent l’organisation dispersée de la commémoration qu’elles jugent de moins en moins marquante. « Que les premiers honneurs soient réservés à feu président Melchior Ndadaye, nous ne nous y opposons pas, mais la présence du chef de l’État aux côtés des familles des disparus serait beaucoup plus réconfortante. »
Elles réclament la présence de toutes les hautes autorités du pays lors du dépôt des gerbes de fleurs sur les tombes des compagnons de lutte du Héros de la Démocratie.
De leur côté, les citoyens, militants du parti Frodebu ou non, fustigent le manque d’engouement pour cette commémoration. Ils affirment être de plus en plus écartés et oubliés lors de ces cérémonies. « Pendant les dernières commémorations, il y avait une forte mobilisation. Les bus de l’Otraco étaient déployés pour transporter la population vers les lieux des cérémonies. »
Les familles des disparus et les militants du Frodebu en appellent à l’unicité des cérémonies.
Réactions
Agathon Rwasa : « Au Burundi, la démocratie est mort -né »
« Je ne pense pas qu’on n’ait jamais connu la démocratie au Burundi. Elle est mort-née », analyse Agathon Rwasa, figure de l’opposition burundaise. Selon lui, beaucoup entretiennent une fausse idée selon laquelle la démocratie serait apparue en 1993.
« Certains peuvent croire que c’était l’œuvre du Frodebu. Mais, la démocratie avait déjà jeté ses racines dans les années 1958, lorsque le Burundi cherchait à acquérir son indépendance. Néanmoins, cela n’a pas duré, car le sectarisme a empêché son épanouissement. »
 Pour cet opposant, certains ont abordé la politique par avidité du pouvoir, ne voyant dans la démocratie qu’un moyen de remplacer les colons, tandis que d’autres, nostalgiques d’un passé glorieux ou non, ont tout fait pour se hisser dans les rouages de l’administration publique.
Pour cet opposant, certains ont abordé la politique par avidité du pouvoir, ne voyant dans la démocratie qu’un moyen de remplacer les colons, tandis que d’autres, nostalgiques d’un passé glorieux ou non, ont tout fait pour se hisser dans les rouages de l’administration publique.
Il rappelle qu’en 1966, après le fiasco électoral de 1965, un coup d’état a aboli la monarchie au profit d’une République qui a plongé le pays dans un cycle de malheur : tueries, massacres, exils, …
« Et voilà qu’en 1993, après la constitution de 1992, on adopte tant bien que mal un système multipartite de façade. Ce n’était pas vraiment l’épanouissement des partis politiques, mais plutôt des regroupements d’intérêts individualistes et sectaires. »
Les conséquences, selon M. Rwasa, ne se sont pas fait attendre. Il cite l’assassinat du président Ndadaye, un acte « sans aucune justification ».
« En cent jours, on ne pouvait même pas encore l’évaluer. Et l’on se souvient que, juste après les législatives, certains disaient que ce n’était pas la démocratie qui avait gagné, mais le tribalisme. »
Même après l’Accord d’Arusha, déplore-t-il, « l’intolérance politique est restée de mise, surtout de la part des dirigeants ». Ce qui, selon lui, ne saurait rimer avec la démocratie.
« Avec ce qui vient de se passer récemment, même le peu de semblant de démocratie qu’on croyait avoir a disparu. Nous sommes dans un monopartisme de fait. Même au sein, le débat contradictoire n’est pas bienvenu. Bref, l’état des lieux de la démocratie au Burundi est lamentable. »
Et d’interpeller les Burundais : « Si nous devons parler de démocratie, c’est quelque chose que nous devons apprendre à conquérir, d’abord en nous acceptant mutuellement comme Burundais, en mettant de côté tout sectarisme et toute partisannerie. C’est à ce seul prix que le Burundi pourra devenir démocratique. »
Selon lui, les Burundais sont aujourd’hui victimes du sectarisme. Or, insiste-t-il, « une démocratie qui ne garantit pas les libertés fondamentales de chacun n’en est pas une ». Il propose que les autorités rétablissent une commémoration respectueuse, donnant aux familles et aux citoyens la visibilité et la dignité qui leur sont dues.
Léonce Ngendakumana : « Le processus démocratique vacille tant que les partis ne visent pas réellement à prendre le pouvoir et à transformer la société »
Selon l’ancien président de l’Assemblée nationale, les partis politiques burundais sont affaiblis et ne fonctionnent pas pleinement comme de véritables acteurs démocratiques.
Il explique que le pluralisme est né avec l’avènement de la démocratie, mais que celle-ci a été acceptée à contrecœur, et que plusieurs partis se sont résignés ou réduits à de simples « demandeurs d’emploi ».
 Pour lui, le processus démocratique vacille tant que les partis ne visent pas réellement à prendre le pouvoir et à transformer la société.
Pour lui, le processus démocratique vacille tant que les partis ne visent pas réellement à prendre le pouvoir et à transformer la société.
Il rappelle que toutes les institutions et responsables élus doivent reconnaître que leur légitimité découle de l’héritage de Melchior Ndadaye dont le sacrifice a permis le multipartisme et l’émergence de la société civile. Il déplore que certaines commémorations soient organisées de manière dispersée et que le discours de Ndadaye n’ait pas été écouté. Ce qui contribue à l’affaiblissement de la mémoire nationale.
M. Ngendakumana appelle les partis politiques à s’unir et à exiger un dialogue avec le gouvernement afin de rassembler le peuple burundais autour de l’unité et de la cohésion, conformément à l’héritage de Ndadaye et de Rwagasore. Il souhaite que ces journées commémoratives servent de base à la « refondation de la Nation ».
Sylvestre Bikorindagara : « L’état actuel de la démocratie est très préoccupant »
Selon le porte-parole du parti Frodebu, la démocratie repose sur quatre principes fondamentaux : la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire ;
la reconnaissance par le gouvernement des droits et libertés de la population ;
le multipartisme ; et l’égalité civique permettant à chaque citoyen de participer à la vie du pays.
 Pour lui, l’état actuel de la démocratie est très préoccupant. Il affirme que si le président Ndadaye revenait aujourd’hui, il se demanderait si son sacrifice a réellement servi la cause démocratique, car depuis son assassinat, la démocratie a fortement reculé.
Pour lui, l’état actuel de la démocratie est très préoccupant. Il affirme que si le président Ndadaye revenait aujourd’hui, il se demanderait si son sacrifice a réellement servi la cause démocratique, car depuis son assassinat, la démocratie a fortement reculé.
D’après M. Bikorindagara, les seules élections véritablement démocratiques après l’Accord d’Arusha furent celles de 2005. Depuis, le parti au pouvoir agit comme s’il pouvait s’approprier des biens de l’État prouvant ainsi qu’il n’a pas compris le sens de la démocratie.
Il rappelle que certains élus ont été renvoyés de l’Assemblée nationale pour avoir refusé de voter selon les directives de leurs supérieurs, ce qu’il considère comme une dérive antidémocratique.
Selon lui, les scrutins postérieurs à 2005 ont été entachés de fraudes et de manipulations. La révision constitutionnelle de 2018 a encore renforcé le pouvoir présidentiel limitant ainsi le contrôle populaire.
M. Bikorindagara souligne également que des partis de l’opposition ont été exclus des Élections législatives et communales de 2025. Il dénonce les conditions imposées aux candidats, notamment les cautions financières élevées ainsi que l’empiètement du CNDD-FDD sur les structures administratives locales, en contradiction avec les principes d’égalité et de neutralité.
Il estime que la manière dont les commémorations des héros de l’indépendance et de la démocratie sont organisées illustre ce recul démocratique.
Selon lui, ces cérémonies sont conduites à la hâte, le discours du président Ndadaye n’est plus écouté et la population est marginalisée. Une preuve, selon lui, que la démocratie au Burundi s’effrite.
Olivier Nkurunziza : « La démocratie au Burundi traverse une crise profonde »
Le président du parti Uprona estime que la démocratie burundaise traverse une crise profonde.
Il affirme qu’après les élections de 2010, le pays a connu une régression marquée : les scrutins n’étaient plus libres ni transparents.
 Selon lui, les dernières élections législatives de 2025 ont été émaillées de nombreuses irrégularités : votes forcés, résultats manipulés, voix de l’opposition transformées en faveur du parti au pouvoir et absence de contrôle des mandataires.
Selon lui, les dernières élections législatives de 2025 ont été émaillées de nombreuses irrégularités : votes forcés, résultats manipulés, voix de l’opposition transformées en faveur du parti au pouvoir et absence de contrôle des mandataires.
Ces pratiques, dit-il, traduisent la mort de la démocratie et l’affaiblissement des institutions chargées d’en garantir la transparence.
M. Nkurunziza déplore également la corruption grandissante et l’injustice qu’il considère comme des signes d’une démocratie défaillante.
Il souligne que le pouvoir du CNDD-FDD est souvent perçu comme un instrument d’enrichissement personnel, alors que les valeurs fondamentales de justice, de pluralisme et de respect des droits humains sont bafouées.
Il met en garde contre une tendance au parti unique, qu’il qualifie d’antidémocratique et contraire à l’esprit du multipartisme instauré par l’Accord d’Arusha.
Le président de l’Uprona critique aussi la manière dont les autorités commémorent les héros nationaux. Il évoque un « complexe » face à l’héritage du président Melchior Ndadaye et du prince Louis Rwagasore.
M. Nkurunziza regrette que ces cérémonies soient désormais organisées en ordre dispersé, sans la participation unie de la population et des diplomates, et sans diffusion des discours de ces figures historiques. « Honorer réellement ces héros ne consiste pas seulement à organiser une célébration annuelle, mais aussi à appliquer leurs idéaux au quotidien : lutter contre la corruption, renforcer la démocratie, respecter les droits humains et promouvoir l’unité nationale. »
Il insiste sur la nécessité d’inculquer ces valeurs dès le plus jeune âge afin qu’elles deviennent un véritable mode de vie pour les générations futures.
Kassim Abdoul : « Des réflexes dignes des pouvoirs autocratiques »
 Le président de l’UPD-Zigamibanga, Kassim Abdoul, dénonce une dérive autoritaire et la dégradation progressive des principes démocratiques depuis l’assassinat du président Ndadaye.
Le président de l’UPD-Zigamibanga, Kassim Abdoul, dénonce une dérive autoritaire et la dégradation progressive des principes démocratiques depuis l’assassinat du président Ndadaye.
« Depuis l’assassinat du président Melchior Ndadaye, tous ces principes se sont graduellement dégradés, au point qu’il est difficile de définir la trajectoire que prend notre pays. »
Il fustige des emprisonnements abusifs, la corruption à grande échelle et la mauvaise gestion du trésor public, signes, selon lui, de « réflexes dignes des pouvoirs autocratiques ».
Kassim Abdoul appelle à une évaluation non partisane et invite les Burundais à « intérioriser davantage les valeurs de la démocratie pour un développement harmonieux du pays ».
Enfin, il déplore la désacralisation des commémorations de Ndadaye et Rwagasore, désormais vidées de leur esprit d’unité nationale.
« Autrefois, ces cérémonies étaient des moments de cohésion et de fierté. Aujourd’hui, elles se vident de leur sens. »
Jean de Dieu Mutabazi : « Tout n’est pas rose »
 Le président du Radebu, Jean de Dieu Mutabazi, salue en Melchior Ndadaye « un véritable combattant pour la démocratie » dont l’héritage reste « une tache indélébile dans la mémoire des Burundais ».
Le président du Radebu, Jean de Dieu Mutabazi, salue en Melchior Ndadaye « un véritable combattant pour la démocratie » dont l’héritage reste « une tache indélébile dans la mémoire des Burundais ».
S’il reconnaît que le pays est désormais dirigé « par des élus, de la base au sommet », il admet que la démocratie burundaise reste fragile.
« Le droit d’expression et d’association sont une réalité au Burundi. Cependant, tout n’est pas rose. »
Mutabazi appelle à une lutte plus résolue contre la corruption et pour la bonne gouvernance, deux conditions selon lui indispensables à une démocratie solide.
« La corruption enrichit une petite minorité qui pille les richesses du pays. »
Zénon Nimubona : « On est loin de la démocratie »
 Pour Zénon Nimubona, président du Parena, la démocratie devrait être « un système fort qui protège l’individu contre la toute-puissance de l’État et de ses agents ».
Pour Zénon Nimubona, président du Parena, la démocratie devrait être « un système fort qui protège l’individu contre la toute-puissance de l’État et de ses agents ».
Or, constate-t-il, « nous en sommes encore très loin ».
Évoquant le président Ndadaye, il rappelle que ce dernier distinguait la démocratie des élections.
« Il ne doutait pas de sa victoire, mais il craignait le manque d’expérience de ses cadres et la question hutu-tutsi, qui pouvait nuire à la bonne gouvernance. »
Nimubona dénonce la persistance d’une mentalité d’accaparement du pouvoir et des biens publics.
« Certains du système ont affirmé qu’ils pouvaient même donner gratuitement l’avion présidentiel. C’est cette mentalité qui nous gouverne encore. »
Gaspard Kobako : « La démocratie burundaise traverse une phase critique »
 Le président de l’AND-Intadohoka, Gaspard Kobako, juge que la démocratie burundaise se détériore sur tous les plans : politique, économique, social et judiciaire.
Le président de l’AND-Intadohoka, Gaspard Kobako, juge que la démocratie burundaise se détériore sur tous les plans : politique, économique, social et judiciaire.
« La démocratie ne se limite pas à la tenue d’élections, mais à l’ensemble du fonctionnement des institutions et au respect des libertés publiques. »
Il dénonce la fermeture de l’espace politique et les menaces contre l’opposition.
« La tendance actuelle risque d’instaurer un monopartisme de fait. Ce qui serait dangereux pour l’avenir du pays. »
Sur le plan économique, M. Kobako évoque une économie en grande difficulté, marquée par la pénurie de carburant et de produits de première nécessité, la flambée des prix, une inflation galopante et une forte dévaluation du franc burundais. Il estime que ces problèmes structurels, aggravés par le manque de devises et de transparence dans la gestion, constituent une atteinte à la démocratie, dans la mesure où celle-ci devrait améliorer les conditions de vie des citoyens plutôt que les précariser.
Sur le plan social, le président de l’AND s’inquiète du manque de médicaments dans les structures sanitaires et du déclin du système éducatif depuis la réforme de 2016, qu’il juge mal préparée et mal accompagnée. Selon lui, la fuite des enseignants et le manque de moyens compromettent la qualité de l’éducation, pourtant essentielle au développement démocratique.
Sur le plan judiciaire, il se réfère à la rentrée judiciaire d’octobre 2025, au cours de laquelle le président de la Cour suprême a lui-même reconnu la persistance de la corruption. Il en conclut que le système judiciaire souffre d’un manque d’indépendance et de crédibilité.
M. Kobako s’inquiète enfin de la désacralisation des commémorations nationales, qu’il considère comme une tentative d’effacer la mémoire démocratique.
« Priver ces commémorations de leur sens profond revient à blesser l’âme du peuple burundais. »
Kefa Nibizi : « Le Burundi vit sous une démocratie d’apparence »
 Pour Kefa Nibizi, président du Codebu, la démocratie burundaise a été un échec dès ses débuts et « n’a jamais eu le temps de s’enraciner dans la culture nationale ».
Pour Kefa Nibizi, président du Codebu, la démocratie burundaise a été un échec dès ses débuts et « n’a jamais eu le temps de s’enraciner dans la culture nationale ».
Selon lui, le pays vit aujourd’hui sous une démocratie de façade où les institutions existent sur le papier mais non dans la pratique.
« Aujourd’hui, le Burundi vit sous une démocratie d’apparence, inscrite dans les lois et règlements, mais dominée par une dictature de fait. »
Il dénonce une mainmise totale du pouvoir sur la vie politique, des élections uniformes,
Et une population dépossédée de son rôle souverain. « La société burundaise n’a pas encore intégré les valeurs démocratiques dans son comportement quotidien. La classe dirigeante actuelle est le reflet de cette population. »
M. Nibizi appelle les citoyens à retrouver le courage de défendre leurs droits et à participer activement au renforcement des structures démocratiques.
« Tant que les citoyens n’auront pas conscience de leur rôle, la démocratie restera une simple façade, confinée aux discours officiels. »
Enfin, il déplore la désunion des cérémonies de commémoration de Ndadaye, qu’il juge contraires à l’esprit d’unité et de mémoire nationale.
Il invite le protocole d’État à clarifier cette organisation et plaide pour un retour à l’ordre antérieur, où officiels et autres groupes commémoraient ensemble, afin de redonner force et visibilité aux héros de la démocratie et de l’indépendance.

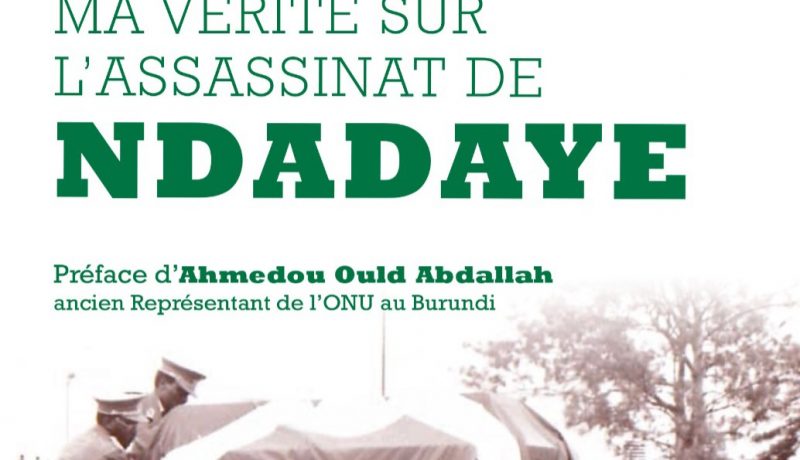
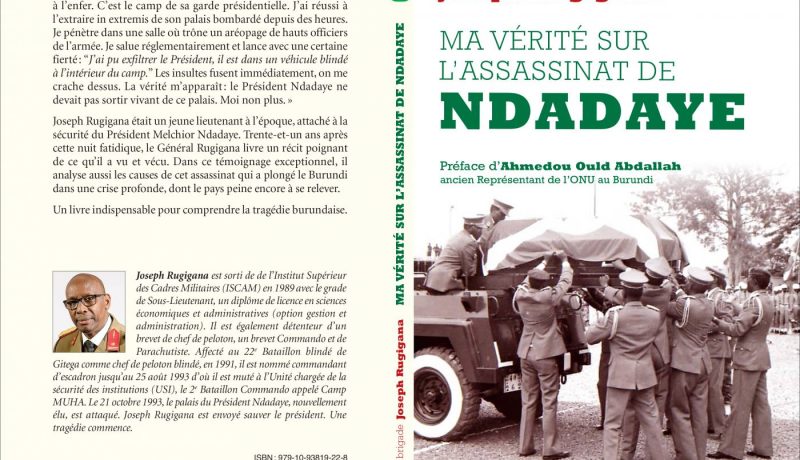








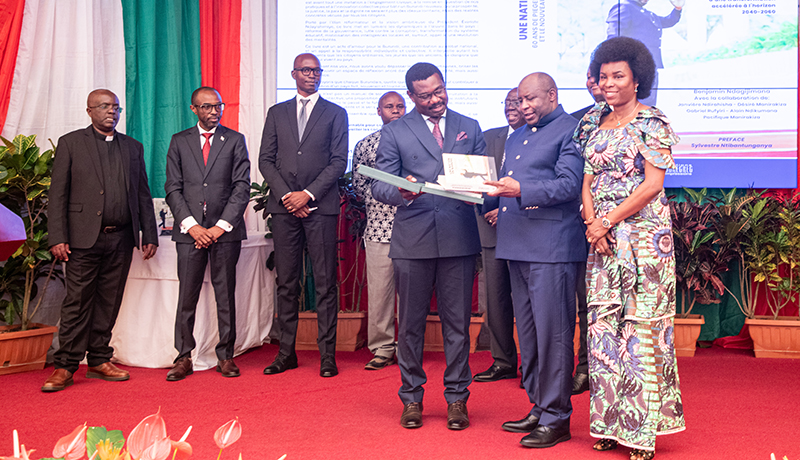








Nos régimes sont dits démocratiques, mais nous ne sommes pas gouvernés démocratiquement. C’est ce grand hiatus qui alimente le désenchantement et le désarroi contemporains.
Au Burundi, en particulier, la démocratie tend à être réduite à la simple organisation périodique d’élections. Or, de nos jours, la démocratie se mesure avant tout à l’aune des performances gouvernementales et de la qualité du lien entre gouvernants et gouvernés.
Ce lien devrait permettre l’émergence d’une autre forme de démocratie ( au-delà de la démocratie électorale): celle de l’expression citoyenne, voire de la contre-démocratie, entendue comme la capacité de la société à surveiller, critiquer et demander des comptes au pouvoir.
Assassinat de Ndadaye : 32 ans après, l’utopie démocratique. Un titre qui résume bien le paradoxe d’un rêve inabouti.
Les dirigeants actuels font tout comme dans le système colonial . Ca sert à quoi maintenant et pour qui ?
L’héritage démocratique s’effrite? Honnêtement, seriez-vous capable d’indiquer ou montrer les domaines ou les aspects de la vie nationale qui ne s’effritent pas? Nous sommes les témoins directs de l’agonie de la démocratie et l’agonie d’un état tout court. On a l’impression que les gestionnaires sont occupés ailleurs, mais surtout pas à sauver la démocratie et le pays tout entier.
Pourtant là il ne s’agit pas d’une histoire de colon blanc !!! Qu’est-ce qui se passe alors ? De quel colon s’agit-il aujourd’hui ?