Professeur d’université et observateur averti de la vie politique burundaise, Julien Nimubona livre une analyse sans détour du nouveau gouvernement récemment nommé. Dans cet entretien approfondi, il décrypte la logique de sa composition, les limites structurelles du système politique, les enjeux socio-économiques urgents, mais aussi la place réelle du chef de l’État face aux influences multiples. Pour le Pr Nimubona, l’heure est à l’efficacité concrète plus qu’aux discours. Une lecture lucide et exigeante d’un moment politique charnière.
Quelle analyse faites-vous du nouveau gouvernement ?
Je ne veux pas tomber dans le sensationnalisme des médias. Je préfère dire qu’il faut faire confiance aux acteurs et les juger à l’œuvre. C’est, selon moi, le point de départ. J’ai appris qu’au Burundi, même si l’on dispose de bons profils — je parle ici des compétences individuelles —, il faut d’abord interroger le système politique dans son ensemble. Il faut examiner la culture politique du parti dont est issu l’acteur, la culture du système hérité, ou encore celle des fonctionnaires avec lesquels, par exemple, un ministre est appelé à collaborer.
Pouvez-vous être plus précis ?
Je veux dire qu’un ministre peut être techniquement compétent, mais cette compétence peut n’être que superficielle, parce qu’il aura été évalué sur ses capacités intellectuelles dans le cadre d’une structure restreinte. Ce n’est pas parce qu’on est efficace à la tête d’un bureau stratégique ou d’une direction technique qu’on le sera automatiquement en tant que ministre. C’est un autre niveau, qui exige des qualités de leadership.
Nous avons tendance à ne mettre en avant que la compétence technocratique, en oubliant qu’elle ne vaut réellement que si elle est accompagnée de trois autres types de compétences, sans lesquelles elle reste incomplète.
Lesquelles ?
La première, c’est ce que j’appelle la compétence fonctionnaliste. Il s’agit de la capacité à comprendre et à maîtriser l’ensemble du système dans lequel on évolue : coordination des rôles, gestion des ressources humaines, maîtrise des procédures complexes… Ce ne sont plus les procédures d’une petite structure, mais celles d’un ministère ou d’un appareil d’État.
Pourquoi cette compétence est-elle souvent négligée dans les nominations ministérielles ?
Parce qu’on s’arrête trop souvent à la seule compétence technique. Or, savoir gérer une petite équipe ou une direction spécifique ne garantit pas qu’on saura évoluer dans un environnement beaucoup plus complexe, où il faut articuler plusieurs niveaux de responsabilité. La maîtrise globale du fonctionnement de l’administration est rarement considérée comme un critère central, alors qu’elle est pourtant déterminante pour l’efficacité d’un ministre.
La deuxième, c’est la compétence organisationnelle. Et cela suppose une remise en question : disposait-on seulement de compétences techniques, ou aussi d’une capacité à coordonner celles des autres ? Il existe des personnes techniquement compétentes, mais imbus d’eux-mêmes, convaincus que tous les autres sont incompétents. Or, lorsqu’on doit diriger — c’est-à-dire coordonner des directeurs généraux, des directeurs, des collaborateurs à la tête d’un ministère —, il faut respecter toutes ces personnes. Il faut reconnaître qu’elles possèdent, elles aussi, des compétences dans leurs domaines respectifs. On entre ici dans la multifonctionnalité, on sort du cadre mono-disciplinaire.
Et que manque-t-il encore pour faire un bon ministre, au-delà de ces deux premières compétences ?
Il y a enfin une troisième compétence, essentielle : celle qui est liée à la vision d’ensemble, à l’objectif poursuivi collectivement. Trop souvent, chacun se concentre sur sa « petite boîte », sans jamais avoir une vue d’ensemble du système. Mais quel est l’objectif global du gouvernement ? Où veut-on aller ? Quelle est la finalité commune ?
C’est là que l’on voit les limites d’un profil que l’on qualifie d’intelligent, de compétent, de jeune — car on met aujourd’hui en avant la jeunesse — mais qui n’a pas encore été confronté à la gestion, sur le long terme, de tout un système. On entre alors dans une logique de gouvernance à l’échelle du système politique dans son ensemble.
C’est pourquoi je préfère relativiser tout ce qu’on a mis en avant jusqu’ici : compétence technique, jeunesse, dynamisme, etc. Ce n’est pas suffisant en soi.
La jeunesse est à la mode actuellement !
On peut aussi penser que les vieilles générations peuvent avoir une culture de corrompu, etc. Mais ce n’est pas un acteur qui révolutionne un système. Parfois, le système avale l’acteur et il devient inefficace, anxieux, nerveux, et toute son intelligence s’effondre.
Il ne faut pas toujours mettre en avant la jeunesse, la compétence technique. Il faut l’évaluer à l’œuvre, surtout quand on passe de la micro-gestion à la macro-gestion, du micro-système au macro-système, qui est un ministère, qui est tout un Etat, qui demande beaucoup d’intelligence, de coordination, de leadership des autres collaborateurs.
Avez-vous tiré d’autres enseignements de la composition du gouvernement ?
Un autre enseignement que je peux tirer de cette formation gouvernementale, en me renseignant un peu, c’est que, si les sièges du pouvoir semblent être entre les mains de celui qui signe le décret — en l’occurrence, le président de la République — et c’est d’ailleurs ce que tout le monde perçoit, dans les faits, on ressent toujours la présence de groupes d’influence qui continuent à peser lourdement sur le choix des dirigeants.
Par quels signes perçoit-on cette influence ?
Cela se ressent, cela se devine, cela se voit. Et cette réalité engendre une forme de crise de confiance au sommet de l’État.Je ne souhaite pas entrer dans le détail en pointant tel ou tel ministre, mais on sent bien l’influence du Secrétaire général du parti, donc du parti au pouvoir. On perçoit également celle d’un ou de plusieurs membres du Conseil des sages, ou encore celle de certains généraux — d’un général en particulier ou d’un groupe — qui ont soutenu telle ou telle personnalité. Ce type de fonctionnement exige beaucoup de finesse, de perspicacité, notamment pour ceux qui cherchent à comprendre les mécanismes internes de formation d’un gouvernement au Burundi. Mais cela reste perceptible, surtout si l’on observe attentivement les tractations qui ont eu lieu lors des désignations à la présidence de l’Assemblée nationale ou du Sénat.
La formation du gouvernement s’inscrit dans une logique similaire.
Chez nous, pour simplifier, on appelle cela le parrainage politique. Et c’est une caractéristique majeure du parti actuellement au pouvoir.
Le président de la République a-t-il tout de même une réelle marge de manœuvre dans la formation du gouvernement ?
Le constat, c’est que le président de la République a bel et bien imprimé sa marque personnelle dans la nomination des membres du gouvernement, en particulier pour ce qui concerne les ministères régaliens.
Vous avez un exemple concret de cette influence présidentielle ?
Oui. Prenons la nomination du Premier ministre, par exemple. Il était auparavant ministre des Finances, et l’on perçoit clairement une continuité dans la stratégie budgétaire actuelle. Cette stratégie semble directement inspirée de la politique et de la vision du chef de l’État.
Il en va de même pour la désignation du nouveau ministre des Finances, notamment dans la perspective de la mise en œuvre de la Vision 2040-2060 et du fameux « budget programme » — dont on parle sans cesse. Ces choix traduisent une volonté claire d’alignement sur les grandes orientations présidentielles.
Cette logique d’alignement s’étend-elle à d’autres ministères clés ?
Absolument. On retrouve la même cohérence dans la nomination du ministre de l’Intérieur, mais aussi dans celle des ministres chargés de l’Économie, en particulier lorsqu’on observe l’articulation entre des secteurs stratégiques comme les mines et les priorités de développement économique national.
La désignation du ministre de la Justice illustre aussi cette proximité : on sait qu’il existait des relations étroites entre cette personnalité et le cabinet du président de la République. Cela confirme que les ministères régaliens restent, en quelque sorte, la chasse gardée du chef de l’État.
Il faut également évoquer le cas du ministère des Relations extérieures et de la Coopération. Le nouveau ministre vient directement du cabinet présidentiel. C’est un fait suffisamment rare pour mériter d’être souligné.
Ce portefeuille demande habituellement une grande technicité et une bonne connaissance du fonctionnement interne du ministère. Or, dans ce cas précis, ce n’est pas problématique, car il s’agit d’un ancien ambassadeur qui suivait déjà de près les dossiers diplomatiques. Il avait d’ailleurs le titre de chargé de missions auprès du président de la République lui-même.
Le gouvernement a été réduit en taille. Quel regard portez-vous sur cette décision ?
J’avais déjà exprimé des critiques lors de la précédente réduction du gouvernement.
À mon sens, il ne suffit pas d’avoir une approche purement comptable lorsqu’on compose un gouvernement. Ce n’est pas uniquement une question de nombre de ministres, mais plutôt une question de fonctionnalité et de missions assignées à cette équipe gouvernementale.
Il faut s’interroger sur les objectifs réels de ce gouvernement.
Que cherche-t-on à accomplir ?
Nous sommes à l’approche de l’échéance de 2027, c’est-à-dire des élections présidentielles.
Alors, peut-on parler d’un gouvernement de combat électoral ?
Personnellement, je ne le pense pas.
Pourquoi dites-vous que ce n’est pas un gouvernement de combat électoral ?
Si le président cherchait réellement un gouvernement de combat électoral, il aurait confirmé des technocrates ayant aussi un profil idéologique, capables de rallier du soutien à l’intérieur du parti, auprès des députés, bref, dans les sphères politiques.
Or, ce que l’on observe, c’est plutôt le choix de jeunes profils qui, certes, peuvent gérer des institutions, qui vont tenter de mettre en œuvre la Vision 2040-2060, mais dont l’efficacité, pour le moment, reste discutable.
Selon vous, la Vision 2040-2060 n’est pas mobilisatrice ?
C’est une bonne chose d’avoir une vision de long terme. Parler de la Vision 2040-2060 est louable. Mais cela reste… une vision.
Or, les Burundais vivent dans le concret, dans l’immédiat. Ce qui les préoccupe, c’est le prix du carburant, l’accès aux denrées alimentaires, les coûts du quotidien. Ils attendent des réponses tangibles, pas des promesses lointaines.
Il est important de faire rêver un pays, oui. Mais ce rêve doit s’appuyer sur une efficacité quotidienne. Et c’est précisément sur ce point que le gouvernement est attendu.
Pensez-vous qu’ils peuvent quand même relever le défi ?
Je ne vois pas, à ce stade, comment ce gouvernement parviendra à articuler deux objectifs majeurs :
D’une part, l’enjeu électoral de 2027 ; d’autre part, les attentes socio-économiques immédiates. J’ai l’impression qu’on a mis l’accent sur un discours — que je qualifierais de populiste — centré sur la Vision 2040-2060, plutôt que de se concentrer sur les enjeux concrets du moment. Et cela, c’est discutable.
On confie des ministères à forts enjeux, mais les défis sont tels qu’on peut douter de leur capacité réelle à y répondre efficacement.
Avez-vous un exemple concret de ce décalage ?
Prenons la question du développement communautaire, que l’on dissocie de celle de l’agriculture, alors même qu’on affirme vouloir faire de l’agriculture une priorité.
Face aux défis actuels — notamment la pauvreté —, il aurait été plus pertinent de concentrer les efforts dans un grand pôle de développement agricole, regroupant agriculture, élevage, environnement et développement communautaire.
Or, aujourd’hui, tout cela reste éclaté. Des projets comme le PAEEJ ou certaines coopératives relèvent, par exemple, du ministère du Développement communautaire, parfois même de l’Intégration régionale. Ce morcellement institutionnel ne facilite pas une action cohérente ni une réponse efficace aux besoins du terrain.
Quelles peuvent être les conséquences concrètes de cet enchevêtrement institutionnel que vous évoquez ?
Il existe, de toute évidence, des incohérences institutionnelles qui auront des répercussions sur le plan de l’efficacité gouvernementale.
Les fonctionnaires du précédent gouvernement le savent bien : il était déjà très difficile de gérer, dans un même ministère, la jeunesse, le sport, la culture et le développement communautaire. Les projets destinés à la jeunesse et ceux orientés vers le développement local relevaient de logiques différentes, et cette coexistence compliquait la coordination des actions.
Le développement communautaire, pourtant essentiel, est aujourd’hui relégué à un petit service rattaché au ministère de l’Intérieur. Il est désormais perçu presque uniquement sous l’angle de la sécurité ou de la gestion administrative du territoire, alors qu’il devrait être un pilier stratégique du développement national.
Par ailleurs, on observe une négligence préoccupante à l’égard du ministère de l’Industrie, du Commerce, du Tourisme, etc. Là encore, on ne perçoit pas de vision claire en faveur du secteur productif, notamment du secteur privé.
Or, cela devrait être une priorité nationale. Il faut une grande ambition, une stratégie claire, notamment autour de l’économie des services. Je pense ici aux TIC, à l’hôtellerie, au tourisme. C’est dans ces secteurs que se trouve l’avenir du Burundi. C’est dans cette direction que la vision nationale devrait s’inscrire.
Quand on forme un gouvernement — ou lorsque nous analysons cette formation —, la question centrale doit être : que cherche-t-on à accomplir ? Le but ne peut pas être de satisfaire les intérêts de petits groupes d’influence, ni de simplement arbitrer des conflits de pouvoir.
Non. Former un gouvernement, c’est porter une ambition nationale. C’est mettre en œuvre une grande vision pour le pays et pour les générations futures.
Ce n’est pas le cas aujourd’hui ?
Ce n’est pas très lisible, sauf à travers quelques ministères régaliens dont je viens de parler, quand on voit la vision 2040-2060 ou quand on voit l’histoire des budgets programmes qui pourraient justifier la nomination de deux ou trois ministres et du Premier ministre, mais les autres, on ne sent pas vraiment la cohérence globale.
Certains observateurs estiment que si ce gouvernement échoue, ce sera aussi l’échec du premier mandat du président de la République — et qu’il devrait en tirer les conséquences, voire se retirer. Qu’en pensez-vous ?
Non. Ce ne sont pas les ministres qui font le système. C’est l’ensemble du système qu’il faut interroger. Il faut comprendre où se situent réellement les centres de pouvoir.
Je me souviens d’un cas très concret : sur un dossier aussi important que la loi sur l’enseignement supérieur, que j’avais à défendre devant le Parlement, le président de la République lui-même m’a demandé : « Avez-vous consulté le patron de la documentation ? » Cela en dit long.
Trop souvent, on critique les ministres. On les accuse d’incompétence, on les traite d’imbéciles… Mais, en réalité, ils n’ont pas le vrai pouvoir. Ce ne sont pas eux qui décident. Ils ne sont pas le véritable siège du pouvoir.
C’est pourquoi il est essentiel d’analyser le système dans sa globalité.
Dans un système comme le nôtre, le parti au pouvoir devrait jouer un rôle central. Il devrait être la machine à produire non seulement les meilleures élites pour gouverner, mais surtout les meilleures idées pour guider l’action gouvernementale.
Ce n’est pas le cas du CNDD-FDD ?
Non. Cette capacité de réflexion stratégique, je ne la perçois pas au sein du CNDD-FDD. Et c’est là une difficulté majeure pour les membres du gouvernement.
C’est aussi, d’une certaine manière, le problème du chef de l’État lui-même :
Qui porte la vision ?Est-ce le parti, censé produire des élites et des idées ?Ou est-ce le chef de l’État qui, seul, doit tout impulser ?
Voilà la contradiction.Or, un chef d’État est un individu. Il ne peut pas tout faire seul.
Il a besoin d’une machine intellectuelle et politique derrière lui, d’un parti qui pense, qui structure, qui propose.
Vous insistez souvent sur la nécessité d’interroger l’ensemble du système.Comment décririez-vous le système politique burundais actuel ?
Franchement, c’est un système dysfonctionnel. Il ne repose pas sur les fondations classiques qui inspirent habituellement l’action des gouvernements dans les États modernes. Je l’ai déjà souligné : il y a un manque flagrant de cellules stratégiques de réflexion au sein des partis politiques — tous partis confondus. Et c’est ce que j’appelle, de manière générale, un manque de professionnalisme politique, en commençant par le parti au pouvoir.
Ce déficit commence dès les campagnes électorales : il n’y a ni programme de gouvernement solide, ni vision clairement construite et portée par les leaders des partis.
À quoi cela est-il dû, selon vous ?
Parce que les leaders politiques savent que la population burundaise ne vote pas pour des visions ou des programmes, mais pour des émotions. Les responsables politiques misent donc sur les sentiments, les passions, les blessures du passé, parfois même sur l’ethnisme.
Ils n’investissent pas dans une réflexion de fond sur le développement économique du pays.
Et c’est, à mes yeux, la critique centrale que l’on peut faire à notre système politique actuel.
Quels messages le CNDD-FDD envoie-t-il, selon vous, aux partenaires internationaux à travers la composition de ce nouveau gouvernement ?
Je ne perçois pas de message particulièrement clair, si ce n’est ce sentiment diffus que, enfin, le chef de l’État semble prendre les choses en main. C’est, en tout cas, l’impression que cette nouvelle composition peut donner.
Vous savez, les diplomates qui représentent leurs États au Burundi — tout comme l’opinion internationale en général — analysent la situation avec les repères de leur propre culture politique, souvent fondée sur une vision institutionnelle du pouvoir.
Dans cette lecture, le chef de l’État est le centre du pouvoir, celui qui décide.Pour eux, s’il signe les décrets de nomination, c’est qu’il a la main sur l’appareil d’État.
Mais ces acteurs ne perçoivent pas toujours les réalités profondes, les jeux d’influence, les rapports de force internes auxquels le président doit lui-même faire face.
Ils ne connaissent pas nécessairement les coulisses du système burundais, ni les groupes de pression ou de parrainage qui interviennent dans la désignation des membres du gouvernement.
Cela dit, lorsqu’on observe de près la configuration des ministères régaliens — Relations extérieures et Coopération, Intégration régionale, Finances, Économie, Justice, etc. —, on peut comprendre pourquoi les grands bailleurs de fonds ou les partenaires internationaux ont l’impression que ce gouvernement reflète la volonté directe du président.
Mais ce qui m’intéresse, au-delà de l’image, c’est la cohérence globale du gouvernement.
Et surtout, il est essentiel d’interroger les forces réelles qui ont influencé la nomination de chaque ministre, y compris dans ces ministères régaliens particulièrement scrutés.
Le transfert de l’ancienne ministre du Commerce au ministère de la Défense a suscité de nombreuses réactions. Comment interprétez-vous ce choix ?
Ce sont, selon moi, des réactions qui traduisent une culture machiste encore très présente dans notre société. Une culture où l’on pense, à tort, que les femmes ne sont pas légitimes pour diriger des ministères dits « masculins », comme celui de la Défense.
On considère encore que les femmes sont, par nature, pacifistes, qu’elles seraient incapables d’assumer des fonctions liées à la guerre ou à la sécurité nationale. C’est une vision dépassée.
Non. Les femmes sont parfaitement capables de diriger un ministère de la Défense.
Regardez la France : Michèle Alliot-Marie a été une grande ministre de la Défense, respectée et compétente, tout au long d’un mandat. Et ce n’est pas un cas isolé. D’autres pays l’ont aussi expérimenté avec succès.
Le véritable problème, ici, n’est pas qu’elle soit une femme. Ce qui interroge, c’est le parcours politique de cette personnalité. À un moment donné, notamment autour de la polémique sur les prix des denrées alimentaires, le président de la République lui-même n’appréciait plus la qualité de son travail.Dès lors, la vraie question que les se posent, c’est :Pourquoi cette personne continue-t-elle à évoluer dans les plus hautes sphères de l’État ?
Et au-delà, on peut aussi s’interroger sur la marge de manœuvre réelle qu’elle aura dans ce ministère. Car tout le monde sait que, dans ce domaine, le pouvoir est très centralisé : il est entre les mains du chef de l’État lui-même et du chef d’état-major général. Dans ce contexte, sa capacité à influer réellement sur les orientations du ministère de la Défense reste une question ouverte.
Diriez-vous alors qu’elle n’a aucun pouvoir réel à la tête du ministère de la Défense ?
Cela remonte en réalité à l’Accord d’Arusha. On le sait : selon cet accord, lorsqu’un ministre de la Sécurité publique appartient à une certaine ethnie, le ministère de la Défense revient automatiquement à l’autre ethnie.
C’est donc dans cette logique-là qu’on a sans doute cherché une personnalité tutsie, et qu’on a désigné celle-ci. Mais chacun sait que, dans les faits, le vrai pouvoir de décision en matière militaire est exercé ailleurs.
Elle jouera sans doute un rôle de façade, de caution. Elle pourrait même être associée, volontairement ou non, à des décisions qui ne viennent pas d’elle. On verra comment cela évolue.
Mais il ne faut pas pour autant tomber dans une forme de dénigrement : le fait qu’une femme soit nommée à ce poste ne devrait pas être un sujet de scepticisme en soi. Les femmes ont toute la légitimité et la compétence pour occuper de tels ministères. La critique ne doit pas porter sur son genre, mais sur le fonctionnement réel du pouvoir militaire dans notre pays.
Quels sont, selon vous, les défis immédiats que ce gouvernement devra relever ?
Le premier, c’est de changer notre rapport à la politique. Au Burundi, on adore la politique — au sens électoraliste du terme. Même les hommes politiques ne voient la politique qu’à travers les élections, les résultats, les manœuvres quotidiennes. Mais la vraie politique, c’est la vie concrète des gens.Pour le dire très simplement : le carburant.C’est cela qui permettra de relancer le fonctionnement de l’économie, de faire baisser progressivement les prix des denrées alimentaires. Le vrai défi, c’est celui-là : la lutte contre la pauvreté extrême dans laquelle vit une majorité de la population.
Je vois le président de la République insister beaucoup sur la lutte contre la corruption, sur l’éthique. C’est louable. Mais vous ne pouvez pas brandir l’éthique ou la loi face à une personne affamée.
Vous ne pouvez pas demander à un fonctionnaire, qui touche un salaire insuffisant pour se nourrir, se déplacer, soigner ses enfants ou ses parents, de respecter une éthique professionnelle sans rien lui offrir en retour. Pour un travailleur, la contrepartie, ce sont les conditions de travail.
Or, au lieu d’ouvrir une réflexion profonde sur les conditions de travail des agents publics, on préfère se focaliser sur les manquements à l’éthique. On condamne les déviances, on stigmatise. Mais c’est un combat perdu d’avance si on ne traite pas les causes structurelles.
Le véritable défi de ce gouvernement, c’est de poser les pieds sur les vrais problèmes.
Faire « remarcher » l’État, c’est d’abord remettre debout ceux qui le servent.
C’est redonner une valeur à la vie des fonctionnaires, leur permettre de vivre dignement, de faire vivre leurs familles. Et surtout, reconnaître qu’ils sont les piliers de l’État.
Revenons sur la pénurie de carburant. La situation perdure depuis plus de trois ans. On a l’impression que le gouvernement n’a toujours pas de solutions.
Il y a toujours des solutions. Le problème, c’est que ces solutions existent, sont proposées, mais le gouvernement refuse d’en tenir compte. La clé, c’est d’avoir des devises. Et pour obtenir des devises, on vous explique qu’il faut entreprendre des réformes économiques, mais aussi politiques.
Ces réformes politiques relèvent d’un minimum de bon sens : il s’agit d’ouvrir l’espace politique à l’opposition, aux autres acteurs de la vie publique, notamment à la société civile. Vous êtes chef de l’État, vous contrôlez le processus, vous avez la main sur la situation : qu’est-ce qui vous empêche de vous ouvrir ?
Quant aux réformes économiques, ce sont les partenaires du Burundi qui les réclament — et ce sont aussi eux qui vous accompagnent et vous encadrent. De plus, nous disposons de cadres compétents, intelligents, qui pourraient parfaitement avancer dans cette direction. Ces solutions macro-économiques et macro-politiques sont sur la table depuis un moment. Et pourtant, tout reste bloqué. On est figé.
Pourquoi, selon vous ?
Je ne comprends pas pourquoi nous n’avançons pas. Et l’un des grands défis, c’est précisément la capacité de notre gouvernement — à commencer par le parti au pouvoir — à s’ouvrir, à accepter les propositions des experts, à se nourrir des expériences vécues par d’autres pays dans des contextes similaires.
Pourtant, dans les discours officiels, on a l’impression que tout va bien.
C’est normal. Ils sont dans leur « rôle ». Un mauvais rôle, d’ailleurs : celui de l’autoglorification. Ils ne peuvent pas reconnaître que tout va mal, car s’ils le faisaient, on leur demanderait de partir. Il est donc logique qu’ils répètent que tout va bien « grâce à eux ». Mais ce discours a ses limites. C’est un discours mythifié, autoglorifiant, qui finit par se fracasser sur la réalité quotidienne des citoyens.
Pourquoi ce refus de s’ouvrir ?
Les élites crispées, on les connaît. Ce sont souvent des élites mal formées, qui redoutent le débat car elles ne maîtrisent pas leurs sujets. Si vous êtes vraiment compétent, pourquoi craindre la confrontation d’idées ? Voilà la première explication.
La deuxième, c’est une logique de fonctionnement sectaire, fondamentalement non démocratique. Même à l’intérieur du parti au pouvoir, par exemple le CNDD-FDD, on n’autorise pas le débat contradictoire. Et pourtant, c’est ce débat interne qui permettrait l’émergence de visions multiples, de stratégies alternatives capables de nous sortir des crises. Mais ici, cette pluralité n’est pas permise. Résultat : on ne réfléchit pas autrement, on n’accepte pas le débat, on refuse de s’inspirer des expériences extérieures.
Enfin, il y a aussi une forme de dogmatisme dans les croyances. C’est comme en religion : certaines confessions refusent d’écouter les autres. Mais gouverner, ce n’est pas exercer un culte. Gouverner, c’est gérer la vie quotidienne des gens.
Or, on sait que le parti au pouvoir a une forte dimension religieuse. Il faut pourtant apprendre à distinguer la foi — le monde des croyances éternelles, le rêve — de la réalité tangible. Les citoyens, eux, vivent dans le concret, avec des difficultés concrètes. Vous ne pouvez pas leur parler d’un paradis futur pendant qu’ils meurent aujourd’hui. À moins de vouloir les envoyer au ciel ou en enfer plus tôt que prévu, il faut d’abord leur permettre de vivre dignement, ici et maintenant.













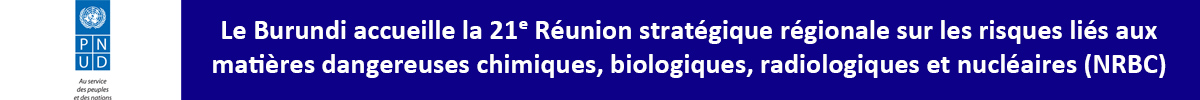







Des jeunes desesperes, les larmes aux yeux, m’ont demande si je vois un quelconque espoir pour le pays.
_ Aucun! ai-je repondu. Mobutu a detruit le pays pendant 30 ans et rien ne pouvait l’arreter. Mugabe a detruit le pays pendant 30 ans et rien ne pouvait l’arreter.
Absolument rien ne peut arreter le regime a detruire le pays pendant 30 ans.
Si le regime avait l’humilite de reconnaitre la faillite actuelle, il organiserait une conference nationale inclusive pour sauver la nation. Les eveques catholiques qui ont eu le courage de denoncer le hold-up electoral de 2020 et la mascarade de juin 2025 pourraient la presider. Seul le dialogue avec toutes les forces vives y compris la diaspora et les refugies.
Si le regime se crispe et reprend le massacre d’innocents et se remet a blamer les eternels boucs emissaires ce sera ingerable. It’s the economy stupid! Comme le dit l’excellent professeur. Tout le reste est literature.
P/S Lorsque j’ai vu le PM se courber litteralement en deux devant Neva je me suis dit qu’il ne faut rien attendre. Tout comme les autres ministres.On respecte le president mais on ne peut jamais se courber devant lui. Sinon comment va-t-il lui dire que c’est une betise de fermer les frontieres avec le Rwanda. Qu’il faut laisser le dollar floter. Que nous n’avons pas les moyens pour guerroyer au Congo.
L’analyse du professeur Julien Nimubona que je loue en passant pour avoir été un bon ministre de l’enseignement supérieur intègre , sans discrimination par exemple dans les bourses octroyées ,sur base des résultats scolaires (dans le Burundi contemporain il n’ y avait jamais eu de ministre qui travaillait au-dessus de la mêlée ethnique , clanique régionale )offre un éclairage critique et nuancé sur la situation économique et politique du Burundi, tout en soulignant les défis structurels qui entravent le développement du pays. Voici une synthèse des points clés et des implications pour la situation économique catastrophique que traverse le Burundi :
1. Un gouvernement techniquement compétent, mais limité par le système
Compétences insuffisantes : Les ministres sont souvent choisis pour leurs compétences techniques, mais manquent de leadership, de vision globale et de capacité à coordonner des systèmes complexes (compétences fonctionnalistes et organisationnelles).
Influence des groupes de pouvoir : Les nominations reflètent moins une logique de performance qu’un équilibre entre factions internes (militaires, parti au pouvoir, Conseil des sages). Le président a une marge de manœuvre limitée, notamment sur les ministères régaliens (Finances, Défense, Intérieur). Pour avoir connu les protagonistes généraux aujourd’hui au maquis et qui font la pluie et le beau temps ,mais qui n’ont aucune vision ,je doute beaucoup sur la réussite de ce gouvernement que je qualifierais d’un assemblage sans pilote à bord
2. Une économie en crise, des priorités mal alignées
Urgences ignorées : La population souffre de l’inflation, de la pénurie de carburant et de la pauvreté, mais le gouvernement mise sur des projets à long terme (Vision 2040-2060) plutôt que sur des solutions immédiates.
Morcellement administratif : Les ministères clés (Agriculture, Développement communautaire, Industrie) sont éclatés, ce qui nuit à l’efficacité. Exemple : Le développement agricole est dispersé entre plusieurs entités, freinant la lutte contre la pauvreté.
Secteur privé négligé : Aucune stratégie claire pour relancer l’industrie, le tourisme ou les TIC, secteurs pourtant essentiels pour une économie en ruine.
3. Un système politique dysfonctionnel
Absence de vision stratégique : Le parti au pouvoir (CNDD-FDD) ne produit pas d’élites compétentes ni de programmes concrets. Les campagnes électorales misent sur l’émotion (ethnisme, passé conflictuel) plutôt que sur des projets économiques. Un clientélisme sans nom au regard de ceux qui composent le Sénat ou le Parlement, tel un ancien milicien Imbonerakure recyclé en représentant du peuple, tel femme d’un général de l’armée, tel une personne liée à la première dame vraiment un concert de profils sans vision commune, Ndadaye Melchior et ses compagnons Gilles Bimazubute, …..et autres pour ne citer que ceux-là vont se retourner dans leurs tombes.Quant à la Ministre de Défense qu’elle soit une femme cela importe peu ,tous les ministres de Défense ont toujours eu des problèmes avec le Président qui considère ce poste comme lui appartenant. Colonel Sinzoyiheba Firmin alias Kagajo, et autres…. ,qu’a été leur fin avec Buyoya. Au moins Ndayishimiye est honnête sur ce point ,mettre une figurante(qui remplit les conditions minimales être d’ethnie » Tutsi »)
Refus des réformes : Les solutions existent (ouverture politique, réformes économiques avec les bailleurs), mais le pouvoir les rejette par peur de perdre le contrôle. Résultat : blocage des devises, corruption endémique, et paralysie de l’État.
Crise de légitimité : Les discours officiels (« tout va bien ») contrastent avec la réalité (misère, chômage, corruption). Les fonctionnaires, sous-payés, ne peuvent respecter l’éthique dans un système qui les étouffe.
4. Des défis immédiats non résolus
Carburant et inflation : La pénurie de carburant dure depuis 3 ans, faute de devises. Une ouverture aux réformes internationales (FMI, Banque mondiale) est nécessaire, mais rejetée par dogmatisme.
Pauvreté et salaires : Sans amélioration des revenus des fonctionnaires et des conditions de vie, la corruption et l’inefficacité administrative persisteront.
Élections de 2027 : Le gouvernement n’a pas de stratégie électorale claire, risquant un nouveau cycle de tensions.
Conclusion : Un cercle vicieux politique économique
Le Burundi est pris au piège d’un système où :
Le pouvoir est fragmenté entre le président, l’armée, et le parti, sans coordination.
L’économie s’effondre par manque de réformes et de vision pragmatique.
La population paie le prix d’une élite crispée, refusant le débat et les solutions externes.
Pour sortir de la crise, le professeur Nimubona suggère :
Une refonte du système politique : Professionnaliser les partis, accepter le pluralisme.
Prioriser l’économie réelle : Relancer l’agriculture, les industries, et les services.
Ouvrir le dialogue avec les partenaires internationaux et l’opposition pour débloquer les aides.
Sans ces changements, le Burundi risque de s’enfoncer dans une crise prolongée, avec des conséquences humanitaires de plus en plus graves. Entre temps il n’y a pas de carburant depuis trois ans, et aujourd’hui pas d’eau et électricité . Les Burundais sont devenus comme « les gazaouis, Palestine » à la seule différence , un embargo imposé par leurs propres dirigeants.
Pourquoi ils n’acceptent pas les réformes? Mais c’est clair, ils perdraient le pouvoir! Si on vous dit d’ouvrir l’espace politique et médiatique, de respecter les libertés publiques, d’expression , d’opinion,… et que vous l’acceptez, vous ne savez pas jusqu’où cela peut vous mener, un autre 2015 peut-etre, ou une défaite electorale en 2027.
Imaginez que les citoyens peuvent s’exprimer librement, sur tout ce qui ne vas pas, le carburant, les prix des denrées alimentaires de base, la militarisation/policisation de ce que l’on voit sur l’espace publique, ..les effets risquent de produire une bombe, avec des effets imprévisibles. Et puis dans un climat pareil, de transparence, ce n’est pas évident de truquer les élections!
Je dois dire que je suis profondément impressionné par la finesse herméneutique et la rigueur épistémologique de l’analyse du Professeur Julien Nimubona. C’est, à ma connaissance, le premier commentateur politique burundais à opérer, avec autant de clarté conceptuelle, la dissociation entre technocratie et compétence en matière de leadership lorsqu’il s’agit de pourvoir un portefeuille ministériel.
Au Burundi, nous sommes encore prisonniers d’un paradigme réducteur : celui qui postule qu’une accumulation de diplômes — si prestigieux soient-ils — équivaut ipso facto à une aptitude à gouverner. Or, si leadership et formation académique peuvent se nourrir mutuellement, aucun ne constitue mécaniquement le garant de l’autre. De même, l’excellence sectorielle d’un technocrate, aussi avérée soit-elle, ne saurait suffire à en faire un ministre efficace dans le secteur correspondant ; elle peut même, paradoxalement, constituer un handicap si elle n’est pas adossée à des aptitudes éprouvées de conduite d’hommes et de pilotage de politiques publiques à grande échelle.
Il faut rappeler ici que la technocratie renvoie à une compétence fonctionnelle et méthodologique dans un champ disciplinaire précis ; elle se caractérise par la maîtrise des processus, des normes et des outils techniques d’un domaine donné. Le leadership, quant à lui, excède de beaucoup cette seule compétence instrumentale : il s’agit d’une capacité à formuler une vision mobilisatrice, à fédérer des volontés divergentes autour d’objectifs communs, à arbitrer dans l’incertitude et à rendre des comptes sur les résultats obtenus. Un leader performant n’est pas nécessairement l’expert le plus pointu dans chaque dossier, mais il sait identifier, coordonner et optimiser les compétences des autres pour atteindre une finalité partagée.
C’est pourquoi la question centrale, pour quiconque nomme un ministre, ne devrait pas être : « Quel est votre diplôme le plus élevé ? » ou « Dans quel domaine avez-vous excellé ? », mais bien : « Quelle est l’architecture de votre parcours de gouvernance ? Quelles responsabilités exécutives d’envergure avez-vous exercées ? Quels résultats tangibles avez-vous obtenus dans la mise en œuvre de politiques publiques ou d’initiatives comparables ? »
L’histoire politique récente regorge d’exemples où des dirigeants n’avaient pas de compétence technique directe dans le champ ministériel qu’ils administraient, mais disposaient de l’autorité, de la vision et de l’habileté politique nécessaires pour en assurer la direction. Ainsi, au Royaume-Uni, Justine Greening, dépourvue de formation d’ingénieure, a été Secrétaire d’État aux Transports et a su conduire des arbitrages complexes entre investissements ferroviaires et aéronautiques. Aux États-Unis, Robert Gates, issu du renseignement, a dirigé avec efficacité le Pentagone, sans être un militaire de carrière, grâce à sa capacité à naviguer dans les arcanes politico-stratégiques. Ces cas démontrent que, dans un système mature, le ministre est avant tout un stratège et un chef d’orchestre, non le premier technicien de son ministère.
En conclusion, les technocrates constituent des conseillers précieux et souvent indispensables : leur expertise éclaire la décision. Mais les ériger en dirigeants politiques sans s’assurer de leurs aptitudes à incarner et piloter une vision relève d’un pari à haut risque. La technicité rassure sur le court terme, le leadership pérennise sur le long terme. C’est cette confusion originelle — entre compétence experte et compétence dirigeante — qu’il nous faut impérativement dissiper si nous voulons, un jour, sortir des impasses récurrentes de notre gouvernance.
Le leadership c’est bien, mais ne suffit pas à lui seul non plus. Car il peut n’avoir que comme objectif un intérêt particulier ou limité à un groupe. Dans ce cas ça ne marche pas non plus. D’où l’importance de l’intégrité et du sens de l’intérêt général chez un bon leader.