L’exportation de minerais du 7 octobre dernier a suscité un enthousiasme prévisible. Pour beaucoup — y compris au sommet de l’État — ces cargaisons expédiées à grand renfort de communication symbolisent le début d’une relance économique tant espérée.
Mais derrière l’euphorie des chiffres et des discours triomphants se cache une réalité plus sombre : celle d’un piège économique qui a déjà condamné de nombreux pays africains à la stagnation.
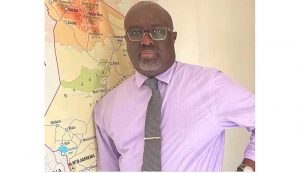
L’économiste Jean Ndenzako a raison de tirer la sonnette d’alarme : l’exportation de minerais bruts n’est pas une stratégie de développement, c’est un leurre. Un mirage qui perpétue notre dépendance et notre vulnérabilité. Les chiffres sont implacables : en vendant nos minerais à l’état brut, nous ne capturons que 10 à 20 % de leur valeur totale. Le reste — la part du lion — revient aux pays qui les raffinent et les transforment. Le coltan extrait de nos sols burundais finit dans les smartphones et ordinateurs du monde entier. Mais ce sont la Chine et l’Europe qui récoltent les bénéfices de sa transformation.
Cette logique purement extractive ne crée aucune valeur ajoutée locale. Contrairement à une industrie de transformation, elle n’établit pas de liens avec les autres secteurs, ne développe pas de compétences techniques, ne stimule ni innovation ni emploi qualifié.
C’est une économie de cueillette, figée dans un schéma de dépendance : nous vendons à bas prix ce que d’autres revendent très cher après l’avoir transformé.
Les économistes appellent cela la “malédiction des ressources”. L’histoire récente en offre de tragiques exemples : la République démocratique du Congo, malgré ses richesses minérales immenses, demeure parmi les pays les plus pauvres du monde.
Pour le Burundi, les risques sont connus et redoutables. La volatilité des prix mondiaux expose notre économie à des cycles de prospérité éphémère suivis d’effondrements brutaux. Les revenus miniers, sans institutions solides pour les gérer, risquent d’alimenter la corruption, les clientélismes et les inégalités plutôt que le développement.
Le véritable scandale n’est pas d’exporter nos minerais, c’est de les exporter sans les transformer. Au lieu de célébrer des cargaisons de minerais bruts, nous devrions bâtir des usines de raffinage, former des ingénieurs métallurgistes, investir dans une industrie de transformation.
Le Rwanda, avec la transformation du café, ou l’Éthiopie, grâce à son industrialisation légère, montrent qu’il existe d’autres voies possibles pour créer de la richesse durable.
Je ne cherche pas à jouer les rabat-joie. Je fais simplement ce que les journalistes sont censés faire : douter. Douter des évidences. Questionner l’euphorie ambiante. Regarder au-delà des apparences.
Et si ce doute dérange, tant mieux. Car c’est précisément en refusant de poser les bonnes questions qu’on transforme les opportunités en mirages — et les ressources, en malédictions.


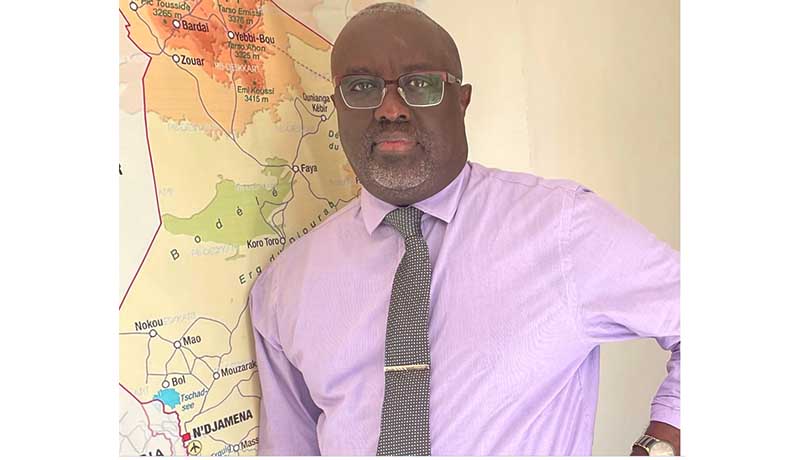








Toute chose a ses débuts. Le Burundi ne possède pas l électricité nécessaire pour faire la transformation des minerais. pour l instat c est mieux qu il vende ses minerais à l état brut pour faire entre les devises et qui va aider l état a l importations des produits de premier nécessité et aussi permettre a l industrialisation du pays.
Ce cri d’alarme veut dire qu’il fallait attendre le temps de créer les industries et de la formation des métallurgistes?
Et si on manquait des capitaux pour le faire immédiatement? Espérons que les revenus de cette première vague seront destinés au financement de ces projets avant 2040
Cher Anselme
C’est certainement un bon débat , celui consistant à savoir s’il faut d’abord avoir les capitaux afin de construire des industries de transformation ou s’il faut exporter la matière brute permettant d’avoir ce qu’il faut pour mettre sur place des industries de transformation . Je pense qu’il existe une voie sortie . L’un des freins auxquels les pays se heurtent est le refus presque inné des pays africains de ne pas travailler ensemble . Les pays comme le Burundi et le Rwanda aussi enclavés ne peuvent tirer leur épingle du jeu car en travaillant en synergie pour avoir un grand marché pour avoir un marché intérieur considérable pour l’écoulement des produits mais aussi pour attirer les investisseurs . Il est impossible pour les grandes multinationales de s’intéresser à un marché ridicule comme le notre sauf s’il s’agit d’une matière première d’une importance capitale. En travaillant en synergie les pays concernés peuvent parvenir à attirer les investisseurs. Les entreprises nationales peuvent faire du bénéfice rien qu’en vendant aux consommateurs locaux. Ce serait bien compliqué pour le seul Burundi d’y parvenir. Dans les conditions actuelles tout devient compliqué. Et si vraiment le Burundi était un ami de la Tanzanie ou de la RDC pourquoi il ne négocie pas avec ces deux pays pour permettre aux entreprises burundaises ou le peu qui en reste à s’établir dans ces pays . Un marché de 100 millions de gens en RDC ou plus de 65 millions en Tanzanie n’est pas négligeable . A titre de comparaison la France ne compte que 65 millions et l’allemagne 84 millions . Mais comme le ventre a remplacé la tête au burundi on est incapable d’avoir une reflexion aussi élementaire et en tirer une conclusion. Pauvre Burundi
La vente de minerais non transformés n’est pas seulement une perte économique : c’est une perte d’avenir.
Les États qui ne transforment pas leurs ressources se privent du levier fondamental de leur propre industrialisation et souveraineté économique. Il faut une vision à long terme passant par une véritable politique industrielle et qui associe le public et le privé.
En espérant que les 10 à 20% serviront à investir dans les ateliers de transformation. Qui vivra verra.