C’était le 20 septembre 1976, à Gisenyi au Rwanda, lorsque les chefs d’Etat Michel Micombero (Burundi), Juvénal Habyarimana (Rwanda) et Mobutu Sese Seko (Zaïre), signèrent la convention pour la création de la Communauté économique des pays des Grands lacs (CEPGL). Que reste-t-il de cette organisation ? L’économiste André Nikwigize trouve que la CEPGL, quels qu’en soient les défis actuels, reste un cadre politique stratégique important pour promouvoir la paix et la sécurité dans la sous-région des Grands lacs.
Le Burundi est membre de plusieurs organisations économiques régionales, quelle est votre analyse ?
La multiplicité des organisations économiques régionales dont le Burundi est membre, la difficulté de s’acquitter des contributions annuelles, les problèmes politiques non résolus entre les Etats membres ainsi que les faibles résultats atteints amènent à s’interroger si le Burundi a réellement évalué la pertinence d’adhérer à telle ou telle autre organisation. Après la création de l’OUA (1963), ce fut : la CEPGL (1976), le Comesa, (1981), la CEEAC, (1983), l’EAC (2007), le Secrétariat de la CIRGL (2006). Par deux fois, en 2017 et 2019, le Burundi aurait tenté de solliciter son adhésion à la SADC, mais celle-ci aurait rejeté la demande « pour cause d’instabilités politiques ».
Toutes ces organisations, ou presque, sont, aujourd’hui, paralysées. Le Burundi a accumulé d’importants arriérés de contributions. La paix et la stabilité régionales, le développement économique et les échanges, fondements de la création de ces organisations, sont tous hypothéqués. Ne serait-il pas nécessaire de se remettre en question et de repartir sur de nouvelles bases ?
Et pourtant, la CEPGL avait bien commencé pour une bonne intégration régionale ?
Les objectifs assignés à la CEPGL furent au nombre de quatre : assurer la sécurité des États et de leurs populations de façon qu’aucun élément ne vienne troubler l’ordre et la tranquillité sur leurs frontières respectives ; Concevoir, définir et favoriser la création et le développement d’activités d’intérêt commun ; promouvoir et intensifier les échanges commerciaux et la circulation des personnes et des biens ; coopérer de façon étroite dans les domaines social, économique, commercial, scientifique, culturel, politique, militaire, financier, technique, touristique, et plus spécifiquement en matière judiciaire, douanière, sanitaire, énergétique, de transports et de télécommunications.
Quelles sont les actions qui ont été menées pour arriver à ces objectifs ?
Dans ce contexte, la CEPGL créa successivement des organismes spécialisés, dont : la Banque de Développement des Etats des Grands lacs (BDEGL) basée à Goma (RDC) ; l’Organisation de l`Energie des Grands lacs (EGL) basée à Bujumbura ; l’Institut de Recherche agronomique et zootechnique (Iraz) basé à Gitega ; la Société internationale d’Electricité des pays des Grands lacs (Sinelac) basée à Bukavu en RDC.
Et en matière de paix et de sécurité ?
La CEPGL a enregistré également des succès importants pour la sous-région des Grands lacs, notamment l`organisation de plusieurs réunions de concertation. Toutefois, la région est restée marquée par une insécurité récurrente découlant de la multiplication des bandes armées de la RDC, du Rwanda et du Burundi qui continuaient à alimenter l`insécurité.
Dans les domaines économiques ?
Plusieurs réalisations furent à l`actif de l’organisation. Au niveau financier, la BDEGL avait reçu pour mission principale la mobilisation des ressources financières en vue de financer des projets de développement destinés à renforcer l’intégration économique de la sous-région. Un nombre de projets d’intégration furent financés par cette institution.
Au niveau de la recherche agronomique, l’Iraz a représenté une vraie plate-forme de coordination des Systèmes nationaux de Recherches agronomiques (SNRA) des pays membres de la CEPGL. Cet institut dont les bureaux étaient basés à Gitega au Burundi, était parvenu à de bons résultats en matière agricole (bananes, sorgho, blé, etc.)
Au niveau de l`énergie, la Sinelac et l’EGL eurent pour mission l’exploitation de la centrale hydroélectrique communautaire de Ruzizi II ainsi que la commercialisation de l’énergie produite aux trois pays membres par le biais de leurs sociétés nationales d’électricité. A ce jour, les trois pays membres bénéficient de leurs quote-part d’électricité produite par le projet. Il est question de mettre en œuvre les projets Ruzizi III et IV, mais les partenaires pour ces projets sont encore hésitants.
Les années 90 n’ont pas été faciles ?

Au cours des années 90, la CEPGL a commencé à plonger dans une période extrêmement difficile.
En octobre 1993, le Burundi entrait dans une crise profonde, en rapport avec l’assassinat du président de la République démocratiquement élu et les massacres des Tutsi qui ont suivi faisant plusieurs centaines de milliers de morts et de réfugiés. Six mois après, en avril 1994, le Rwanda entrait également dans une crise avec le génocide contre les Tutsis, qui a fait environ 1 million de Tutsi massacrés.
Ces crises plongèrent la CEPGL dans une crise sans précédent. Elle connut d`énormes difficultés, notamment le manque de soutien politique et financier des Etats membres qui ne s`acquittaient plus de leurs contributions au budget de l’Organisation ; l’absence de réunions statutaires, (Conseils des ministres ou Sommets des chefs d`Etat) ; des difficultés qui ont conduit aussi au peu d’intérêt des partenaires de développement de soutenir les projets de la CEPGL.
En 1996, avec la fuite des Forces armées rwandaises et des miliciens Interahamwe, qui venaient de commettre le génocide contre les Tutsi au Rwanda, avec leurs armes, et l’attaque par les troupes de l’Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo (AFDL), au Zaïre, tous les accords de la CEPGL furent suspendus. La dernière réunion au Sommet des chefs d’Etat date de 1994. Tous les programmes de l’organisation en accusaient le coup : la recherche agricole, l’énergie, le financement des projets, l’intégration économique et commerciale, sans parler de la paix et de la sécurité régionales.
Quid des tentatives pour sauver l’organisation ?
Elles sont restées infructueuses. En 2004, Louis Michel, alors ministre des Affaires étrangères de Belgique, invita les ministres des Affaires étrangères de la RDC, du Rwanda et du Burundi au Palais d’Egmont à Bruxelles pour discuter des modalités d’une éventuelle relance de la CEPGL. À cet effet, ils ont notamment décidé de mettre en place une Commission d’évaluation et de relance des mécanismes et instruments existants de la CEPGL en vue de faire des propositions opérationnelles, et ceci dans le cadre d’un agenda et d’un calendrier clairement définis.
Le 20 novembre 2004, à Dar-es-Salaam, les chefs d`Etat et de gouvernement de onze pays (auxquels s’est ajouté, plus tard, le Soudan du Sud), participant à la Conférence internationale sur la Paix, la Sécurité, la Démocratie et le Développement dans la Région des Grands lacs, proclamaient leur détermination collective à faire de la région des Grands Lacs un espace de paix et de sécurité durable, et ce pour les Etats et les peuples, de stabilité politique et sociale, de croissance et de développement partagés, un espace de coopération fondé sur des stratégies et politiques de convergence dans le cadre d’un destin commun. Cette proclamation de Dar-es-Salaam fut suivie, deux ans plus tard, à Nairobi, le 15 décembre 2006, par la signature du Pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la Région des Grands lacs.
D’autres initiatives ?
En 2006, à la suite de la Conférence internationale sur la Région des Grands lacs, les Etats membres s’engageaient à maintenir la paix et la sécurité, conformément au Protocole sur la non-agression et la défense mutuelle dans la Région des Grands lacs.
En février 2006, un Rapport du Sénat belge recommandait que la redynamisation de la CEPGL devrait avoir pour principaux objectifs : la promotion de la croissance économique de la région, la satisfaction des besoins essentiels des populations et le rétablissement de la confiance mutuelle entre ses États membres.
En matière de paix et de sécurité, il était recommandé que la CEPGL pouvait, tout d’abord, constituer un cadre permanent de dialogue et de négociations pour les pays des Grands lacs et contribuer à la confiance mutuelle entre les partenaires. Ainsi, pourrait-elle favoriser la coopération entre les États membres en matière de sécurité aux frontières communes. Dans cette optique, elle pourrait mobiliser les instruments existants de prévention et de gestion des conflits pour la région.
Enfin, en ce qui concerne le rôle de la Belgique, les experts recommandaient de centrer sur les trois dimensions suivantes : d’une part, poursuivre la consolidation de la paix et des processus de transition en cours dans la région ; d’autre part, assurer aux États de la région des conditions plus favorables à la conduite de leurs affaires économiques ; enfin, aider au développement socio-économique de la région.
En 2008 fut décidée une relance de la CEPGL, confirmée en août 2010, à la suite d’une rencontre entre les présidents Paul Kagame du Rwanda et Pierre Nkurunziza du Burundi.
En août 2022, les représentants des onze Etats d’Afrique centrale adoptèrent à Yaoundé le principe d’une fusion des trois zones économiques de la région. Cette décision supposait, notamment, la disparition à terme de la CEEAC, de la Cemac et de la CEPGL, au profit d’une seule et unique organisation.
Que faire pour relancer cette organisation régionale ?
Malgré toutes ces recommandations d’experts et la volonté des partenaires de soutenir la CEPGL, la situation de cette organisation régionale reste inquiétante. Les Etats membres ne contribuent plus au budget de l`organisation, les organes dirigeants ne se réunissent plus, le dernier Sommet des chefs d’Etat datant de 1994, pendant que les questions de sécurité aux frontières se posent avec acuité et qu`elles risquent de paralyser les objectifs assignés initialement à cette organisation régionale.
Quels qu’en soient les défis actuels, la CEPGL reste un cadre politique stratégique important pour promouvoir la paix et la sécurité dans la sous-région des Grands lacs, l`intégration régionale et le commerce transfrontalier, qui occupent une place prépondérante dans la réduction de la pauvreté dans les trois pays membres.
Il serait plus qu’urgent de reprendre les études élaborées et les diverses recommandations des experts pour renforcer et redynamiser cette organisation, qui, dans son temps, avait servi de catalyseur pour la restauration de la paix et de la sécurité, le développement et la prospérité régionaux dans une région affectée par des conflits et une pauvreté extrême.
Les pourparlers en cours pour la restauration de la paix et la stabilité entre la RDC et le Rwanda devraient inclure un volet de la relance de la CEPGL et assigner à cette organisation la promotion de la sécurité des Etats et des populations de la communauté.









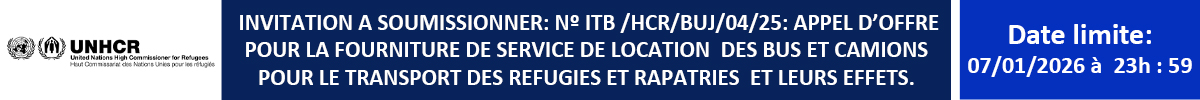






L’idée génocidaire est passée pas là . Ca ne vaut pas la peine de redonner vie à la CEPGL ni d’autres organisations regroupant les 3 pays: le Rwanda , Le Burundi et la RDC , ils ne vont jamais émettre sur les mêmes ondes . La seule alternative possible : lancer une initiative dont le but serait de déclasser les forces négatives génocidaires au Burundi et en RDC . Peut être ne faudrait il pas abattre la CEPGL pour le moment , il faudrait donner le temps en attendant que la confiance entre les 3 pays puissent être restaurée . Mais je ne vois pas comment y arriver dans les conditions actuelles.