Coopération, financement des projets, processus démocratique, liberté d’expression, crise humanitaire dans la région des Grands Lacs, assistance aux réfugiés, déplacés environnementaux…Violet Kenyana Kakyomya, Coordonnatrice Résidente du Système des Nations Unies au Burundi, s’est exprimée au lendemain de la célébration du 80e anniversaire de cette organisation.
Avec 80 ans d’existence des Nation-unies, quelle évaluation faites-vous de l’état actuel de coopération entre le Système des Nations-unies et le Burundi ?
Je dirais tout d’abord que la collaboration entre le Système des Nations Unies et le Burundi remonte à l’accession du pays à l’Indépendance.
Depuis lors, cette coopération est restée excellente. Ce constat est partagé non seulement par nous, mais également par le gouvernement burundais avec lequel nous entretenons une collaboration étroite et constructive.
Lors des cérémonies officielles du vendredi 24 octobre, nous avons évoqué en compagnie du ministre des Affaires étrangères, Edouard Bizimana, le rôle très important que le Burundi joue dans les instances internationales.
Depuis 1962, le pays s’est distingué par son engagement et sa participation constructive aux grandes discussions multilatérales.
Concrètement, quel est ce rôle ?
Le Burundi a joué plusieurs rôles sur la scène internationale, mais l’un des plus récents et significatifs est sa participation active à la Conférence internationale sur le financement du développement tenue en juillet 2025 à Séville, en Espagne. Le Burundi a coprésidé aux côtés du Portugal le comité d’organisation, illustrant son engagement croissant dans les débats mondiaux sur les enjeux économiques et sociaux. Cette conférence a débouché sur des recommandations majeures visant à adapter les mécanismes de financement du développement à l’évolution de l’architecture internationale de l’aide.
Je tiens également à souligner que le Burundi siège actuellement au Conseil des droits de l’Homme des Nations-unies en tant que membre élu pour la période 2024–2026. Il s’agit de la deuxième mandature en moins de dix ans après le précédent mandat de 2015 à 2018. Ce mandat illustre l’engagement du pays dans les débats multilatéraux sur les droits humains et sa volonté de contribuer activement à la promotion des normes internationales en la matière.
Par ailleurs, le Burundi continue de jouer un rôle important dans les opérations de maintien de la paix des Nations-unies, notamment à travers la mobilisation de contingents dans des missions en Afrique. Cette participation témoigne de son engagement concret en faveur de la stabilité régionale et de la solidarité internationale.
Et au niveau national ?
Aujourd’hui, au niveau national, nous pouvons affirmer avec confiance que la coopération entre le Système des Nations-unies et le Burundi est solide, dynamique et porteuse de résultats.
Depuis les années post-crise, les Nations-unies sont restées aux côtés du Burundi, dans les moments les plus sensibles de son histoire récente. Nous avons soutenu le dialogue national, contribué au renforcement du système judiciaire, et accompagné les efforts de consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Ces interventions ont permis de jeter les bases d’un développement plus inclusif et durable.
Aujourd’hui encore, nous sommes fiers des progrès accomplis, tout en restant lucides face aux défis persistants. Les résultats obtenus démontrent qu’avec des efforts conjoints et des partenariats solides, des avancées sont possibles. Le système des Nations-unies demeure pleinement engagé aux côtés du Burundi pour accompagner le pays dans la trajectoire de développement qu’il s’est fixée, en cohérence avec les Objectifs de développement durable, en vue d’un avenir plus équitable, plus résilient et plus prospère.
Comment se présente l’état du financement des projets ici au Burundi ? Quelles sont vos priorités ?
Le financement des projets au Burundi demeure étroitement lié aux enjeux globaux du financement du développement. Il est clair qu’il reste encore d’importants efforts à fournir pour garantir un appui financier adéquat et durable aux priorités nationales.
C’est pourquoi nous travaillons activement avec le gouvernement et l’ensemble des partenaires au développement pour renforcer les mécanismes de mobilisation des ressources internes, notamment à travers l’amélioration de la gouvernance fiscale et la planification budgétaire. Parallèlement, nous explorons de manière stratégique des sources de financement innovantes, telles que les partenariats public-privé, les financements climatiques, les instruments mixtes et les contributions de la diaspora, afin de diversifier les ressources disponibles et soutenir une croissance inclusive et résiliente.
Nos priorités sont celles du gouvernement, elles sont déclinées dans le cadre de coopération des Nations-unies signé avec le gouvernement sur la période 2023-2027. Elles se résument en la transformation structurelle de l’économie et amélioration de la gouvernance, le développement du capital humain et valorisation du dividende démographique et la gestion durable des ressources naturelles, résilience climatique et cohésion sociale
Au niveau de l’exécution des projets qui sont financés par différents bailleurs, le constat est qu’il y a un faible taux de décaissement. Quelles sont vos propositions pour y remédier ? Allez-vous à y apporter votre expertise ?
Il est vrai que le faible taux de décaissement des projets financés par les bailleurs constitue une préoccupation. Pour les programmes de coopération avec les Nations-unies, le taux de décaissement est resté largement bonne.
En tant que Système des Nations-unies, nous sommes pleinement engagés à contribuer à l’amélioration de cette situation comme dans les autres pays. Plusieurs pistes d’actions sont déjà en cours d’exploration et de mise en œuvre, en cohérence avec les réformes engagées par le gouvernement.
Nous sommes prêts à intensifier cet appui, en étroite collaboration avec le gouvernement et les bailleurs, afin de garantir que les financements mobilisés se traduisent effectivement en résultats tangibles et durables pour les populations.
Nous sommes au lendemain des élections législatives et communales. Comment appréciez-vous le processus démocratique au Burundi ?
Le processus démocratique au Burundi continue de se consolider. Nous saluons l’engagement des institutions nationales à organiser ces scrutins dans un climat globalement apaisé, ainsi que la mobilisation des citoyens qui ont exercé leur droit de vote.
Cela dit, comme dans tout processus électoral, quelques défis subsistent, comme indiqué par quelques observateurs. Le Système des Nations Unies reste disponible à accompagner le Burundi dans ce cheminement, en apportant son expertise technique, en soutenant les réformes institutionnelles et en favorisant un environnement propice à la paix, à la participation citoyenne et au développement durable.
Quel a été le rôle des Nations-unies dans ces élections ?
Les Nations-unies n’ont pas joué un rôle actif dans l’organisation directe de ces élections, et cela est tout à fait normal. Comme vous le savez, certains pays sollicitent un appui opérationnel des Nations-unies dans leurs processus électoraux. Lorsque ce n’est pas le cas, cela témoigne de la capacité des institutions nationales à assumer pleinement cette responsabilité, ce qui est une avancée importante.
Cela dit, notre rôle reste celui d’un partenaire engagé. Si des besoins se présentent à l’avenir, que ce soit pour renforcer les capacités, améliorer certains aspects techniques ou accompagner des réformes, nous sommes prêts à apporter notre expertise, conformément à notre mandat.
Nous avons également apprécié la réforme de l’administration décentralisée qui a suivi ces élections, ce qui ouvre de nouvelles perspectives pour une gouvernance de proximité plus efficace et plus inclusive.
Que dire de cette nouvelle réforme administrative ?
Nous saluons cette réforme de l’administration territoriale, qui marque une étape importante vers une gouvernance de proximité plus efficace et plus réactive. Nous avons déjà entamé une collaboration active avec les nouveaux gouverneurs, dans un esprit de partenariat renforcé.
Cette nouvelle configuration administrative ouvre des perspectives prometteuses. Elle facilitera, pour nous, l’élaboration de plans d’action concertés avec les différentes provinces, tout en améliorant le suivi de la mise en œuvre des interventions sur le terrain. Cela nous permettra de mieux cibler nos efforts et d’accroître l’impact concret de nos actions au plus près des populations.
Dans ce contexte, nous sommes également en train d’ajuster nos modalités de travail afin de mieux répondre aux dynamiques locales et d’optimiser notre contribution au développement inclusif et durable du pays.
Au niveau des médias, il y a des collègues qui sont en exil, mais aussi d’autres qui sont en prison. Vous ne voyez pas que c’est une menace à la liberté d’expression ?
Les Nations Unies sont fermement engagées en faveur de la liberté d’expression que nous considérons comme un pilier fondamental de toute société démocratique. Les médias jouent un rôle essentiel dans la promotion de la transparence, de la redevabilité et du dialogue public, et nous les considérons comme des partenaires clés dans le processus de développement.
En collaboration avec les États membres, y compris le Burundi, les Nations Unies ont mis en place des mécanismes de suivi et d’évaluation des droits de l’Homme, incluant les aspects liés à la liberté de la presse et à l’exercice des libertés fondamentales. Comme vous le savez, le Burundi participe régulièrement à l’Examen périodique universel (EPU) du Conseil des droits de l’Homme. L’examen de 2023 a donné lieu à plusieurs recommandations, dont certaines ont été endossées par le gouvernement burundais.
Nous saluons l’engagement du Burundi à soumettre ses rapports périodiques et à assurer le suivi des recommandations.
En tant que Système des Nations-unies, nous réaffirmons notre attachement à la liberté d’expression, tout en soulignant l’importance du respect de l’État de droit. Lorsqu’il y a des procédures judiciaires en cours, nous n’intervenons pas dans le processus, mais nous encourageons toutes les personnes concernées à faire valoir leurs droits par les voies légales appropriées.
Enfin, nous restons pleinement disponibles pour accompagner les efforts du gouvernement et des acteurs nationaux dans la promotion des médias, le renforcement des capacités journalistiques et la création d’un environnement propice à une expression libre, responsable et constructive.
Justement, par rapport à la promotion des médias, quels sont vos programmes pour les accompagner ?
Plusieurs agences du Système des Nations-unies travaillent étroitement avec les médias, chacune selon son mandat spécifique. Nous disposons notamment d’un programme de formation dédié aux professionnels des médias ainsi que de projets ciblés visant à renforcer leurs capacités, notamment en matière d’équipement et de matériel technique.
Le Burundi bénéficie également d’un Centre d’information des Nations-unies, un dispositif rare et précieux, tous les pays n’en sont pas dotés. Ce centre joue un rôle clé dans la diffusion de l’information, et la sensibilisation du public aux enjeux du développement.
À partir de 2026, nous avons l’ambition de redoubler d’efforts dans notre collaboration avec les médias, en renforçant les capacités techniques et éditoriales, mais aussi en intensifiant les échanges et les partenariats. Que ce soit au niveau national ou provincial, nous devons être plus présents, plus accessibles et plus engagés pour accompagner les médias dans leur rôle fondamental de relais d’information et la promotion de la transparence et de mobilisation citoyenne.
Sur quoi allez-vous mettre un accent particulier ?
Dans le contexte actuel mondial marqué par une forte expansion de l’accès à Internet et à la téléphonie mobile, une grande partie de la population a désormais accès à l’information en temps réel. C’est une avancée majeure pour la démocratie et le développement. Toutefois, cette facilité d’accès s’accompagne aussi de nouveaux défis, notamment celui de la désinformation, qui peut fragiliser la cohésion sociale et entraver les efforts de développement.
C’est pourquoi nous devons travailler étroitement avec les médias pour faire face à ce phénomène. Il est essentiel de promouvoir une information fiable, constructive et porteuse de valeurs positives. Les médias ont un rôle fondamental à jouer dans la diffusion des messages de paix, de santé, d’éducation et de développement.
Le Système des Nations-unies au Burundi est pleinement engagé à renforcer les capacités des médias, tant sur le plan technique qu’éthique, afin qu’ils puissent exercer leur mission avec professionnalisme et responsabilité. Nous allons intensifier nos efforts dans ce domaine en favorisant des partenariats durables et en soutenant les initiatives locales qui contribuent à une information de qualité, accessible à tous.
Il y a une crise dans la région des Grands lacs. Qu’est-ce vous êtes en train de faire dans la résolution de cette crise ?
La situation dans la région des Grands Lacs demeure complexe, mais elle appelle à une mobilisation collective renforcée. En tant que Système des Nations Unies, nous sommes pleinement engagés, aux côtés des États concernés, des organisations régionales et continentales, pour contribuer à la résolution durable des crises.
Nous croyons fermement que l’avenir de la région repose sur la capacité à résoudre les différends par des voies pacifiques, inclusives et respectueuses du droit international. C’est dans cet esprit que le secrétaire général des Nations Unies a désigné un Envoyé spécial pour la région des Grands Lacs dont le mandat est précisément de faciliter le dialogue, d’appuyer les efforts de médiation et de renforcer la coopération régionale.
Il est important de rappeler le principe de subsidiarité, qui place les États de la sous-région et les organisations continentales, telles que l’Union africaine, au cœur des réponses aux crises. Les Nations Unies interviennent en appui, en complément des initiatives locales et régionales, en apportant leur expertise, leur capacité de mobilisation et leur rôle de facilitateur.
Notre contribution vise à renforcer les mécanismes de prévention, à promouvoir la paix et la sécurité, et à soutenir les efforts de développement qui sont essentiels pour une stabilité durable. Nous restons engagés à accompagner les acteurs régionaux dans la recherche de solutions concertées, au bénéfice des populations de la région.
Mais une crise humanitaire s’en est suivie…
Ah oui, les conflits se traduisent trop souvent par des crises humanitaires aiguës, avec des conséquences dramatiques pour les populations civiles. Les souffrances engendrées par ces situations exigent une réponse rapide, coordonnée et humaine. Le Système des Nations-unies est en première ligne, aux côtés des États, des autorités locales et des organisations de la société civile, pour apporter une assistance vitale aux personnes touchées.
Nous saluons particulièrement la politique de porte ouverte adoptée par le Burundi à l’égard des réfugiés en provenance des pays voisins. L’accueil, la mise en sécurité et la réponse aux besoins immédiats de ces populations vulnérables témoignent d’un engagement humanitaire remarquable.
Par ailleurs, nous poursuivons nos efforts en République démocratique du Congo, où nos collègues sont pleinement mobilisés pour accompagner les autorités dans la gestion des déplacements internes, en apportant une aide humanitaire, un appui logistique et un soutien à la résilience des communautés affectées.
Notre engagement reste constant : protéger les vies, renforcer la solidarité régionale et promouvoir des solutions durables aux crises humanitaires.
D’un côté, il y a un afflux massif de réfugiés congolais vers le Burundi. De l’autre, il y a des réfugiés burundais qui sont éparpillés dans les pays voisins. Par rapport au Burundi, comment le système des Nations-unies va-t-il accompagner le Burundi pour alléger la souffrance de ces réfugiés ?
La situation des réfugiés dans la région des Grands Lacs est à la fois complexe et évolutive. D’un côté, nous observons avec satisfaction une tendance positive au retour volontaire des réfugiés burundais vivant dans les pays voisins, grâce à la stabilité progressive que connaît le Burundi actuellement.
Cependant, ce retour exige un accompagnement adapté. Les personnes qui rentrent ont des besoins immédiats en matière de logement, de santé, d’éducation et de réinsertion socio-économique. Le Système des Nations-unies travaille en étroite collaboration avec le gouvernement du Burundi et les partenaires techniques et financiers pour contribuer à un accueil digne et une réintégration durable de ces anciens réfugiés.
Par ailleurs, le Burundi fait face à un afflux important de réfugiés congolais, fuyant les violences dans l’est de la RDC. Nous saluons la politique d’accueil généreuse du gouvernement burundais, qui a permis leur installation. Ce geste de solidarité régionale est à souligner.
Le Système des Nations-unies, avec le soutien de ses bailleurs, reste pleinement mobilisé pour appuyer le Burundi dans la gestion de ces flux migratoires, en apportant une assistance humanitaire, en renforçant les capacités locales et en soutenant les efforts de coordination interinstitutionnelle. Nous remercions vivement les partenaires au développement pour leurs contributions, et nous continuerons à œuvrer ensemble pour alléger les souffrances des populations déplacées et promouvoir des solutions durables.
Le Burundi connaît des déplacés environnementaux qui ont été touchés par les changements climatiques ici et là. Que comptez-vous faire pour soutenir ces personnes ?
Les effets du changement climatique ont durement touché certaines communautés au Burundi, en particulier la population de Gatumba, régulièrement affectée par des inondations récurrentes. Ces déplacements environnementaux posent des défis humanitaires et de développement que nous prenons très au sérieux.
Nous saluons la décision du gouvernement burundais d’apporter une réponse durable à cette situation, notamment à travers la création du village intégré de Gateri. Ce projet est une initiative exemplaire. Il a permis de relocaliser environ 50 % des personnes affectées de manière cyclique par les inondations, dans un cadre sécurisé et propice à la reconstruction de leur vie.
Le gouvernement a mis à disposition le terrain, et nous avons travaillé en étroite collaboration avec les autorités pour construire des habitations semi-durables, conçues pour évoluer vers des structures permanentes avec la participation des familles bénéficiaires. Le village est doté d’infrastructures essentielles : un centre de santé, un accès à l’eau potable, des espaces pour l’agriculture et des services de base.
Toutefois, Gatumba n’est pas un cas isolé. D’autres régions du pays sont également confrontées aux effets du changement climatique. Le Système des Nations Unies est pleinement mobilisé pour accompagner le Burundi dans la mise en place de solutions durables, résilientes et inclusives.
Par ailleurs, il convient de souligner que nous avons conduit, l’année passée, sous le leadership du gouvernement, l’exercice du « Post Disaster Needs Assessment (PDNA) » avec l’appui de plusieurs partenaires techniques et financiers. Cet exercice a permis d’évaluer de manière rigoureuse les impacts des catastrophes liées au climat et de définir des priorités claires pour une réponse durable et intégrée.
Avez-vous un message particulier à l’endroit du gouvernement burundais, aux médias par rapport à cet anniversaire des Nations-unies ?

À l’occasion du 80ème anniversaire des Nations-unies, il ne s’agit pas simplement d’une célébration symbolique, mais d’un véritable moment de réflexion collective. Une réflexion que nous souhaitons mener avec le peuple burundais, car l’ONU n’est pas seulement une organisation, c’est une idée audacieuse née d’une volonté de bâtir un monde fondé sur la paix, la solidarité et les droits humains.
Depuis 1945, le monde a profondément changé, et notre ambition est de rester une organisation pertinente, à l’écoute des besoins des populations, capable de s’adapter et d’innover. C’est pourquoi nous recueillons les idées, les attentes et les perspectives des citoyens, pour nourrir la dynamique des réformes en cours au sein du Système des Nations-unies.
À l’endroit du gouvernement burundais, nous réitérons notre engagement à poursuivre un partenariat fondé sur la confiance, la transparence et l’action commune pour le développement durable. Nous saluons les efforts déployés dans les domaines de la paix, de la gouvernance, de l’inclusion sociale et de la résilience climatique.
Quant aux médias, nous les considérons comme des acteurs essentiels dans toute démocratie. Nous souhaitons renforcer notre dialogue avec eux, mieux comprendre comment notre action est perçue, et surtout, promouvoir leur rôle dans la diffusion d’une information constructive, dans la sensibilisation citoyenne et dans le renforcement de la cohésion sociale.
Ce 80e anniversaire est une opportunité pour renouveler notre engagement, écouter davantage, et construire ensemble un avenir plus juste, plus équitable et plus solidaire.













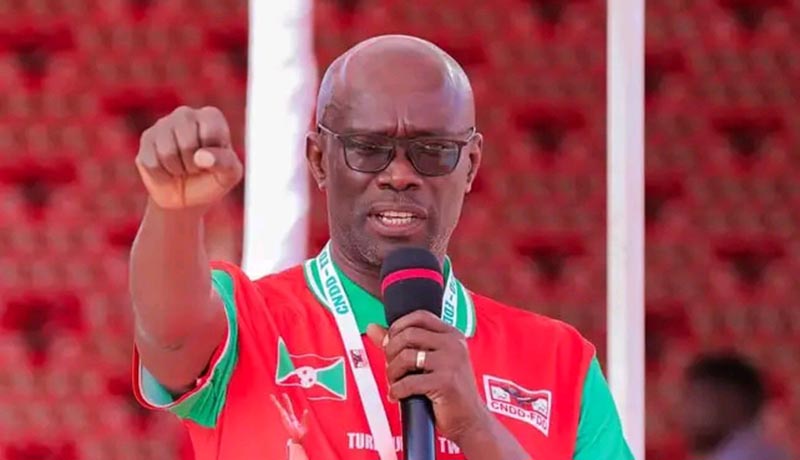








Visiblement la répresentante résidente des NU au Burundi parle plusieurs langues y compris la langue de bois. Il est difficile de comprendre ce que les NU font pour la liberté d’expression au Burundi ! Elle aurait été honnete de dire que les NU suivent avec attention la situation des média au Burundi , une facon de dire que la situation est catastrophique. Enfin je comprends bien qu’elle puisse avoir un langage diplomatique si ellee veut rester à son poste , si non ce serait bye bye Violet.
En bref on n’attend rien des NU . N’ukwigwanako .