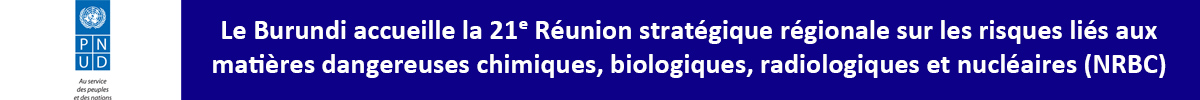La Tanzanie a sorti, le 25 juillet 2025, une ordonnance sur les licences commerciales qui interdit une quinzaine d’activités commerciales pour les non-ressortissants. Selon nombre d’observateurs, cette décision viole le Protocole portant création du Marché commun de l’East African Community (EAC). Le Kenya envisage des représailles mais après l’épuisement des voies diplomatiques. Gitega n’a pas encore réagi.
Signée par le ministre tanzanien de l’Industrie et du Commerce Selemani Saidi Jafo, l’ordonnance a suscité un tollé sur la toile. Les activités commerciales interdites sont : le commerce de détail et de gros (à l’exception des supermarchés et des points de vente spécialisés) ; les services de transfert d’argent mobile ; les réparations électroniques, notamment des téléphones portables ; les services de salon de coiffure, à l’exception de ceux liés au tourisme ; le nettoyage domestique et commercial ; l’agriculture à petite échelle ; les services de guides touristiques et de livraison de colis ; les services de courtage et d’agence immobilière ; l’établissement de stations de radio et de télévision ; l’exploitation de boutiques de souvenirs et de musées ; les services de dédouanement et d’expédition ; l’achat de récoltes à la ferme ; la propriété ou l’exploitation de micro et petites entreprises ainsi que les entreprises de jeux d’argent hors casinos agréés.
Les sanctions sont prévues pour les contrevenants. Un non-ressortissant est passible d’une amende d’au moins 10 millions de shillings ou d’une peine d’emprisonnement maximale de six mois ainsi que de la révocation du visa et du permis de séjour. Quant au citoyen tanzanien qui aide un non-ressortissant à exercer l’une des activités commerciales interdites, il est passible d’une amende de 5 millions de shillings ou d’une peine d’emprisonnement maximale de trois mois.
Le Burundi n’a pas encore exprimé sa position. « Il est encore en phase de collecter des informations y relatives, chercher à savoir les tenants et les aboutissants ; et apprécier la mise en œuvre du Protocole de marché commun (PMC) par chaque Pays Partenaire de l’EAC », indique Rémy Barampama, porte-parole de l’ancien ministère en charge des Affaires de l’EAC.
Au moment opportun, souligne-t-il, le Burundi s’exprimera. « Il sied de rappeler que chaque Pays Partenaire de l’EAC est encore indépendant et souverain. Le Burundi est toujours en contact permanent avec la Tanzanie, tout comme avec le reste des pays partenaires et les échanges ont une portée plus large. » Et de signaler qu’au-delà du cadre communautaire régional, le Burundi dispose également d’un cadre de coopération bilatérale qui pourra également servir d’un cadre non moins approprié pour discuter de cette décision prise par la Tanazanie.
Des voix s’élèvent
« Le Kenya reconnaît et respecte les droits souverains des États partenaires de la CAE de légiférer sur les questions nationales, mais croit également en l’importance de la consultation, de la coordination et de la cohérence dans la mise en œuvre des politiques qui affectent le transfert transfrontalier de marchandises », a déclaré Lee Kinyanjui, secrétaire de Cabinet du ministère des Investissements, du Commerce et de l’Industrie dans une déclaration du 30 juillet.
Pour lui, les mesures prises par la Tanzanie compromettent l’objectif fondamental de l’intégration économique régionale dans le cadre du Protocole du Marché commun (PCM). Le Kenya demande que ces restrictions soient supprimées et que la Tanzanie revienne aux mesures prévues dans le protocole de la CAE. « L’ordonnance sur les licences commerciales, qui semble criminaliser les investissements légaux de l’EAC, nuira à nos deux économies. Il est donc essentiel, dans l’esprit de l’EAC, que des engagements bilatéraux soient pris pour résoudre ces problèmes. »
« Si le gouvernement tanzanien ne parvient pas à remédier à cette situation, l’East Africa Law Society (EALS) prendra toutes les mesures juridiques nécessaires, y compris en saisissant la Cour de justice de l’Afrique de l’Est pour contester la légalité et la validité de ladite ordonnance. », lit-on dans une déclaration du 30 juillet.
Pour l’Association des avocats d’Afrique de l’Est, la décision de la Tanzanie est une violation manifeste des obligations du Traité de l’EAC qui, en son article 5, alinéa 2, engage les Etats-partenaires à établir un Marché commun, un régime fondé sur la libre circulation des biens, des personnes, des services, de la main-d’œuvre et des capitaux, et le droit d’établissement. « Les articles 13(5) et 13(11) du Protocole du Marché commun de l’EAC interdisent expressément aux Etats-partenaires d’imposer des restrictions au droit d’établissement des ressortissants d’autres Etats partenaires, sauf si ces mesures sont dûment justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique et sous réserve d’une notification préalable au Secrétariat de l’EAC et aux autres États partenaires. »
L’EALS constate qu’aucune justification de ce type n’a été fournie ni communiquée. Pour l’EALS, cette décision envoie un signal d’alarme selon lequel des entreprises dûment enregistrées et des citoyens respectueux des lois des pays africains peuvent être exclus sommairement et sans procédure régulière. L’association souligne que les activités commerciales ciblées constituent en réalité le cœur même des micros, petites et moyennes entreprises (MPME), qui représentent plus de 80 % des entreprises et des emplois en Afrique de l’Est.
Le 31 juillet, le Secrétariat de l’EAC a tenu à rappeler, sans citer nommément la Tanzanie, que depuis l’adoption du Protocole du Marché commun de la CAE, les Etats-partenaires se sont engagés à favoriser l’intégration régionale en supprimant les obstacles au commerce, aux services et à l’investissement ainsi qu’à s’abstenir d’adopter des mesures unilatérales entravant la libre circulation et le droit d’établissement des citoyens et des entreprises dans la région. « Il est important de rappeler à tous les Etats partenaires que tout retour en arrière unilatéral sur ces engagements est incompatible avec les obligations découlant du Protocole. » Le Secrétariat est en train d’analyser le degré de conformité aux obligations et présentera toute mesure incompatible identifiée par les Etats-partenaires lors de la prochaine réunion du Conseil sectoriel du commerce, de l’Industrie, des Finances et de l’Investissement.
Analyse : Jean Ndenzako : « Une escalade protectionniste dans la région aurait des effets dévastateurs sur l’intégration économique. »
Que pensez-vous de la décision récente de la Tanzanie ?
Cette mesure vise officiellement à protéger les opportunités économiques des citoyens tanzaniens, mais elle entre en tension manifeste avec les principes fondamentaux de l’Union douanière et du Marché commun est-africain. Elle s’inscrit dans une dynamique de nationalisme économique croissant sous l’administration de la présidente Samia Suluhu Hassan, qui avait déjà interdit en mai 2025 l’usage des devises étrangères pour les transactions domestiques. Elle répond également à des pressions politiques internes, comme en témoigne le soutien public de Severine Mushi, chef de l’association des commerçants de Kariakoo, qui a salué cette mesure comme une protection des moyens de subsistance des commerçants tanzaniens face à ce qu’il perçoit comme une concurrence déloyale des étrangers notamment chinois.
Des motifs économiques ?
Sur le plan économique, le gouvernement tanzanien avance trois arguments principaux. Premièrement, la nécessité de formaliser des secteurs économiques où la participation étrangère informelle était croissante. Deuxièmement, l’impératif de créer des emplois durables pour les citoyens tanzaniens. Troisièmement, l’objectif de canaliser les investissements étrangers vers des projets à plus grande échelle et à plus haute valeur ajoutée.

Que dire de ces justifications ?
L’EAC, qui comprend huit États membres (Burundi, République démocratique du Congo, Kenya, Rwanda, Somalie, Soudan du Sud, Tanzanie et Ouganda), a pour objectif déclaré de créer une union douanière, un marché commun, une union monétaire et finalement une fédération politique. Le Protocole du Marché commun, entré en vigueur en 2010, garantit explicitement quatre libertés fondamentales dont la libre circulation des biens, des personnes, du travail et des services. L’article 13 de ce protocole stipule clairement que les ressortissants de l’EAC ont le droit d’établir et d’exploiter des entreprises dans tout Etat membre, et interdit expressément aux membres de traiter les ressortissants des autres Etats de l’EAC moins favorablement que leurs propres citoyens. En instituant des restrictions sectorielles basées sur la nationalité, la Tanzanie semble violer ce principe fondamental de non-discrimination. Ce qui a provoqué la réaction immédiate du Secrétariat de l’EAC.
Cette mesure crée ce que les économistes appellent une « barrière non tarifaire » (BNT), particulièrement insidieuse, car elle se présente sous forme de réglementation nationale plutôt que de taxe directe. Les BNT sont souvent plus dommageables à l’intégration économique que les tarifs douaniers, car elles sont plus difficiles à identifier, quantifier et éliminer par la négociation.
Quid de l’impact ?
L’interdiction tanzanienne pourrait avoir un effet dissuasif bien au-delà des secteurs explicitement mentionnés, en créant un climat d’incertitude pour les investisseurs régionaux quant à la stabilité du cadre réglementaire en Tanzanie. L’analyse économique de cette mesure révèle une tension fondamentale entre des bénéfices économiques potentiels à court terme pour la Tanzanie et des coûts probablement plus importants à moyen et long termes tant pour le pays que pour la région.
Au niveau national, quel est le gain pour la Tanzanie ?
Le gouvernement tanzanien espère que cette mesure permettra de réserver aux citoyens des secteurs économiques considérés comme à faible barrière à l’entrée créant ainsi des opportunités d’emploi et de revenus pour les populations locales. Certains commentateurs sur les réseaux sociaux ont soutenu cette vision protectionniste arguant que « les nationaux ont souvent tout à leur portée et quand les étrangers savent mieux en exploiter au lieu d’apprendre sur eux on va se mettre à dépouiller leurs biens ». Cette perspective repose sur l’hypothèse que les entrepreneurs étrangers, souvent perçus comme mieux capitalisés ou plus expérimentés, évinçaient les acteurs locaux du marché.
Est-ce faux ?
Cette vision néglige plusieurs réalités économiques. Premièrement, comme le note un commentaire pertinent : « ce sont souvent des étrangers qui créent des emplois et proposent la meilleure marchandise pour le meilleur prix et leur départ marque une chute du niveau de vie des locaux ». Les petites entreprises étrangères emploient fréquemment une main-d’œuvre locale et introduisent des compétences, des technologies et des pratiques commerciales qui élèvent la productivité globale du secteur.
Deuxièmement, cette mesure pourrait réduire la diversité et la qualité de l’offre dans des secteurs comme le tourisme ou les services financiers mobiles où les opérateurs kényans notamment avaient apporté une expertise reconnue.
Enfin, en décourageant les investissements transfrontaliers, la Tanzanie risque de se priver des retombées positives en termes de transfert de compétences et d’innovations que ces investissements génèrent habituellement.
Et au niveau régional ?
Les conséquences pourraient être encore plus significatives. Le Kenya, principal partenaire commercial de la Tanzanie au sein de l’EAC avec des échanges estimés à 63 milliards de shillings kenyans (environ 470 millions de dollars) en 2024, a immédiatement protesté contre cette mesure. Le ministre kenyan du Commerce Lee Kinyanjui a averti que cette interdiction « blesserait » les deux économies et constituait une violation de l’esprit de l’EAC. Plus inquiétant encore, Bernard Shinali, président du Comité du commerce de l’Assemblée nationale kenyane, a évoqué la possibilité de restrictions réciproques contre les travailleurs tanzaniens au Kenya, notamment dans le secteur minier.
Et si les autres pays de l’EAC faisaient de même ?
Une escalade protectionniste dans la région aurait des effets dévastateurs sur l’intégration économique est-africaine. L’EAC représente le plus grand marché d’exportation pour le Kenya (28,1% de ses exportations totales), et des mesures de rétorsion pourraient perturber des chaînes d’approvisionnement régionales bien établies. Le secteur du tourisme, en particulier, qui repose sur la libre circulation des guides et opérateurs touristiques à travers les frontières, serait directement affecté. Comme le note l’hôtelier kényan Mohammed Hersi, « le protectionnisme n’aidera jamais un pays à prospérer ».
Quel est l’avenir de l’’intégration régionale ?
Cette crise révèle les limites persistantes du projet d’intégration est-africaine malgré les avancées institutionnelles. Comme le note un commentaire sur les réseaux sociaux, « il est clair que la Tanzanie n’a jamais été sérieuse dans la mise en œuvre de l’EAC ». Les tensions commerciales entre la Tanzanie et le Kenya ne sont pas nouvelles. Elles ont porté par le passé sur des produits agricoles ou des procédures douanières, mais elles prennent ici une dimension plus systémique. Car, elles touchent au cœur des principes du marché commun.
Le Secrétariat de l’EAC a réagi sans citer la Tanzanie
La réaction du Secrétariat de l’EAC, tout en réaffirmant les engagements communautaires, semble pour l’instant prudente, se limitant à un rappel des principes plutôt qu’à des mesures concrètes. Cette prudence reflète probablement les sensibilités politiques à l’approche des élections générales tanzaniennes d’octobre 2025, où le parti au pouvoir CCM est attendu vainqueur.
A plus long terme, cette crise pose la question fondamentale de l’équilibre entre souveraineté nationale et intégration régionale. Les Etats membres de l’EAC sont-ils prêts à accepter les contraintes sur leurs politiques économiques nationales que suppose un véritable marché commun ? La réponse à cette question déterminera l’avenir du projet d’intégration est-africaine.
Des solutions ?
Les solutions de compromis pourraient inclure une période de transition permettant aux entreprises étrangères existantes de s’adapter ; des critères de performance ou de transfert de compétences plutôt que des interdictions absolues ; des programmes conjoints de formation pour renforcer les capacités des entrepreneurs locaux sans exclure complètement les apports étrangers. Cependant, toute solution devra prendre en compte les réalités politiques internes en Tanzanie où cette mesure semble répondre à une demande populaire de protection économique.
C’est un casse-tête alors ?
La réponse institutionnelle de l’EAC et des Etats membres à ce défi déterminera si la région peut progresser vers une intégration plus profonde ou si elle restera prisonnière de logiques nationales à courte vue. Comme le suggère l’expérience d’autres unions douanières, le véritable test de l’intégration ne se situe pas dans les périodes de croissance harmonieuse mais dans la capacité à surmonter ce genre de crises tout en préservant les acquis communautaires.