Chapeau — Eriger le « journalisme de solutions » en dogme revient, hélas, à confondre méthode éditoriale et instrument de contrôle. Les solutions authentiques ne naissent que d’un diagnostic honnête.
Le Conseil national de la communication, chargé entre autres de réguler les médias, entend faire du « journalisme de solutions » son cheval de bataille. Cette approche, présentée comme la panacée à toutes les crises et pénuries, est désormais exigée à toutes les sauces. À défaut, les médias récalcitrants — perçus comme incrédules, voire insoumis — savent à quelle sauce ils risquent d’être mangés.
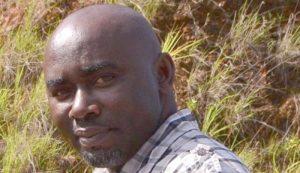
Venons-en aux faits, puisqu’il faut des faits et rien que des faits. Profitant d’une conjoncture marquée par des pénuries de carburant, plusieurs médias parmi les plus suivis ont décidé d’unir leurs voix pour ausculter, de manière structurée, l’impact de ces ruptures sur la vie du pays : télécommunications, médias, hôpitaux, commerce, tourisme, pouvoir d’achat… L’ambition était claire : comprendre et faire comprendre.
La démarche envisagée était classique et rigoureuse : déterminer les quantités nécessaires pour satisfaire la demande nationale ; confronter les promesses officielles à la réalité du terrain ; solliciter des experts pour éclairer les causes profondes de ces pénuries récurrentes ; interroger, enfin, l’option — souvent évoquée — d’un acheminement par le lac, réputé moins coûteux. Bref, documenter, vérifier, analyser.
Or, selon toutes les écoles sérieuses, le « journalisme de solutions » commence par là : expliquer le problème et ses causes, puis décrire les pistes de résolution et leurs limites, avec le recul critique qui s’impose. Rien à voir avec un vernis positif plaqué sur des difficultés bien réelles.
Dans ce dossier, avorté dans l’œuf, ce schéma était précisément celui retenu par les rédactions partenaires. Le CNC ne l’a pas entendu de cette oreille et a opposé un nouveau refus — après un précédent — au motif que le traitement proposé « n’apporterait rien de nouveau ». Une posture pour le moins préoccupante.
Faire du « journalisme de solutions », ce n’est ni taire ni maquiller les problèmes. C’est d’abord les regarder froidement, sans passion ni parti pris, pour mieux éclairer les voies de sortie. Exiger des informations uniquement « positives » est le début d’une pente glissante vers l’arbitraire.
Oui au journalisme d’impact, nourri par l’enquête, la contradiction et la transparence. Non à l’amnésie organisée et à l’évitement des sujets qui fâchent. À défaut, ce n’est pas du « journalisme de solutions », c’est la promotion d’un journalisme du déni.












La légitimité du travail des Journalistes et la responsabilité des Médias, dans les pays qui respectent et protègent les droits humains fondamentaux. découlent de la trilogie de trois droits imprescriptibles et non négociables dont jouissent les citoyens. Cette légitimité et cette responsabilité sont adossées aussi à une éthique et à une déontologie qui régissent le métier du journaliste. En raison des limites de cet espace, explorons très sommairement la trilogie de ces trois droits fondamentaux uniquement. Le citoyen burundais a le droit de savoir ou de connaître toutes les informations concernant la vie publique de son pays et dans tous les domaines. Le citoyen burundais a le droit de s’informer auprès de divers médias de son choix. Le citoyen burundais a le droit de se forger librement son opinion et de l’exprimer publiquement et dans tous les médias de son choix. De ce fait, les journalistes burundais sont d’abord et aussi des citoyens qui jouissent de cette même trilogie de droits humains fondamentaux. En outre le métier du journaliste est régulé par la loi, par l’éthique et par la déontologie. Dans un espace restreint d’une réaction à la règle étrange que le CNC souhaite imposer aux journalistes et aux médias burundais, il convient néanmoins de rappeler, par comparaison, que la légitimité du médecin découle du droit des citoyens burundais à être soignés. La légitimité de l’instituteur ou du professeur découle du droit des citoyens burundais à l’instruction. La légitimité du policier ou du militaire découle du droit des citoyens à la protection en cas de menaces graves contre sa sécurité physique ou contre ses biens et ses propriétés. La légitimité du juge ou de l’avocat découle du droit des citoyens burundais à la justice. La légitimité de l’artiste découle du droit des citoyens burundais à la culture. Etc..etc…etc… Le journalisme de solutions que propose le CNC fait plutôt penser aux trois singes qui sont censés incarner la sagesse indienne. Le premier singe ne voit rien. Le deuxième n’entend rien. Et le troisième ne dit rien….En outre, le CNC donne l’impression qu’il a changé de mission. Il est devenu un cabinet de dentistes. Comme le dirait Samandari, le personnage incontournable de l’humour burundais, le CNC est devenu, pour les journalistes et les médias burundais, un médicament pour soigner les dents. Umuti w’amenyo..#Bigabiro