Gestion du sol et de l’eau, spécialisation régionale, recherche-vulgarisation,… des actions à mener pour un développement durable de l’agriculture au Burundi selon les différents intervenants dans le secteur. Ils appellent aussi à la bonne gouvernance et au respect des engagements.
« Il y a beaucoup de facteurs qui contrôlent et influencent la production agricole », a déclaré Dr Salvator Kaboneka, agronome et expert en gestion intégrée de la fertilité des sols.
Conférencier lors de la première conférence publique organisée par la Benevolencjia et ses médias partenaires, le 17 avril 2025, sous le thème central : « Comment optimiser le développement de l’agriculture au Burundi », il a indiqué que la gestion des sols est une priorité. « On ne peut pas parler de l’agriculture sans terres. Le Burundi est un petit pays. Mais, il y a moyen de rentabiliser ce petit espace. »
Pour y arriver, il faut une libération des terres agricoles par la villagisation : « Cela éviterait de cultiver en solo. On peut créer des associations familiales, collinaires et communales. Après la récolte, on partage la production selon la proportion de chaque famille ou individu. »
Une cartographie de l’aptitude des terres est aussi nécessaire. Cela permettra de déterminer leur fertilité selon les régions. D’après l’Isabu, au Burundi, 75% des terres sont acides. Pour que les sols redeviennent fertiles. M. Kaboneka a recommandé l’utilisation de la chaux et le Burundi en a assez. « En 1993, il y avait déjà 600 000 tonnes de chaux identifiées dans différents coins du pays ».
Le pays dispose aussi d’immenses plaines qui devaient être consacrées à l’agriculture. Dans les zones montagneuses, il a recommandé le développement des programmes de lutte contre l’érosion.
Prioriser les variétés locales et promouvoir la recherche
Salvator Kaboneka ne comprend pas pourquoi le Burundi importe des semences. « Moi, j’ai travaillé dans l’Isabu. Je vous dis qu’en collaboration avec les Belges, les Canadiens, etc., on a découvert 21 variétés de pomme de terre, 12 de patate douce, 14 de bananier, 29 de maïs, 18 de sorgho, 48 de riz, 31 de haricot et 11 de soja. Toutes ces variétés peuvent être cultivées au Burundi ».
Si on veut avoir des variétés hybrides, elles peuvent être produites localement. « Là, tu es sûr que même en cas de fermeture des frontières, tu peux avoir des semences. C’est déplorable qu’on ne connaisse plus où se trouvent toutes ces variétés. Il faut une sécurité semencière. Pourquoi importer des hybrides de l’Ouganda alors que c’est possible d’en fabriquer ici ?»
Il faut aussi investir dans la recherche. Pour lui, un programme ne doit pas être segmenté. « Il doit avoir une logique continuum-enseignement-recherche-vulgarisation et développement. » Les structures collaborent et sont complémentaires. Aussi, les résultats des recherches doivent être vulgarisés, portés à la connaissance des agriculteurs et des usagers. « L’agriculture a besoin de la technicité. Il faut un programme de recyclage et de formation des agriculteurs. Il faut une technologie post récolte ».
Pour booster l’agriculture, les statiques ne doivent pas être reléguées au second niveau. « Par exemple, quand on veut mettre en place une usine, il faut prévoir la production qu’on va avoir. La préparation des projets nécessite aussi des statistiques ».
Le professeur Kaboneka a insisté en outre sur la subvention agricole. « L’agriculture est un métier extrêmement à risque. Il faut des subventions. » Cette pratique existe déjà par exemple dans le secteur thé.
Gérer l’eau et privilégier les engrais organiques
« Il faut bien utiliser l’eau. Le Burundi en a tellement. Incompréhensible qu’on ne puisse pas utiliser l’eau dans l’irrigation afin de produire toute l’année », a souligné M. Kaboneka.
Adrien Sibomana, ancien Premier ministre aujourd’hui converti en agriculteur a prévenu que l’usage des engrais chimiques et des pesticides a un impact très négatif sur les terres. « Moi, je fais l’agriculture biologique. Je n’utilise jamais des engrais chimiques et des pesticides. J’utilise du fumier organique et la production est bonne ».
Une idée soutenue par Albert Mbonerane, ancien ministre de l’Environnement qui a insisté sur la nécessité de la gestion du sol. « Il faut utiliser les fertilisants organiques pour protéger les sols. » Il est revenu sur l’importance de la protection de l’environnement dans ce contexte des changements climatiques. Sinon, il devient impossible de développer l’agriculture.
De son côté, Liliane Butoyi, de l’Association des femmes d’affaires du Burundi plaide pour la valorisation des anciennes variétés agricoles. Dans la branche agro-business de l’association, on a commencé à conserver les graines et les semences des anciennes variétés de maïs par exemple. « Sur le marché extérieur, nos produits sont bien appréciés ».
La bonne gouvernance aussi

Olivier Nkurunziza, président de l’Uprona, a soutenu l’idée de la mise en commun des terres comme solution à l’exiguïté des terres cultivables. Seulement, cette pratique n’a pas encore donné des résultats escomptés. « En effet, cela est politisé et on a utilisé de la force sans expliquer aux gens le bien-fondé de cette politique. » Ils n’ont pas adhéré totalement non pas « pas parce que cette politique est mauvaise, mais parce qu’il n’y a pas eu de séances de sensibilisation pour montrer son intérêt ».
Sur les fertilisants, M. Nkurunziza s’est insurgé contre les retards répétitifs observés dans leur distribution. « Ce qui est très irritant, on demande qu’on paie une avance pour la saison B alors que même les quantités sollicitées pour la saison A ne sont pas encore distribuées ».
Il estime que le secteur agricole est négligé même dans le budget national. Or, selon la Déclaration de Maputo adoptée en juillet 2003, au moins 10% du budget de l’Etat devaient être alloués au développement agricole et rural.
La question de la gouvernance a été soulevée également par le politicien Kefa Nibizi. Pour lui, c’est là où réside le nœud du sous-développement agricole. « Certains responsables profitent de l’importation par exemple des fertilisants ou des semences. Ainsi, ils ne vont pas accepter qu’on valorise les produits locaux, qu’on produise des fertilisants suffisants ou des semences localement ».
Dans un pays où il y a de l’eau, de la pluie abondante, il est important de trouver les voies et moyens pour bien aménager et gérer les barrages d’irrigation. « Or, suite à la mauvaise gouvernance, des fonds destinés à ce travail s’éclipsent sans aucune explication. Souvenez-vous du cas du barrage de Kajeke, à Bubanza ! »
Pour sa part, Francis Rohero, un autre politicien, a rappelé que normalement, l’agriculture devait répondre à trois objectifs, à savoir nourrir la population, vendre le surplus et créer du travail. Le grand problème se trouve au niveau des décideurs. « Aujourd’hui, beaucoup de ceux qui sont en train d’investir dans l’agriculture ne visent pas ces trois objectifs. Ils veulent tout simplement avoir des bénéfices, de l’argent sans penser à nourrir la population ».
Le gouvernement à l’œuvre
Pierre Nkurikiye, porte-parole du ministre ayant le développement communautaire dans ses attributions a affirmé qu’il y a des avancées importantes dans le secteur. « Le gouvernement a fourni beaucoup d’efforts dans ce domaine. Ce qui a occasionné une forte production du maïs. Aujourd’hui, il y a bien sûr ce problème de manque de lieux de stockage ».
Sur la valorisation, il existe déjà des unités de transformation de la production agricole. « Seulement, peut-être qu’elles n’étaient pas préparées à cette surproduction ».
M. Nkurikiye a signalé qu’actuellement, la superficie cultivable a été multipliée par trois. Ce qui a fait que même les fertilisants soient insuffisants.
Par rapport à la libération des terres, il a fait savoir que l’Etat est déjà à l’œuvre pour que cette pratique soit étendue au niveau national.
Martin Nivyabandi, chargé du développement au sein du parti au pouvoir, a reconnu que des défis existent. Néanmoins, les efforts du gouvernement pour booster le secteur agricole sont aussi là et ont déjà produits des résultats positifs.
« Le Burundi est l’un des rares pays africains qui importent peu de produits alimentaires. Beaucoup de fonctionnaires et de commerçants ont investi dans l’agriculture et leur vie quotidienne a totalement changé positivement ».
Malgré ces avancées, il a souligné qu’il reste beaucoup à faire pour pouvoir transformer la production et beaucoup exporter en qualité et en quantité.

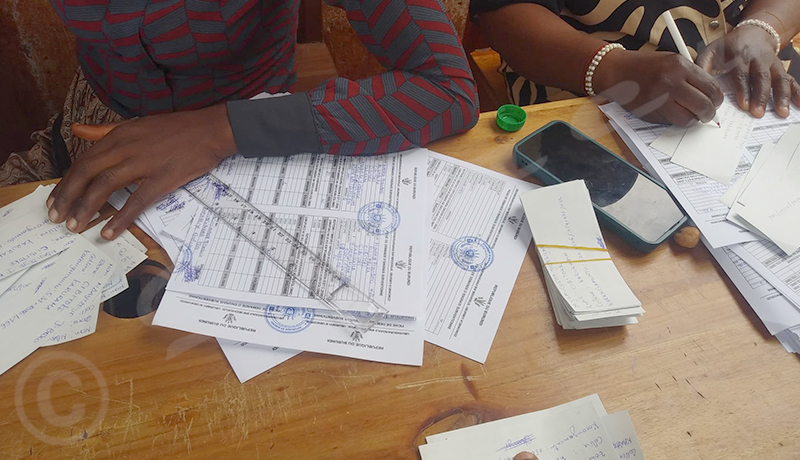











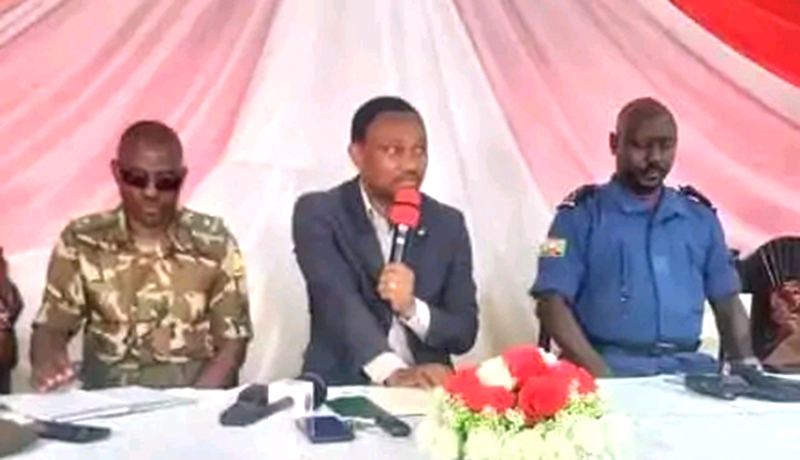










Au problème de l’atomusatuin des terres. C’est une bombe et je pèse mes mots
C’est hallucinant que toutes ces augustes personalités, il n’y a personne qui a osé donner la seule solution censée: LIMITATION DES NAISSANCES
LE BURUNDI EST PLEIN COMME UN OEUF
Erreur sur le tonnage des gisements d’amendements minéraux identifiés en 1993: 6oo millions de tonnes.
Dans le monde donnez nous des exemples de mise en commun des terres et même en Afrique, les greniers villageois n’existent presque plus sauf des communautés isolées et sédentaires. Ujaama a échoue, la villagisation qui était une réplique de l’Ujaama sous la deuxième République. a échoué aussi.
Les fermiers sont des entrepreneurs comme les autres. Quels sont leçons administrés aux acteurs des autres maillons . ils sont rationnels si cette proposition était faisable rationnelle, ils l’auraient fait depuis longtemps. Ils voyagent aussi dans la sous-région s’ils avaient vu des modèles de mise en commun ils en parleraient eux mêmes.
Vous avez raison cher ami Ndimanya