Dans la culture burundaise, nommer un enfant était un acte d’amour et de conscience. Aujourd’hui, c’est devenu- surtout pour les prénoms- une imitation, un geste banal, capricieux, vide de sens. Ce spécialiste des questions sociétales au Burundi fait une interpellation éthique sur la responsabilité des adultes dans la construction identitaire de l’enfant et un plaidoyer pour une société burundaise plus apaisée. Nommer, c’est aussi se projeter autrement dans le vivre-ensemble.
Pourquoi accordez-vous autant d’importance aux noms ?
Parce qu’un nom n’est jamais anodin. Il nous précède, nous inscrit dans une histoire, parfois dans un drame, parfois dans un espoir. Un nom peut élever ou enfermer. Il peut transmettre une blessure ou ouvrir un chemin. Chez l’enfant, il devient souvent la première empreinte identitaire : une parole que l’on porte, que l’on hérite, que l’on finit parfois par incarner. C’est pourquoi les noms porteurs de sens, qu’ils soient négatifs ou positifs ont des conséquences profondes. Ils modèlent l’estime de soi, la façon d’habiter le monde, le regard que l’on porte sur autrui.
Vous vous intéressez de près aux questions sociétales au Burundi. Qu’est-ce que cela recouvre pour vous ?
Ce sont des sujets du quotidien qui façonnent notre façon d’être, de vivre ensemble, parfois sans qu’on en ait pleinement conscience. Des gestes, des pratiques, des choix que l’on croit anodins, mais qui en disent long sur notre histoire, notre rapport au monde et à nous-mêmes.
C’est-à-dire ?
Autrefois, les noms portaient un sens profond, parfois lourd : ils traduisaient les conflits, les soupçons, les blessures, etc. Aujourd’hui, ils deviennent souvent plus doux, plus porteurs d’espoir, presque réparateurs. Mais en parallèle, les prénoms, eux, ont glissé vers quelque chose de plus flou, de plus déraciné. On les multiplie, on les emprunte, on les compose, sans toujours savoir ce qu’on veut dire. C’est une évolution qui me questionne.
Vous disiez que les noms de famille burundais sont chargés de sens. Y aurait-il une certaine évolution ?
Oui, c’est d’ailleurs frappant. Et il faut dire aussi qu’avec le temps, certaines pratiques anciennes ont heureusement évolué. Par exemple, on ne donne plus systématiquement aux enfants les anciens « noms de rang » transmis par le père, comme Nyandwi (le septième enfant) ou les noms attribués aux jumeaux, Bukuru (l’aîné) et Butoyi (le cadet). Ce n’est pas une perte. Au contraire, cela montre que la société commence à sortir d’une logique automatique de transmission pour réfléchir davantage au sens et à la singularité de chaque nom. On commence à nommer les enfants pour ce qu’ils sont, et non uniquement en fonction de la position dans la fratrie.
Pourriez-vous les classer en catégories ?
Une majorité des anciens noms burundais dénotent une mémoire de violence, de toxicité sociale, de méfiance envers les voisins, voire d’accusations voilées. Ils constituent un témoignage brut d’une société qui, par le nom, exprimait ses blessures sans pouvoir les dire autrement. Très souvent, ces noms véhiculaient la nature du rapport au monde extérieur, souvent conflictuel : Baranyanka (Ils me haïssent), Ndimurwanko (Je vis pleinement dans la haine), Nzigirabarya (La rancune les démange). Ce sont des noms profondément marqués par la jalousie, la calomnie, la suspicion.
Aujourd’hui, on observe une évolution : les noms tendent à devenir plus lumineux, plus porteurs d’espoir et d’accueil. Par exemple, Kwizera (Espérer), Muco (Lumière), Arakaza (Qu’il soit le bienvenu), Gatutu (Petite ombre apaisante). Cette transition vers une parole plus bienveillante est un signe encourageant d’apaisement des rapports sociaux.
Et qu’en est-il des prénoms ? Ont-ils suivi la même évolution que les noms de famille ?
Pas tout à fait. Les prénoms, eux, ont connu une transformation différente, parfois plus troublante. Avant, on donnait un seul prénom, souvent simple, tiré de la Bible ou de la tradition chrétienne : Marie, Joseph, Jean. Il accompagnait le nom de famille, sans chercher à se distinguer à tout prix.
Mais aujourd’hui, je ressens un malaise. Le choix du prénom semble devenu un geste banal, parfois même léger, voire capricieux. On accumule les prénoms, parfois trois ou quatre. On les emprunte à d’autres cultures, à des figures médiatiques, à des stars. Quand Barack Obama a été élu président des Etats-Unis d’Amérique, j’ai vu apparaître des « Obama » dans les registres de naissance presque partout au Burundi. Plus récemment : Beyoncé, Cristiano, Kylian. C’est fascinant, mais inquiétant aussi.
Parce que ça manque de sens ?
Exactement. Le prénom devient une sorte de miroir social. On cherche à projeter une image, à briller à travers l’enfant. Mais on oublie qu’un prénom est une parole fondatrice. Il devrait être ancré dans une intention ou une promesse. Dans certaines cultures, le prénom est donné après consultation, prière, ou réflexion familiale profonde. Ici, on cède trop souvent à l’imitation.
Ce que vous soulevez, c’est presque une crise du sens…
Oui. Je le dis parfois un peu crûment. « Dis-moi les prénoms de tes enfants, je te dirai qui tu es. » Derrière chaque prénom, il y a un message implicite adressé à l’enfant et au monde. Quand ce message est creux ou confus, cela peut fragiliser l’identité, voire la continuité culturelle.
Malgré cela, est-ce qu’il y a des signes positifs ? Des raisons d’espérer un retour à des choix plus enracinés, plus conscients ?
On voit émerger une volonté chez certains parents de revenir à des prénoms porteurs de sens, ancrés dans la langue et les valeurs burundaises. Ce n’est pas un retour en arrière, mais plutôt une forme de réconciliation avec ce que nous sommes, et avec ce que nous voulons transmettre.
C’est une manière de transmettre autre chose à l’enfant ?
Oui. Une paix, une promesse, un ancrage. Et dans un contexte où beaucoup d’enfants burundais grandissent entre plusieurs cultures, parfois entre deux continents, le prénom peut devenir un fil rouge, un pont symbolique. Il dit : « Tu viens de quelque part. Et ce quelque part a du sens. »
Finalement, nommer, c’est aussi un acte éducatif ?
Absolument. C’est même un des premiers. Le prénom dit à l’enfant : « Voilà comment je te vois, voilà ce que j’espère pour toi, voilà ce que je veux que tu incarnes ». Et c’est pour cela que nommer doit être un acte d’amour et de conscience. Pas une mode, ni une imitation. Une parole fondatrice.
Si vous deviez résumer en une phrase qu’est-ce que vous retiendrez de cette réflexion sur les noms et prénoms ?
Je dirais ceci : « Nommer, c’est semer dans l’âme. » Chaque nom, chaque prénom, contient une graine de regard sur le monde, une trace de ce que nous croyons, espérons ou redoutons. En choisissant avec attention, avec sens, avec paix, nous donnons à l’enfant plus qu’un nom : nous lui offrons une direction, une mémoire et une force silencieuse.













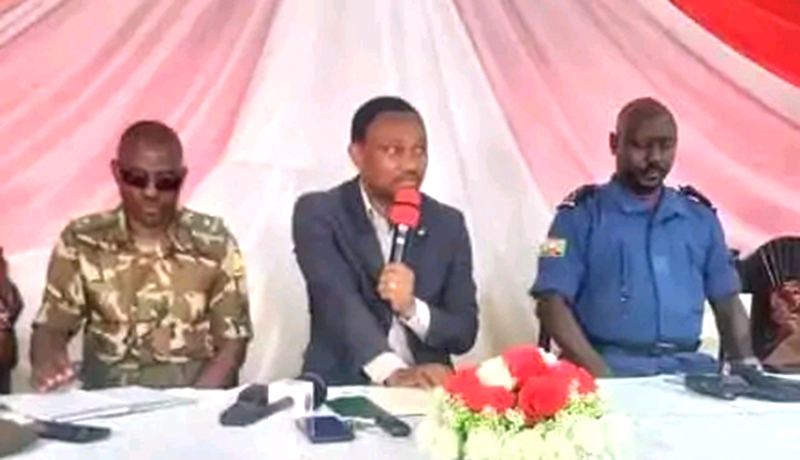










Je suis content de lire ce texte simple mais combien riche.
C’est inquiétant de voir combien certains parents donnent des prénoms presque « insignifiants » à leurs enfants. Ils ne savent pas qu’ils leurs rendent un mauvais service. Bravo à Mr Balthazar
Excellente réflexion, un clin d’oeil textrêmement important.
Merci Mr Balthazar
Excellent contenu. Merci Monsieur!
merveilleux
Kera, bavuga mu Burundi ; « izina, n’umuntu ».