D’une commémoration à l’autre : le Burundi à la recherche de son histoire 2012-2022
André Guichaoua
Sommaire
Préambule
Rétablir l'exception burundaise
Par Antoine Kaburahe

Après les graves traumatismes de 1993 au Burundi et 1994 au Rwanda, dès août 1994 des responsables des universités et ministres de l’enseignement supérieur de la région des Grands Lacs (Burundi, Rwanda, Ouganda, Zaïre, Tanzanie), s’étaient réunies au Kenya avec des universitaires étrangers et des représentants d’ONG des droits de l’homme pour reconstruire leurs universités. Il en était ressorti la création d’un Réseau documentaire international sur la région des Grands lacs africains, indépendant des pouvoirs et ayant pour mission de promouvoir une culture de paix et de lutte contre l’impunité dans toute la région. Entre 1996 et 2009, les bureaux nationaux du Réseau archivaient tous les écrits accessibles des acteurs politiques, économiques et sociaux, et bien évidemment les travaux des universitaires, les numérisaient et les diffusaient via des CD-Roms, puis sur Internet dès que cette région fut connectée*. Des centaines de milliers de pages de documents furent ainsi diffusées. Toutes les universités de la région et les représentants des universités étrangères étaient associés au sein d’une coordination commune pilotée alors par l’Université du Burundi.
Ce cadre indépendant, représentatif et endogène appuyé par des personnalités éminentes suscita une dynamique de solidarité et d’émancipation politique inédite parmi les universitaires et intellectuels de la région qui protégea pendant plusieurs années les libertés d’information notamment au Rwanda et au Burundi et assura un niveau d’expression publique et de publication élevé bien au-delà de la sphère universitaire. L’indépendance a été garantie par des parrainages forts et respectés. Et, bien évidemment, le soutien actif de personnalités burundaises comme Adrien Sibomana qui présida plusieurs années ses organes de direction. Ainsi, l’expérience du Réseau documentaire fera l’objet d’un exposé lors du Sommet mondial de la société de l’information à Genève le 11 décembre 2003. Cette mission s’acheva en 2009 avec le rayonnement d’Internet et la généralisation des ordinateurs. L’expérience du Burundi était devenue une référence.
Une poignée de journalistes et universitaires, inspirés par ce qui avait été réalisé, a alors repris ce projet de documenter l’histoire mais dans un format inédit : à travers des ““Conférences pour mémoire”” sur des sujets et avec des acteurs qui ont marqué notre histoire. Sceptiques, beaucoup nous disaient que “Cela ne marchera jamais”, car les sujets sont encore très “sensibles” ou trop “polémiques”. Première bonne surprise : les principaux médias du pays ont rejoint le projet avec enthousiasme : la RNTB (Radio et Télévision) ; Renaissance (Radio et Télévision) ; Radio Bonesha, Radio Isanganiro, Radio Rema FM, Radio RPA ; les journaux Iwacu et Le Renouveau.
Encouragés par le pluralisme des médias, engagés dans cette aventure inédite, des acteurs politiques de premier plan se sont pliés à l’exercice. Il y a eu les conférences Médias-Mémoire-Histoire au cours desquelles, à la surprise générale, quatre ex-présidents de la République encore en vie acceptèrent de débattre publiquement de leur propre bilan politique.
Les “quatre ex” ont accepté de “regarder l’histoire en face”, au grand bonheur des auditeurs, téléspectateurs et lecteurs. Les Burundaises et les Burundais en redemandaient, nous poussaient à oser aller encore plus loin pour travailler sur des sujets graves, comme les différentes crises politiques qui jalonnent notre histoire, la question de l’intégration de l’armée, etc.
Nous avons tenu des conférences et c’est cela qui était pédagogique, la plupart des intervenants n’étaient pas des politiciens (officiers, hiérarchies religieuses, ONG, etc.) et ce fut la force et le caractère inédit des émissions.
Dans leur diversité, les médias burundais abordaient avec rigueur et gravité notre douloureuse histoire. Lorsque les pouvoirs permettent à la presse de jouer son rôle de veilleuse et éveilleuse des consciences, c’est toute la société qui profite.
Etait-ce l’âge d’or du journalisme burundais ? D’une certaine manière. Mais c’était aussi une sorte de chant de cygne, car mai 2015 est passé par là et a laissé la presse burundaise en ruines fumantes. Ce n’est pas malheureusement un jeu de mots…
Ces notes, ces analyses rassemblées au fil de ces années par le Professeur André Guichaoua, à qui je rends hommage, témoignent de ce qu’a été, à une époque charnière de son histoire, la collaboration entre les journalistes, les universitaires, les autorités et les partenaires étrangers. C’est une collaboration à commémorer et à souhaiter encore. Cette synergie a permis la production de documents qui restent des références. Mais le plus important est que cette collaboration se prolonge aujourd’hui encore avec la publication d’écrits anciens inédits et d’autres récents sur le site d’Iwacu. Elle illustre la continuité de nos investissements respectifs vis-à-vis de ceux qui ont cru en nous. Elle tient pour l’essentiel à ceux qui ont assuré depuis lors et avec détermination la continuité d’Iwacu au Burundi. De même, les autorités ont dépassé leurs réticences et permis cette ouverture : “Une maison portes et fenêtres fermées sent le renfermé”. Les Burundais avaient besoin de respirer. Ils ont toujours besoin de respirer.
C’est aussi l’occasion de penser à tous les collègues de cette époque aujourd’hui éparpillés aux quatre coins du monde, ceux qui essaient de continuer à nourrir la flamme de l’information, de se réinventer. Sans oublier une mention spéciale à la Direction de la Coopération suisse et celle des Pays-Bas qui ont accepté de nous accompagner pendant toutes ces années, délicates, mais riches aussi.
Un proverbe burundais dit que “Uburundi bugona buri maso” (les Burundais dorment les yeux ouverts) et cette “léthargie” de la presse n’est peut-être qu’apparente. Une fois que l’on a goûté à la liberté, on n’en perd jamais le goût…
Antoine Kaburahe, journaliste écrivain et éditeur.
Fondateur du Groupe de Presse Iwacu**
____________
*La coopération suisse dès l’initiative du projet, le Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique (CODESRIA), puis l’UNESCO et l’OCDE-CAD.
**Entre 2013 et 2015, avec ses pairs des médias burundais, il a participé au cycle Médias-Mémoire-Histoire. Depuis novembre 2015, il vit en exil.
“Commémorer pour assumer le passé et construire l’avenir” (2012-2022)[1]
André Guichaoua[2]
Professeur émérite
Institut d’Études du Développement de la Sorbonne
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

À l’occasion du cinquantenaire de l’indépendance du Burundi de 2012, le projet ““Conférences pour mémoire”” porté par des universitaires et diverses personnalités organisait en mai-juin un cycle d’émissions sur l’histoire du Burundi[3]. Il s’agissait d’analyser de manière exigeante, distanciée et plurielle les dynamiques de long terme qui l’entretenait. Caractérisées par une série d’événements douloureux, des traits positifs et porteurs d’enseignements pour l’avenir émergaient. Ces enseignements éclairaient ce qu’était le Burundi à l’orée du 21ème siècle et avaient été placés au cœur de chacune des conférences.
En effet, les indépendances ont progressivement débouché dans l’ensemble de la région sur l’instauration de pouvoirs autoritaires masquant l’instabilité des cadres politiques nationaux. L’usure de ces cadres face aux nouvelles aspirations démocratiques conduisit dans les années 1990 à des conflits d’une extrême violence touchant l’ensemble des pays riverains. Au travers de ces épreuves, le Burundi dégagea progressivement les voies d’une sortie de crise et reconstruisit un cadre politique partagé. Ces acquis furent le résultat d’un processus original de négociation, à la fois laborieux et fécond, qui devait être prolongé et enrichi au regard d’enjeux toujours en suspens.
Dans cette optique, il avait été estimé judicieux de revenir sur l’histoire du Burundi en invitant des acteurs éminents, qui avaient eux-mêmes contribués à écrire cette histoire, à débattre de ces enjeux majeurs au cours de conférences retransmises en synergie sur l’ensemble des médias partenaires[4]. Un panel exceptionnel était proposé caractérisé par le pluralisme des intervenants, leur stature ainsi que leur esprit de dialogue. Sur chaque thématique abordée[5] , il ne s’agissait pas pour ces conférenciers de faire le récit et le bilan de leur action, mais de livrer leurs analyses sur les dynamiques de long terme à l’œuvre au Burundi.

[Carte Nations Unies 2019]
Au-delà des questionnements, quatre objectifs sous-tendaient ce programme :
1. Promouvoir un travail de mémoire objectif offrant des “matériaux” pour l’analyse et non des historiographies préconstruites, dont la qualité serait garantie notamment par la caution universitaire des promoteurs de l’initiative et la représentativité des intervenants. Proposer au travers de ces témoignages des points de repère éthiques et méthodologiques sur les conditions d’un travail de vérité authentique ;
2. Assumer la mémoire de l’histoire du pays, non pas seulement dans une approche de contrition, mais dans une perspective de longue durée ;
3. Proposer des points de repère sur des initiatives qui au travers des crises ont ouvert des voies au dialogue, à la paix et à la démocratie ;
4. Valoriser la parole des acteurs et témoins encadrée par la rigueur professionnelle, la coopération avec les médias et le pluralisme.
Ces objectifs furent atteints au-delà de toutes attentes. Dès la fin du premier débat sur l’intégration des Forces armées, beaucoup de sollicitations affluèrent pour demander qu’il se prolonge sur nombre des points abordés. Le format totalement inédit, la richesse et la qualité des échanges étaient plébiscités. Un second débat fut programmé. Au fil des conférences, comme les déplacements à l’intérieur du pays l’ont démontré peu après, la parole se libérait partout et sur les collines les paysans saluaient en exhibant leurs transistors.
La volonté d’échanger fut contagieuse au sein même des corps de l’État qui voulaient profiter de ces ouvertures pour s’exprimer sur des sujets délicats et/ou occultés. Des réunions-débats, groupes de réflexion, sessions de formations, publications, … se multiplièrent à la demande de nombreuses institutions et organisations notamment au sein des ONGs, des formations politiques, …
Parmi elles, les forces armées furent parmi les plus proactives et motivées et des débats proprement impensables jusqu’alors se déroulèrent avant, pendant et surtout après la matinée de conférences inaugurales de l’Opération Portes ouvertes du ministère de la Défense organisée le 19 juin 2012 en prélude aux cérémonies du Cinquantenaire en présence du chef de l’État. Il s’agissait alors explicitement et, si possible, publiquement de clarifier des “enjeux internes et surmonter les divisions du moment”. Les sollicitations auprès des coordonnateurs du projet “Conférences pour mémoire”se multiplièrent ensuite à la demande des plus hautes autorités militaires et politiques. Ainsi, anticipant la forte probabilité d’un report sine die du lancement officiel du processus national CVR[6] , un volet Vérité et Réconciliation “interne” aux forces de défense et de sécurité fut un temps enclenché.
Peu après cependant, le volontarisme officiel se délitait. Pour l’appareil du parti CNDD-FDD, ces ouvertures s’avéraient incompatibles avec le renforcement de la mobilisation politique des populations en vue des échéances électorales de 2015 dont l’objectif était d’instaurer “la première vraie démocratie plébiscitée avec 95 % des voix”. Les tensions et enjeux en matière de sécurité intérieure et extérieure se durcirent. Il s’agissait désormais de soumettre la “société civile”. Mais en son sein, confortée par les fortes audiences de ses diverses composantes, la qualité et l’indépendance de ses programmes, la Synergie des médias tenait bon.
C’est dans un contexte de tension croissante que fut organisé en février-avril 2015, après de nombreux échanges avec les intéressés, le cycle des émissions “Médias-Mémoire-Histoire” au cours duquel les quatre ex-présidents de la République encore en vie acceptèrent de débatttre publiquement de leur propre bilan politique. À nouveau, le retentissement de ces événements médiatiques fut exceptionnel et le pays tout entier s’arrêtait pour les écouter en direct. Ils étaient aussi diffusés dans les pays voisins et repris par les médias internationaux. Les médias du Burundi se hissaient alors pour quelque temps parmi les plus indépendants et dynamiques du continent. Ces co-productions furent les dernières de la Synergie des médias.
Le 25 avril, l’annonce de la décision du président Pierre Nkurunziza de se représenter pour un 3ème mandat déclencha de fortes et nombreuses manifestations. Les composantes de la Synergie des médias furent interdites d’émettre. Le 14 mai ensuite, au lendemain d’une tentative de coup d’état militaire, la plupart des médias privés étaient anéantis et la glaciation durable des libertés publiques s’instaurait.
Au fil de ces années, parallèlement à cet investissement, la rédaction d’une synthèse historique “distanciée” du passé avait été engagée. Elle était nourrie par de nombreux échanges avec les multiples personnalités politiques, militaires, religieuses et autres acteurs qui ont accompagné les événements et porté ces prises de parole au cours de ces années et bien au-delà pour nombre d’entre eux. La mise en forme de ces notes et archives accumulées et “co-débattues” en propose une rétrospective. En outre, plusieurs notes d’analyse rédigées lors des enquêtes et échanges effectués au cours de nombreux séjours notamment entre 2009 et 2016 illustrent et documentent l’exposé historique consacré à la dernière décennie (cf. infra).
Enfin, relevons qu’elle s’est achevée par un événement marquant puisque le 25 mai 2020, le général Évariste Ndayishimiye qui, en 2011, avait inauguré et fortement marqué le cycle des “Conférences pour Mémoire”, a été élu à la Présidence de la République.
Tout comme son prédécesseur en 2010, il disposait alors de deux années pour s’imposer, définir les objectifs de son mandat et marquer de son empreinte les deux commémorations décennales majeures de 2022 : le 29 avril, le 50ème anniversaire des “événements de 1972” puis le 1er juillet, le 60ème anniversaire de l’Indépendance nationale.
Mais au regard des fortes contraintes politiques et économiques qui s’imposent présentement au pays, l’échéance était assurément trop brève pour être en mesure d’afficher son propre bilan. Les récentes avancées politiques et économiques dont le Président peut désormais se créditer[7] ne suffisent pas à masquer les fragilités du cadre démocratique et plus encore à remédier à l’impuissance structurelle des autorités face à l’extrême misère qui affecte la majorité des populations laborieuses, notamment rurales.
Dans ce contexte difficile, les commémorations lui donnent la double opportunité de s’exprimer sur l’héritage du passé, l’état des lieux présent, ses priorités et perspectives.
André Guichaoua, Paris, juin 2022
Ce texte a été rédigé en s’appuyant en partie sur des notes d’analyses réalisées au fil de multiples missions réalisées en 2009 et 2016. Dans une dynamique de publicité des sources, elles sont accessibles aux lecteurs. Des références y sont faites au fil du texte avec des liens. Le sommaire est indiqué en fin de document.
1. L’Indépendance désenchantée (1959-1965)
Les débats onusiens sur l’émancipation progressive des territoires sous Tutelle débouchent au Ruanda-Urundi sur la publication en 1952 d’un décret mettant en place une série hiérarchisée de conseils, des sous-chefferies au Conseil supérieur du pays. Nommé en 1955, le gouverneur général, Jean-Paul Harroy, décide d’organiser une consultation au suffrage universel en 1956. Il s’agit par ce biais de répondre à la double volonté d’émancipation des élites tutsies ou issues des lignages royaux et des populations discriminées et exploitées sensibles aux luttes pour l’indépendance qui a gagné le continent africain. Une double préoccupation énoncée dès 1955 par le pape Pie XII qui éclaire le revirement majeur de la hiérarchie catholique exprimé par Mgr André Perraudin, évêque de Kabgayi, en mars 1956.
Ainsi, désireuses de contrecarrer l’influence des revendications indépendantistes parmi les élites princières du Ruanda et de l’Urundi et de conserver une implantation régionale déjà fortement compromise au Congo belge et au Burundi voisin, les autorités coloniales apportent leur soutien aux cadres hutus militant en faveur d’une “Révolution sociale” au Rwanda. Le brouillage des références politiques et idéologiques qui résulte de l’affrontement entre des élites indépendantistes tutsis soutenus par les porte-parole anticolonialistes et progressistes du Tiers-Monde et leurs “serfs” hutus en quête d’émancipation sous la double tutelle de l’administration belge et de la haute hiérarchie catholique expatriées explique pour une large part l’extrême simplification des formes de mobilisation des partisans respectifs des deux causes.
L’impact délétère de la “Révolution sociale” rwandaise
Pour le PARMEHUTU (Parti pour l’émancipation des Hutu) qui s’impose au Rwanda, il ne s’agit pas seulement d’abolir les privilèges politiques et économiques tutsis et le contrôle des filières de promotion, mais de chasser la minorité d’“envahisseurs hamites” et rendre le pays aux Bahutu, ses propriétaires légitimes. La nouvelle idéologie républicaine va alors s’intégrer sans difficulté dans les schémas politiques hérités, à base d’exclusive politico-ethnique utilisée désormais contre les anciennes élites et, de fait, tous les membres de l’ethnie bannie. Aggravé par les manœuvres des autorités coloniales, ce contexte passionnel explique les violences qui accompagnent au Rwanda la “Révolution sociale” de 1959, la proclamation de la “République de Gitarama” en 1960, puis l’exil du roi Kigeri après le référendum sur l’indépendance de 1962.
En 1963, deux séries d’incursions armées de réfugiés tutsis rwandais installés et équipés au Burundi tentent de reprendre le pouvoir. Ces incursions sont arrêtées in extremis aux portes de Kigali ce qui déclenche de nombreux massacres notamment des dirigeants des partis protutsis et de nouveaux départs massifs de réfugiés tutsis. Des phases d’apaisement et des résurgences meurtrières se succèdent ensuite jusqu’au début des années 1970. Malgré les spécificités de son héritage historique et les tentatives de démarcation maintes fois manifestées, le Burundi subira le contrecoup de ces affrontements qui cristalliseront l’appartenance ethnique.[8]
À la mi-1959, la création d’une vingtaine de partis nourrit le débat sur le rythme et l’ampleur du processus d’émancipation vis-à-vis de l’administration coloniale[9]. Les deux plus importants portent les intérêts rivaux des deux grands lignages princiers, Bezi et Batare. Le premier, l’Uprona (Unité et Progrès National) fondé par Louis Rwagasore, le fils ainé du roi Mwambutsa, regroupe les principaux leaders monarchistes et indépendantistes du pays. Le second, le Parti démocrate-chrétien (PDC), fondé par les membres du clan concurrent des Batare de l’aristocratie ganwa autour de Pierre Baranyanka et soutenu par l’administration belge, est favorable à une indépendance tardive. Une troisième composante, avec notamment le Parti du peuple (PP), ne conteste pas la tutelle, soutient la monarchie constitutionnelle mais formule de fortes revendications socio-économiques en faveur des démunis. Tous les partis rassemblaient des Tutsis et des Hutus.
En septembre 1961, dans le cadre de la monarchie constitutionnelle, les premières élections législatives plébiscitaient, contrairement à la révolution rwandaise, une politique d’“adaptation conservatrice” et portaient au pouvoir Louis Rwagasore, détesté par le colonat belge qui soutenait le PDC, écrasé lors du scrutin. Son assassinat en octobre ouvrait une longue période d’instabilité au sein d’institutions faibles. Avec la proclamation de l’indépendance en juillet 1962, puis la mise en œuvre de la nouvelle constitution d’octobre 1962 qui consacre le Roi comme le vrai chef de l’État, le vide politique engendré par l’assassinat de Rwagasore avive les compétitions pour l’accès aux nouvelles fonctions et ressources internes entre les divers prétendants à l’exercice du pouvoir. Si le pouvoir législatif s’exerce conjointement avec les Assemblées, le Roi est assisté d’un conseil de la Couronne consultatif, nomme et révoque les ministres. Mais, depuis novembre 1961, l’élément décisif du pouvoir est le commissaire à la Garde nationale, appelée ensuite Défense nationale, qui dépend directement du Roi. En juillet 1962, Zénon Nicayenzi (tutsi, Gitega) est nommé secrétaire d’État à la Défense nationale. En mai 1963, il est remplacé par le capitaine Michel Micombero (tutsi, Bururi) doublé d’un secrétaire d’État à la Gendarmerie nationale Pascal Magenge (ganwa tare, Kayanza).
Un monarque impuissant face aux divisions politiques, claniques et ethniques
Formellement maître du jeu, le mwami Mwambutsa s’avère incapable de maîtriser les ambitions et calculs entre le gouvernement, les assemblées et les dirigeants du parti majoritaire, l’UPRONA. Devenu un quasi parti unique, il est dominé par les rivalités fratricides entre les membres des grands lignages Baganwa (Bezi et Batare), les oppositions régionales et les compétitions entre élites tutsies et hutues. Un dualisme du pouvoir s’instaure : les majorités issues des urnes sont transgressées, les élections au sein de l’UPRONA faussées. Au rythme des complots présumés, la valse des gouvernements s’accélère mais les deux secrétaires d’État demeurent intouchables.
Deux tendances se consolident au sein de l’Uprona et du Parlement : le groupe de “Monrovia” pro-occidental (à dominante hutue) et le groupe de “Casablanca” tiers-mondiste (à dominante tutsie) avec chacun diverses tendances et soutiens étrangers. Dans le contexte de la guerre froide d’alors, la guerre civile en cours au Congo déborde dans les pays voisins et Bujumbura devient une base d’appui chinoise pour l’assistance à la rébellion de Lumumba au Kivu. En 1964, apparemment équipés eux aussi par la Chine, des réfugiés rwandais créent au Burundi une Armée populaire de libération qui accentue la radicalisation ethniste nationale.
En 1965, les événements nationaux s’accélèrent. Le 15 janvier, Pierre Ngendandumwe, Premier ministre (hutu de Muyinga et membre du groupe de Monrovia) désireux de surmonter les divisions politiques, claniques et ethniques est assassiné par un réfugié tutsi rwandais après l’annonce de la formation d’un gouvernement “équilibré”. Parmi les commanditaires présumés figurent plusieurs leaders tutsis du groupe “Casablanca”. Le mwami Mwambutsa suspend alors les activités de la Jeunesse nationaliste Rwagasore (JNR) agissant comme milice protutsie. Mais la procédure judiciaire n’est pas menée à son terme.[10]
Le 23 mars 1965, la dissolution du gouvernement ouvre une période de transition pendant laquelle le mwami tente à nouveau d’imposer son autorité et préside un Cabinet de secrétaires d’État placés sous son autorité directe couvrant l’essentiel de l’activité gouvernementale. Il remplace aussi l’ensemble des bourgmestres élus par des administrateurs nommés. Le 10 mai, le Parlement dissous est renouvelé. Lors de cette première élection organisée depuis l’indépendance, les deux-tiers des élus sont hutus, issus de l’UPRONA et du Parti du peuple, comme au Sénat, mais le mwami ne parvient pas à nommer un Premier ministre reflétant la majorité politique issue des élections d’investir les deux chambres. Le 29 septembre, il nomme un proche, Léopold Bihumugani (ganwa bezi, Muramvya), à la tête d’un gouvernement dominé par les secrétaires d’État.
Les 11 et 18 octobre, deux tentatives de coup d’État échouent. Le premier était conduit par le lieutenant Albert Shibura (tutsi hima, Bururi), lors du second le capitaine Fidèle Ndabahagamye (hutu, Kayanza) menait le commando. Des militaires et politiciens hutus, dont le commandant Antoine Serukwavu (hutu, Kirundo), secrétaire d’État à la Gendarmerie, sont mis en cause. Le mwami s’enfuit au Congo et se met sous la protection de militaires belges avant de gagner l’Europe. Des massacres de centaines de Tutsis ont lieu dans plusieurs localités de la province de Muramvya. Le 20 octobre, un “régime militaire” est instauré dans toutes les provinces du royaume. Les forces armées avec le concours des jeunesses de l’UPRONA enclenchent alors une répression ethnique sanglante menée par le secrétaire d’État à la Défense, le capitaine Michel Micombero, officier tutsi du clan des Bahima dans la province de Bururi[11] , et le secrétaire d’État à la Justice, Arthémon Simbananiye (tutsi Hima, Bururi). Elle n’épargna aucun ministre, député, sénateur, officiers ainsi que la plupart des hauts fonctionnaires, dont l’emblématique leader de l’UPRONA, Paul Mirerekano. Le groupe de “Monrovia” est anéanti (19960816 Bur. CS NU 682 F, § 83, § 81 p. 22 sqs et CS/725 28 août 1996). Les divers diplomates en poste estiment qu’entre octobre 1965 et janvier 1966, la répression fait de 2000 à 5000 victimes.
Le partage du pouvoir entre Tutsis et Hutus, qui prévalait à des degrés divers depuis l’indépendance, prend fin. Ces massacres inscrivent durablement la fracture ethnique dans la mémoire collective. Parallèlement à l’éviction des élites hutues, les exclusives ethniques renforcent les frustrations des uns et les stratégies sécuritaires des autres. La vie politique se dégrade en une succession de complots réels ou supposés. En juillet 1966, Mwambutsa s’exile en Suisse après sa destitution par son deuxième fils, Charles Ndizeye (Ntare V). Lui-même est déchu en novembre 1966 par le capitaine Michel Micombero (26 ans) qui proclame la République.
2. L’instauration d’une dynastie républicaine au rythme des coups d’État militaires (1966-1993)
La première République du capitaine Michel Micombero (1966-1976)
Cette consécration préparée de longue date marque l’installation au pouvoir du “groupe de Bururi”. Le 28 novembre 1966, Michel Micombero (tutsi, Bururi, commune Rutovu) nomme un Conseil national de la Révolution et des gouverneurs militaires de provinces contrôlés par des originaires de Bururi. Promu colonel, il devient Président de la République, chef du gouvernement et ministre de la Défense nationale. L’UPRONA est proclamé parti unique d’où procède toutes les institutions de la République, y compris la justice. Les Indarangavye (“ceux qui restent éveillés la nuit”), militants de la nouvelle Jeunesse révolutionnaire Rwagasore (JRR), assurent l’encadrement de proximité des citoyens.
Comme avant la République, les remaniements et révocations de ministres, des officiers des forces armées et des dirigeants de l’UPRONA se succèdent ainsi que les faux et vrais “complots”. En septembre 1969, dans un contexte de vive tension diplomatique notamment avec la Belgique, les USA et le Congo[12] , la découverte d’une conjuration financée “de l’étranger” débouche sur la condamnation de nombreuses personnalités hutues. En décembre, 25 ministres et militaires sont exécutés[13]. En juillet 1971, un autre procès vise cette fois d’anciens ministres et officiers tutsis Banyaruguru de Muramvya liés à la monarchie. Mais contrairement à celui de 1969, la gestion confuse de ce procès antimonarchiste divise la classe politique tutsie et exacerbe le régionalisme entre Bururi et le reste du pays, suscitant de vives tensions dans la capitale et l’indignation internationale. Après le verdict, les peines de mort sont commuées et les condamnés finalement libérés.
Le 20 octobre 1971, un nouveau Conseil suprême de la République de 27 officiers est installé dont 3 Hutus et 15 originaires de Bururi. En février 1972, le chef de l’État et chef du parti UPRONA renouvelle le secrétaire national du parti (André Yanda) et les secrétaires généraux des mouvements intégrés (Clémence Nahimana à l’UFB et Émile Mworoha à la JRR). En mars 1972, invité à regagner le Burundi, l’ex-mwami Ntare V, est arrêté à son arrivée, emprisonné puis exécuté le 29 avril. Le même jour, la radio nationale annonce la révocation du gouvernement et du secrétaire national de l’UPRONA puis l’installation par Michel Micombero d’un cabinet ethniquement et régionalement homogène restreint aux ministères stratégiques.
Informés de l’agitation prévalant en divers lieux de la province de Bururi (actuelles Makamba, Bururi, Rumonge) les ministres de l’Intérieur et de l’Information sensibilisent les cadres de la province sur des attaques imminentes de rebelles hutus, afin d’organiser leur défense et dissuader la population de les suivre. Une insurrection de “Hutus formés à l’étranger” (19960816 _Bur. CS NU 682_F, p. 22, § 85) cible des populations tutsies notamment à Rumonge, Nyanza-Lac et Vyanda. Le 30 avril, des gouverneurs militaires sont nommés dans toutes les provinces. Les insurgés font plusieurs milliers de victimes en quelques semaines avant d’être définitivement anéantis par les forces armées. Celles-ci, appuyées par la JRR, mène une méthodique répression anti-hutue pendant plusieurs semaines. Dans toutes les provinces et secteurs d’activité, les Hutus scolarisés ou éduqués, commerçants ou paysans présentant des signes extérieurs de richesse sont systématiquement éliminés (Iwacu Magazine, n°5, p.5-36). Plus de 100.000 Hutus et plusieurs milliers d’opposants au régime, essentiellement des Tutsis Banyaruguru furent victimes. Le Zaïre, la Tanzanie et le Rwanda accueillent 200.000 réfugiés.
L’interrogation du rapport onusien : “le génocide sélectif commis au Burundi est-il fondamentalement d’inspiration politique ou d’inspiration ethnique ?” (E_CN.4_Sub.2_1985_6-FR-3, pp.12, 20 et 23) associe en fait les deux dimensions. La République se transforme alors en une brutale dictature militaire, menée par un homme adulé à la tête d’un Parti-État qui outre les exclusives héritées, évince jusqu’à ses alliés de la commune voisine et rivale de Matana.
Après avoir écrasé les diverses incursions armées d’opposants réfugiés aux frontières puis obtenu leur neutralisation grâce aux présidents rwandais et zaïrois, Juvénal Habyarimana et Joseph-Désiré Mobutu, Michel Micombero s’octroie un second mandat en juillet 1974. Il promulgue une nouvelle Constitution sans assemblées, ni élections populaires. Élu secrétaire général du parti unique UPRONA par des électeurs auto-désignés et, par là-même, Président de la République, il conserva le pouvoir par la terreur pendant encore deux ans.
Mégalomane et piètre gestionnaire, il est renversé le 1er novembre 1976 lors d’un coup d’État organisé par un officier de sa commune pour sauver un pays traumatisé et exsangue. Après quinze années d’indépendance marquées par l’inconstance politique institutionnalisée instaurée par le régime monarchique finissant et la sinistre décennie de ségrégation sociale et politique et de traumatismes, la seule annonce de cette destitution suscita d’emblée un large soulagement.
La seconde République du lieutenant-colonel Jean-Baptiste Bagaza (1976-1987)
Peu connu du public, le chef d’État-major général-adjoint des forces armées installa, le 2 novembre, un Conseil Suprême Révolutionnaire composé de 30 officiers tutsis dont 14 originaires de Bururi. De même, parmi les 19 membres du gouvernement nommés à partir du 13 novembre, 15 sont tutsis, 8 proviennent de Bururi. Outre l’éviction des éléments tutsis les plus radicaux, la seule ouverture politique marquante est la nomination d’un Premier ministre originaire… de la commune rivale de Matana.

Muet sur les traumatismes de la Première République, il propose une politique de “réconciliation nationale” et de saine gestion. Les deux premières années de la seconde République sont consacrées à rétablir l’autorité de l’État par une démocratisation contrôlée dans le cadre de l’UPRONA, restructuré à partir de 1977[14] , suivi du retour à un régime civil (référendum constitutionnel de 1981, élections législatives de 1982).
Plusieurs mesures progressistes et d’union nationale impactent les populations, notamment rurales : suppression de l’impôt de capitation dès l’année fiscale 1977 ; abolition des droits séculaires de prestations de travail et/ou de récoltes pour l’exploitation des terres (ubugererwa) ; récupération des terres domaniales et privées accaparées par les politiciens et fonctionnaires de l’ancien régime (notamment celles des exilés de 1972-1973). Accompagnées d’une refonte de l’administration communale, ces avancées majeures pour la sécurité économique des agriculteurs permettent un changement notable du climat politique et incitent de nombreux réfugiés à regagner leurs collines d’origine.

Jean-Baptiste Bagaza profite aussi d’une conjoncture économique internationale favorable. Des cours du café élevés, d’importantes liquidités sur les marchés et des financements internationaux permettent de mener une politique ambitieuse d’investissements. Le visage du Burundi est rapidement bouleversé : construction d’infrastructures, urbanisation des centres provinciaux, équipement des quartiers périphériques de la capitale, désenclavement et mise en valeur de l’est du pays, reconstitution à long terme du potentiel de fertilité agricole (reboisement, café, thé, …).
La force et l’efficacité du régime repose sur l’étroite symbiose avec l’appareil du parti unique. Du sommet de l’exécutif à l’encadrement des populations laborieuses en passant par les diverses administrations gestionnaires, il fonctionne comme un système rhizomique de pompage puis de redistribution des ressources nationales et internationales notamment via les projets de développement. C’est lui qui, ensuite, structure et nourrit les chaines clientélistes depuis les négociations avec les bailleurs de fonds jusqu’aux réalisations des projets. Ainsi, dans les programmes agricoles, la part des financements initiaux parvenant effectivement aux bénéficiaires finaux ne dépassent guère 20-30%. Les compromissions affairistes des élites et les ponctions illicites sur la sphère économique privée varient selon l’ampleur des investissements étatiques.
En 1986, à l’heure des ajustements structurels imposés par le retournement de la conjoncture économique, le Burundi bénéficie d’une dévaluation allégée avec une dette extérieure de 70 $ par habitant. Mais avec 47 $, le Rwanda réussit à différer toute dévaluation et continua à bénéficier des faveurs des bailleurs de fonds internationaux. La performance rwandaise humilia les autorités burundaises, et décupla le mécontentement des populations rurales et des producteurs sur lesquels reposaient les mesures d’austérité économiques.

Dans l’esprit des producteurs, la modernisation sous contrainte est assimilée à la reproduction budgétivore de monstres bureaucratiques dont les Sociétés régionales de développement sont la caricature. Le carcan politico-administratif autoritaire focalise les critiques. La principale concerne les faibles bénéfices retirés des productions exportables en période faste et de l’intense mobilisation imposée pour promouvoir des approches technocratiques (politique de villagisation et surtout les thèmes agronomiques vulgarisés : éclaircie de la bananeraie, semis en ligne, …) qui dans les faits compromettent la sécurité alimentaire des ménages agricoles. La seconde, explicitement politique, résulte de l’impuissance à jeter les bases d’une décentralisation effective, non pas vers les provinces où les commissions provinciales de planification redoublent le modèle autoritaire et hiérarchique national, mais vers les communes pourtant proclamées “cellules de base du développement”. Ainsi, les petits producteurs ne profitent guère de la “modernisation” agricole, le régime se révèle impuissant à assurer un équilibre régional des investissements, à instaurer une décentralisation effective face à un encadrement bureaucratique omniprésent, autoritaire et prédateur.
Plus fondamentalement, malgré certains efforts notables, le régime n’a pas voulu affronter le blocage désormais essentiel où se joue l’avenir des conflits “ethniques” : l’ouverture des filières d’accès à la ville aux jeunes générations rurales. Celles-ci restent massivement contrôlées “ethniquement” (enseignement secondaire long et universités, intégration dans la fonction publique, contrôle des embauches dans le secteur structuré privé et parastatal, etc.). Une impuissance durable envers des tendances lourdes inscrites dans les réflexes sociaux les plus profondément enracinés parmi les cadres en général et les couches urbaines fonctionnarisées. Enfin, malgré la montée des critiques et des oppositions, le débat politique reste strictement contrôlé et la liberté d’expression disparait face à la peur qu’inspirent les services de renseignement. Le conflit avec l’Église autour duquel s’est dénoué le sort du régime n’est que la forme la plus visible de cette dérive policière.
Ces pratiques et l’incapacité à traduire en actes les résolutions affichées ne sont pas originales, mais ce qui a changé au fil des années du règne du Président Bagaza tient à la maturité et au niveau d’exigence politique croissants des populations urbaines et rurales. Elles s’interrogent ouvertement sur la corruption, la démocratisation, des alternances sans coup d’État, les procédures électorales, le rôle des assemblées, l’élection des administrateurs communaux, etc. Soulignons aussi que les prestations sociales des paysans ont baissé partout notamment en raison des départs contraints de missionnaires qui les assuraient. Ce désengagement imposé aux missions illustrait par contraste l’absence de volonté des autorités de doter le pays d’infrastructures sociales publiques à la hauteur des besoins, d’y nommer des employés stables et honnêtes, d’assurer la maintenance et les approvisionnements vitaux (médicaments, ouvrages scolaires, etc.). Misant sur ce désenchantement, les fortes incidences de l’effondrement des cours du café sur les marchés mondiaux en 1987 donnaient argument aux opposants pour dénoncer dans une conjoncture déprimée les détournements au sein de la filière, les emprunts malheureux, les contrats industriels ou d’ingénierie douteux. Le 3 septembre, le major Pierre Buyoya, originaire de la même commune que Bagaza, s’emparait du pouvoir.
Manifestement, le Président Bagaza s’est illusionné sur son lien politique présumé avec la paysannerie tel qu’il s’exprimait lors de ses grands meetings participatifs organisés sur les collines. Ses propos demeuraient souvent bien éloignés des pratiques effectives des autorités locales.
La troisième République du major Pierre Buyoya (1987-1993)
Le coup d’État militaire du 3 septembre 1987 s’apparente à une alternance gouvernementale revenant à l’esprit des débuts de la deuxième République. Les éléments de continuité ne manquent pas[15]. Deux décisions marquantes accompagnent son installation : la libération de nombreux prisonniers politiques et la dénonciation de l’affairisme suivie de l’arrestation de personnalités du gouvernement. Elles libèrent l’expression de revendications démocratiques.
Mais le baptême du feu ne tarda guère. En août 1988, dans le nord-est du pays, des tensions locales avec les autorités, avivées par l’activisme d’opposants prohutus réfugiés au Rwanda, déclenchent des massacres anti-tutsis dans les communes de Ntega et Marangara suivis d’une violente répression militaire. On décompte plusieurs milliers de victimes principalement hutues et 60.000 réfugiés au Rwanda. La gestion de cette crise illustre les démarcations au sein du pouvoir. Parmi les forces armées d’abord, l’usage proportionné de la force vis-à-vis des populations hutues préconisé par le ministre de l’Intérieur, le colonel Aloys Kadoyi, est délibérément outrepassé par les militaires sur place. Au sein de l’opposition hutue ensuite, où des groupes radicaux prônent l’autodéfense armée. Sous pression, la Présidence s’empresse de régler la crise dans les deux provinces assurant la reconstruction et le retour de la quasi-totalité des réfugiés dès 1989. Les concertations étroites alors établies entre la Présidence, des ambassades et bailleurs de fonds (notamment la Banque mondiale qui lança à cette occasion son 1er programme de “conditionnalité politique”) permirent cette issue rapide, positive et surtout étonnante. De passage au Rwanda peu après la publication du rapport d’enquête effectué par des universitaires sur cet épisode (cf. Bibliographie), le Président Habyarimana sollicita un exemplaire puis un entretien pour “bien comprendre” pourquoi son vis-à-vis “avait pu cautionner une telle étude” !
Au plan national, l’ouverture d’un débat public sur l’“unité nationale” accompagne la nomination en octobre d’un gouvernement à parité ethnique dirigé par un Premier ministre hutu, Adrien Sibomana. La transition voulue par le tandem Buyoya-Sibomana (cf. Iwacu supra, pp. 26-33) permet des avancées considérables sur la démystification du tabou ethnique et la réinsertion politique des oppositions.

L’arrivée de ministres hutus rétablit une émulation positive entre fonctionnaires des deux ethnies. Des négociants hutus occupent progressivement une place non négligeable. Des pas importants sont franchis sur la transparence et l’État de droit. Si la solidité de l’exécutif permet de contenir les extrémistes, la conquête des droits démocratiques et l’apprentissage des règles de la confrontation pacifique suscitent d’énormes résistances des noyaux politiques et régionaux qui contrôlent les institutions majeures de l’État (armée, justice, ambassades, enseignement supérieur et secondaire, etc.) et/ou se sont assurés la maîtrise des ressources nationales du pays.

Après cinq années d’ouverture menée selon un rythme effréné (commissions nationales, Charte nationale, Constitution, élections présidentielles puis législatives), non seulement le couple a tenu, mais le déroulement des élections du 1er juin 1993 et la victoire finale – inattendue – du candidat de l’opposition sont décrits dans les médias internationaux comme un signe fort de vitalité démocratique. Succès personnel de deux hommes et victoire collective de tout un peuple qui élisait pour la première fois de son histoire ses dirigeants dans le cadre d’un scrutin démocratique au suffrage universel. Pour le Président et le Premier ministre, achever normalement leur mandat est déjà en soi une prouesse. Dans l’histoire du Burundi indépendant, aucun chef d’État ou Premier ministre n’a jusque-là quitté volontairement le pouvoir.
Les équipes gouvernementales, ouvertes à des apprentis ministres, démontrent aussi que le pays disposait de personnalités déterminées à faire taire les démons ethniques. Elles ont assimilé des principes de rigueur gestionnaire (lutte contre la corruption, installation d’une Cour des comptes…), sauvegardé les grands équilibres économiques sans démagogie excessive, introduit la compétition politique, libéré la presse et, pour l’essentiel, garanti les droits de l’homme.
L’élection d’un Président hutu, Melchior Ndadaye, puis d’un Parlement dominé par ses partisans du FRODEBU[16] constituaient l’ultime étape d’un processus de transition exemplaire en Afrique et de retour à un pouvoir civil. La dignité de l’équipe sortante, les fermes engagements du nouveau Président en faveur du respect des droits de l’homme et de la démocratie, une large amnistie politique et le retour amorcé des réfugiés de 1972 ouvraient la voie à une réconciliation nationale durable.
3. Des putschs militaires à la guerre civile (1993-2006)
Les mauvais perdants
Le 3 juillet, un mois après l’élection du Président Melchior Ndadaye et avant même son installation, une première tentative d’assassinat (UN Report, §.41) démontrait que le soutien des extrémistes tutsis au Président Buyoya tenait principalement à sa capacité de retarder ou d’empêcher la remise en cause des “vrais” pouvoirs (le contrôle des postes stratégiques des forces armées et des filières d’enrichissement). La haine vouée aux Hutus de l’UPRONA partisans d’une stratégie pacifique d’ouverture démocratique illustrait le sentiment profond de trahison ressenti lors de ce dénouement électoral estimé inconcevable.
L’événement marqua les esprits mais n’eut qu’un impact limité. Parmi la population, personne ne doutait que le vote massif des paysans en faveur du FRODEBU avait été un acte délibéré et pesé. En ne votant pas pour l’UPRONA, ils prenaient acte des proclamations démocratiques du pouvoir et s’estimaient en mesure d’assumer les conséquences de leur vote. Dans ce contexte, le Président Ndadaye nomma un gouvernement d’unité nationale dirigé par une Première ministre, Sylvie Kinigi, tutsie de l’UPRONA. Au cours des trois mois de transition démocratique précédant l’assassinat du Président, le 21 octobre, les deux blocs politiques évoluèrent de manière contradictoire (UN Report, § 42-45). Au sein du FRODEBU s’instaura rapidement une “culture de pouvoir” et une distanciation marquée vis-à-vis du PALIPEHUTU qui avait appelé ses militants à voter pour Ndadaye et le FRODEBU.
À l’inverse, au sein de l’UPRONA, de nouveaux chefs de guerre dénonçant le “coup d’état ethnique” débordaient la direction pluriethnique en menaçant de rejoindre les partis extrémistes tutsis. Ainsi, François Ngeze, ex-ministre de l’Intérieur (hutu) soupçonné de sympathies envers les putschistes du 3 juillet, se posant en rival personnel du Président Ndadaye, devint le héros des meetings de l’UPRONA pendant le mois d’août. Des propos aux actes, il franchit le pas le 21 octobre 1993 Ndadaye en devenant, “par devoir”, le chef du Comité de salut national mis en place par des putschistes, entraînant avec lui dans l’opprobre et la vindicte l’ensemble des Hutus de l’UPRONA.
Déclenché dans une improvisation apparente par la troupe et les sous-officiers, mais “couvert” par des personnalités politiques et militaires en retrait, le coup d’état (UN Report, §185-188) se révèle politiquement dévastateur. En effet, à la fin octobre, la nouvelle administration, qui n’a pas encore eu le temps d’installer ses nouvelles équipes, ni de mettre en œuvre la politique pour laquelle elle a été élue, bénéficie d’un large crédit national et international. L’assassinat des principaux responsables de l’État semble confirmer alors les thèses des militants extrémistes pro-hutus selon lesquels la haine ethnique constitue l’alpha et l’oméga de l’analyse politique.
Au regard des traumatismes et des réflexes d’autodéfense du passé, les électeurs du FRODEBU, très majoritairement favorables au changement par les voies démocratiques, s’estiment collectivement responsable de la défense des institutions nationales décapitées. Ainsi, dès l’annonce de l’assassinat du Président, “des combats intercommunautaires intensifs ont éclaté, affectant notamment les provinces de Ngozi, Bubanza et Kirundo. On estime qu’environ 50.000 personnes, principalement des Tutsis, ont été tuées et 700.000 autres ont fui vers le Rwanda, la Tanzanie et le Zaïre ou ont été dispersées au Burundi. Dévastation et destruction s’ensuivirent.” (§ II.C). La violence des affrontements et massacres contre les Tutsis ne relève plus alors d’un soulèvement suicidaire de groupes isolés comme en 1965, 1969, 1972 ou 1988 voulant forcer le destin, mais de l’expression d’une volonté politique déterminée à défendre un pouvoir agressé (cf. § 189-198).
Mesurant la résistance des populations rurales, le rejet de la société civile et des Églises, le désaveu unanime de la communauté internationale, l’existence d’officiers loyalistes susceptibles de rompre la solidarité du corps, des officiers séditieux et des cadres complices de l’UPRONA hésitent et se désengagent. Ainsi, le 24 octobre, constatant l’incapacité du Comité national de salut public à contrôler le pays qui sombre dans la guerre civile, des officiers de l’état-major appellent les ministres réfugiés pour l’essentiel dans les locaux de l’Ambassade de France à restaurer l’ordre légal. Le Président et le vice-Président de l’Assemblée nationale ayant été assassinés, Sylvie Kinigi se trouve de facto en charge de l’intérim afin de stopper les violences affectant plusieurs provinces du pays et quartiers de la capitale.

Deux présidents impuissants face à un “putsch rampant” (1994-1996)
Le 13 janvier 1994, l’Assemblée nationale vote un amendement permettant l’élection du ministre de l’Agriculture, Cyprien Ntaryamira (un des fondateurs du FRODEBU) à la Présidence de la République (UN-Report II.C). Entre les opérations “ville morte” organisées par les partis pro-tutsis et les interventions armées envers la guérilla active dans les quartiers de Bujumbura, il faut attendre le 11 février pour que s’installe un gouvernement élargi à toutes les forces politiques. Impuissant face aux violences, sa longévité est écourtée par la mort du nouveau Président aux côtés du Président Juvénal Habyarimana dans l’attentat du 6 avril 1994 à Kigali contre l’avion les ramenant d’un sommet régional consacré aux deux pays et organisé à Dar es-Salaam. Cette nuit-là, informé de la mort de Cyprien Ntaryamira, le Président de l’Assemblée nationale, Sylvestre Ntibantunganya, et quelques décideurs civils et militaires évitent au Burundi de sombrer dans une tragédie similaire à celle du Rwanda. Dès l’aube du 7 avril, la radio nationale annonce la nomination de Sylvestre Ntibantunganya comme Président intérimaire.
Mais le 18 avril, les membres de la Cour constitutionnelle invalident la décision, exigeant qu’elle repose sur la base d’un consensus des partis politiques avant d’être approuvée par l’Assemblée nationale. Ce prérequis sert de prétexte à une nouvelle tentative de coup d’état militaire le 24 avril, rapidement neutralisée. Fortement influencés par le génocide des Tutsis puis la victoire du FPR à Kigali, les partis de l’opposition tutsie, appuyés par de larges secteurs de l’armée, remettent ouvertement en cause la légitimité même du processus électoral de 1993 et la “tyrannie du nombre” qui avantage arithmétiquement les formations à dominante hutue. L’opposition bloque alors l’installation du Président Sylvestre Ntibantunganya jusqu’à la signature, le 3 octobre 1994, d’une “convention de gouvernement” le privant d’une large part de ses pouvoirs constitutionnels.
Confirmé Premier ministre, Anatole Kanyenkiko, issu de l’opposition, devient aussitôt la cible d’extrémistes tutsis qui prennent le contrôle de l’UPRONA et obtiennent sa démission en février 1995. Le 1er mars, le gouvernement formé par Antoine Nduwayo ne réussit pas plus à stopper la surenchère des extrémistes. À la fin mars, sous la pression de milices tutsies soutenues par des militaires, plusieurs quartiers hutus de Bujumbura sont vidés de leur population fuyant au Zaïre. L’affaiblissement manifeste du FRODEBU et du Président Ntibantunganya libère un espace politique aux extrémistes hutus[17] partisans de la lutte armée contre la “reconquête tutsie”. Coups de main, attentats, assassinats politiques, opérations de “pacification” des forces armées : pendant un an, ces formes banalisées de violence politique terrorisent les populations.
Placé sous “protection” de l’armée, le Président ne peut s’imposer ni contenir la guerre civile en gestation. Face aux forces armées et aux groupes paramilitaires qui s’affrontent dans les provinces de l’intérieur puis dans la capitale, les responsables politiques et les forces nationales attachées à la paix sont incapables de protéger les citoyens et d’assurer leur propre sécurité.
Dans ce contexte de “putsch rampant”, le dénouement advint le 25 juillet 1996, juste après le massacre de centaines de déplacés tutsis par des rebelles hutus à Bugendana. Certains attendaient le retour de Jean-Baptiste Bagaza, mais c’est Pierre Buyoya qui s’impose. Le Président Ntibantunganya cherche le salut à l’ambassade américaine. Le putsch court-circuite le projet en cours d’étude d’un dispositif d’interposition de troupes éthiopiennes et ougandaises piloté par la Tanzanie, visant à neutraliser la frontière zaïroise voire à contrôler les agissements de la hiérarchie militaire burundaise.
Le lourd bilan humain de la transition démocratique
D’octobre 1993 au retour de Pierre Buyoya en juillet 1996, le bilan humain de la “transition démocratique” est lourd. On dénombre des centaines de milliers de déplacés à l’intérieur du pays. Après l’assassinat du Président Ndadaye, il s’agit majoritairement de paysans tutsis se réfugiant dans les centres urbains sous la protection de l’armée pour échapper à la fureur vengeresse de militants et de populations hutus. Au cours de l’année 1995, l’organisation par les activistes pro-tutsis de jour¬nées “ville morte” à Bujumbura et les affrontements concomitants aboutissent à l’épuration par l’armée des quartiers à majorité hutue. La capitale de¬vient alors une ville quasi monoethnique.
Plus de 600.000 Burundais ont cherché refuge à l’étranger. Dans un premier temps, la fuite des paysans hutus ou tutsis répond autant à la volonté de survivre qu’à celle de ne pas participer aux massacres. Après l’épuration ethnique de la capitale en 1995, puis le retour au pouvoir de l’armée en juillet 1996, la quasi-totalité d’entre eux était hutus. Mais à l’étranger non plus, ils n’étaient pas en sécurité.
Comme lors des drames antérieurs, ces crimes resteront impunis. À l’échelle internationale, le rapport de la Commission des droits de l’homme de février 1995 débouchaient en octobre 1995 sur l’envoi d’une mission d’enquête “chargée d’établir les faits concernant l’assassinat du Président du Burundi le 21 octobre 1993, ainsi que les massacres et les autres actes de violence graves qui ont suivi”, mais sans la doter d’un pouvoir judiciaire. Attendu pendant trois ans et déposé à l’ONU, le Rapport final, fondé – selon leurs auteurs – sur des enquêtes “tardives” et “incertaines”, analyse les stratégies, crimes et responsabilités des divers acteurs politiques et militaires lors des deux semaines suivant l’assassinat du Président Melchior Ndadaye. Il resta cependant sans suite car le 25 juillet 1996, jour de sa diffusion officielle à New-York, Pierre Buyoya organisa son second coup d’État militaire…
4. De la guerre totale au retour de la paix (1996-2010)
Aucune puissance tutélaire n’approuva le coup d’État. L’attentisme tenait lieu de politique commune malgré l’hostilité déclarée des États-Unis. La solution “Buyoya” soulageait objectivement ladite communauté internationale peu motivée par le déploiement d’un dispositif militaire africain. À l’inverse, la réaction des pays de la sous-région fut très hostile. Le 31 juillet, avec l’appui de l’OUA l’ensemble des pays riverains instaure un embargo total. Le nouveau gouvernement cède partiellement aux exigences de l’OUA en rétablissant, le 12 septembre, l’Assemblée nationale et les partis mais, assumant l’embargo en s’appuyant sur le sentiment national, refuse toute négociation avec les ex-représentants du pouvoir.
Après avoir réorganisé et rajeuni les forces armées, Buyoya s’engage dans une guerre totale contre les diverses rébellions et reprend le contrôle des routes et des campagnes. Il lance ensuite une politique radicale de regroupement des paysans hutus dans des camps surveillés par l’armée afin d’isoler les mouvements de guérilla. Fin 1996, malgré la censure des autorités, les divers décomptes estiment à 500-600.000 les populations concernées et à plusieurs dizaines de milliers les victimes de la faim, des maladies et des violences militaires.
À l’extérieur, Buyoya s’associe à l’offensive ougando-rwandaise au Zaïre pour nettoyer les bases rebelles installées au Kivu. Leurs forces rescapées gagnent la Tanzanie début février 1997. Le soutien affiché des autorités tanzaniennes aux dirigeants du FRODEBU bannis suscite des tensions entre les deux pays après le renouvellement des sanctions par les chefs d’État de la région en septembre 1997, allant jusqu’à des combats directs entre les armées tanzanienne et burundaise.
La survie du nouveau pouvoir illustre l’inanité des pressions extérieures et lui permet de ressouder son camp et de neutraliser ses opposants. L’ex-Président Bagaza est placé en résidence surveillée.
L’ouverture obligée d’un processus de négociations (1997-2002)
Le rétablissement progressif d’une administration opérationnelle sur l’ensemble du territoire s’accompagne, en janvier 1997, d’une timide ouverture politique exigée par les pays de la sous-région envers les ex-partis majoritaires. Le processus de paix des autorités comprend plusieurs volets. Le premier consiste en meetings populaires de “sensibilisation” dans les communes de l’intérieur. Au-delà des convictions des participants, ces opérations médiatiques attestent une extrême lassitude des populations après cinq années de guerre civile. Privilégiant le rapport de force interne, les autorités n’attendent rien du second volet relatif aux négociations avec les forces rebelles engagée dans la lutte armée. Le troisième volet sur l’établissement d’un “Partenariat intérieur” entre les forces politiques en conflit est par contre privilégié.
Après d’intenses discussions, le recentrage autour des principales composantes intérieures et extérieures (rébellions incluses), débouchent en juin 1998 sur une plateforme politique avec un calendrier, un acte constitutionnel de transition adopté par les représentants à l’Assemblée[18] nationale et l’établissement d’un gouvernement de transition réintégrant des ministres du FRODEBU. Un accord signé par toutes les parties prévoit l’ouverture de négociations globales et l’établissement d’un cessez-le-feu pour le 20 juillet 1998. L’embargo régional est finalement levé en janvier 1999.
Si l’adhésion au Partenariat bénéficie d’un large soutien au sein de la sphère politique officielle (gouvernement, parlement, partis) avec le ralliement d’opposants et la création d’une large “Convergence nationale pour la paix et la réconciliation”, les compétitions internes entre les personnalités des partis laissées sans affectation, tout comme les rivalités entre tendances au sein des mouvements de rébellion perdurent. Ainsi, les combats entre rébellions et forces armées accompagnent pendant plusieurs mois encore les négociations organisées en Tanzanie sous la médiation du Président Julius Nyerere, puis de Nelson Mandela. Élargi à d’autres groupes politiques, l’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi est finalement signé le 28 août 2000.

Amorcée en décembre 2000, son application est aussitôt bloquée par une offensive des rébellions pilotée par le PALIPEHUTU-FNL. Bien que stoppée in extremis par l’intervention massive de l’armée rwandaise sur leurs arrières au Congo, elle parvient à s’installer dans les quartiers nord de la capitale. En février-mars 2001, une partie de la capitale est occupée pendant trois semaines. Confrontée à de lourds revers au Congo et à une guérilla interne très mobile, l’armée burundaise est saisie par le doute. En avril, une tentative de coup d’état opéré par des sous-officiers illustre le malaise des troupes et l’image dégradée de l’institution (exactions, corruption).
En mai 2001, outre quelque 500.000 réfugiés en Tanzanie, le pays comptait plus d’un million de déplacés et sinistrés.
L’installation d’un gouvernement d’union nationale (2002-2005)
La nouvelle constitution d’octobre 2001 débouche en janvier 2002 sur l’installation d’un Gouvernement d’union nationale aux côtés d’un Parlement de transition élargi présidés respectivement par des personnalités du FRODEBU et de l’UPRONA. Une alternance au terme d’une période de 18 mois prévoit que Domitien Ndayizeye (hutu du FRODEBU) succède à Pierre Buyoya pour une période équivalente. Cette passation de pouvoir hautement symbolique a lieu le 30 avril 2003, parallèlement au déploiement d’une force de maintien de la paix de l’Union africaine.
La priorité du nouveau président et du gouvernement est de négocier un cessez-le-feu avec les deux dernières factions de la rébellion hutue non intégrées dans l’Accord d’Arusha [les Forces nationales de libération (FNL) et le Conseil National pour la Défense de la Démocratie-Forces de Défense de la Démocratie (CNDD-FDD)], qui continuaient à lancer des attaques sporadiques contre les forces gouvernementales et les civils dans différentes provinces.
En 2004, l’Assemblée nationale de transition accueille donc de nouveaux représentants de mouvements politiques armés. Cette reconnaissance consacre le rapport de force militaire qui prévaut désormais sur le terrain et permet des avancées décisives sur la question des prisonniers politiques, la réhabilitation des sinistrés, les réformes de l’administration et de l’armée, la création de l’unité spéciale chargée de protéger les institutions de transition qui remplacerait le contingent sud-africain, avant l’adoption en 2005 de la Constitution de la nouvelle République suivie des élections.
L’intégration des forces armées et le retour de la paix au cours du premier mandat du CNDD-FDD (2005-2010)
Lors des scrutins de 2005, les électeurs n’ont pas reconduit le parti FRODEBU, mal placé selon eux pour assurer l’intégration des ex-forces armées burundaises (FAB) et des ex-rébellions. Ainsi, le CNDD-FDD, le plus puissant mouvement rebelle, susceptible de s’imposer aussi bien vis-à-vis des ex-rébellions rivales que de l’armée régulière, obtient une large majorité dans les deux chambres du parlement. Réunies en congrès, elles élisent Pierre Nkurunziza président de la République.[19]
Suivent cinq années de décantation politique pendant lesquelles les oppositions se déchirent, alors que le CNDD-FDD parachève son implantation nationale sans échapper lui aussi à une succession de crises internes de leadership et de répartition des dividendes entre les cadres militaires du parti et leurs divers soutiens. À la fin de l’année 2008, alors que l’échéance électorale s’approche, la situation apparait délétère et surtout très ouverte.
En fait, tous les partis sont habités par des peurs : le CNDD d’essuyer un vote-sanction du fait de la corruption ambiante et de l’usure du pouvoir au profit des FNL, celui-ci craint de ne rien retirer du suffrage universel, le FRODEBU redoute de disparaître de la scène politique au profit du CNDD et des FNL et l’UPRONA d’être condamné à être un parti croupion du camp au pouvoir. Les deux problèmes les plus redoutés par les politiciens sont le passé et la corruption, c’est-à-dire la vérité et la bonne gouvernance financière.
Au niveau de la “population urbaine”, la volonté de sanctionner la mauvaise gouvernance et l’impuissance du CNDD semble faire l’unanimité, mais contrairement à 2005 il n’y a pas de solution de rechange, beaucoup voteraient bien pour Agathon Rwasa, mais estiment ne pas pouvoir empêcher son parti de refaire les expériences du CNDD depuis trois ans. En fait, personne ne sait comment vont se passer ces premières élections “normales”. Jusqu’ici, toutes les élections étaient des élections stratégiques, obligées : celles de 1961, l’indépendance ; celles de juin 1993, la démocratie ; celles de 2005, la fin de la guerre. Mais celles de 2010 sont des élections démocratiques normales et le problème de fond est qu’elles vont opposer des élites héritées qui n’ont pas assimilées les règles du jeu démocratique : cohabitation, alliance, alternance. Toutes choses déjà impensables au sein de chaque parti où personne n’est capable de supporter un rival, et proprement inimaginables entre plusieurs partis contrôlés par des clans et des enjeux régionalistes.
Le CNDD-FDD n’est pas mieux loti. Il entretient la mythologie du parti de combattants sortis de la brousse et se défiant des urbains ne s’est pas transformé en parti, n’a pas de vision ni de projet politique. Il est de plus divisé avec le départ de Hussein Radjabu avec ses députés (22), la dissidence d’Alice Nzomukunda qui dénonce la corruption et crée son propre parti, l’Alliance démocratique pour le Renouveau, … La déconnexion est totale avec les jeunes générations. Leur vie, c’est la guerre, les combattants de la rébellion (CNDD puis FNL) qui tenaient les collines la nuit. Ils attendent une refondation de la vie politique non par rapport aux générations héroïques du passé, mais par rapport à des projets politiques pour l’avenir, leur avenir.
Dans cette période agitée et paradoxalement, le Président Nkurunziza ne pèse guère sur les conflits internes au CNDD-FDD qui lui échappent mais, usant de son charisme personnel lors d’innombrables contacts avec les populations rurales, incarne aux yeux de la population une unité par défaut. Il joue outrageusement la carte démagogique du populisme anti-urbain, de l’anti-élitisme pour atténuer son impuissance par rapport aux frustrations des jeunes en termes de mobilité sociale, d’embauche, d’insertion sociale.

Quelques mois avant la fin de la législature, le renouvellement de la quasi-totalité des candidats du parti et une reprise en main par le noyau militaire permettent au Président Nkurunziza, sorti indemne des luttes internes au parti, d’affronter sans crainte le verdict des électeurs face à une opposition divisée. Pierre Nkurunziza a placé ses quatre généraux en faction à Bujumbura (le chef d’État-major adjoint, la sécurité intérieure, etc.) et laboure les collines de l’intérieur avec ses milliards de FBu à distribuer en cadeaux, chantiers, embauches (pistes, écoles, centre de santé, tôles, etc.). Une stratégie populiste de captation du vote paysan. L’anti-Kagame qui a tout fondé sur l’éclatement du “monde paysan” et la rupture idéologique avec le peuple des collines [cf. 01. Notes d’analyse 2009.09]
Lors des élections communales de 2010, les candidats du CNDD-FDD enregistrent un soutien massif des populations rurales, qui après 25 ans de régimes militaires et dix années de guerre, aspirent à la stabilité, d’autant que pour la première fois dans l’histoire du pays, les électeurs sont appelés à voter au terme prévu d’une échéance électorale. Aucun parti n’ayant fait campagne sur la base d’un programme politique précis, la proximité de ses militants et de ses dirigeants locaux a manifestement fait la différence aux yeux des électeurs de l’intérieur face à une opposition divisée s’exprimant via des personnalités largement déconnectées du terrain choisies par les appareils politiques de la capitale. Plus largement, la forte participation et les scores obtenus par le CNDD-FDD expriment un réel satisfecit envers un pouvoir qui a su apaiser les divisions ethniques et surtout réussi l’intégration des forces armées désormais sous contrôle de l’exécutif[20]. La “réconciliation nationale de l’armée avec le peuple” est assurément le facteur déterminant de ce succès.
Désavouées, les formations de l’opposition boycottent la suite du processus, demandant même à leurs candidats élus lors du scrutin communal de démissionner. La majorité d’entre eux refuse en apportant leur voix au CNDD-FDD lors des scrutins nationaux (législatif et présidentiel) avant de rejoindre ses rangs [cf. 02. Notes analyse 2010.10]
5. L’ère Nkurunziza et la consécration du CNDD-FDD comme nouveau Parti-État (2010-2020)
L’absence quasi totale d’élus de l’opposition aux divers échelons de la représentation nationale donne les pleins pouvoirs au CNDD-FDD. En son sein, les “civils” qui prennent le contrôle des administrations communales et provinciales, émancipés des instances informelles du parti (les “militaires”, le “conseil des sages”, etc.), tirent désormais leur légitimité des urnes au travers du plébiscite des électeurs des communes rurales, dument encadrés par les militants de la Ligue des jeunes, les Imbonerakure, “ceux qui voient loin”, et par les parlementaires élus, désignés candidats par les assemblées collinaires du parti. [cf. 03. Notes analyse 2011.09]
L’ampleur inespérée de la victoire dope les militants comme la direction du parti qui annonce immédiatement son engagement dans la campagne électorale pour 2015 avec comme objectif de dépasser les scores de 2010. La gestion des problèmes locaux, du renforcement de l’encadrement des populations et la mobilisation permanente des militants et cadres du parti est prioritaire dans un seul but : conserver l’intégralité des pouvoirs.
Devenir “la première démocratie au monde à être plébiscitée par la quasi-totalité des électeurs” (2010-2015)
Le pari n’apparait pas hors de portée alors que les diverses oppositions se sont auto-dissoutes, que la paix prévaut, que la “réconciliation nationale” se traduit au sein des administrations et du parti par des comportements et des politiques libérés des défiances ethniques, et que les populations rurales profitent des programmes sociaux en matière de scolarisation et de santé. De ce point de vue, l’intégration exemplaire des forces armées illustre les acquis politiques durables du processus d’Arusha. Si les passions, les traumatismes et les peurs hérités des conflits claniques, régionalistes et ethniques récurrents pesaient toujours sur les mémoires des Burundais, ces clivages mortifères n’étaient plus au cœur de tensions notamment parmi les jeunes générations qui aspiraient à la paix et attendaient des urnes le retour à la démocratie en 2005 et 2010.
Ainsi, l’expression publique des citoyens s’émancipe et le Burundi devient une référence régionale en matière de liberté des médias. Ce ne sont plus les personnalités politiques qui monopolisent les ondes mais les journalistes qui débattent des thèmes d’actualité en direct des collines avec la population. De même, en 2012, lors des commémorations du 50ème anniversaire de l’Indépendance, la “Synergie des médias” publics et privés [cf. 04. Notes analyse 2012.03] organisa des échanges inédits et forts sur la paix négociée, l’unité nationale, les nouvelles forces armées intégrées, le rôle des églises et des organisations de la société civile.
De même, en 2015, les quatre ex-chefs d’État encore en vie (J.-B. Bagaza, P. Buyoya, S. Ntibantunganya et D. Ndayizeye) exposèrent longuement leur bilan respectif en suscitant des audiences records dans tout le pays.
Pour la première fois depuis son éviction, J.-B. Bagaza s’exprima publiquement sur son règne et tout le pays s’arrêta pour l’écouter. Fier de ses réalisations, il reconnut également les violations des libertés. Un moment fort dont les millions d’auditeurs sur les collines et lui-même sont sortis apaisés. À cette date encore, les journalistes dans leur diversité palliaient l’impuissance des débateurs politiques (cf. 05. Notes analyse 2013.01-2015.01 Médias.docx) sans ancrage populaire pour les “opposants” ou trop occupés à consolider leurs propres implantations et leur avenir politique pour ceux qui contrôlaient les diverses sphères du pouvoir.
En effet, réélu triomphalement en 2010, il fallut deux ans à Pierre Nkurunziza [cf. 06. Notes analyse 2012.09] et ses proches pour évincer plusieurs des militaires de la direction du parti, installer une équipe dirigeante acquise à sa personne, s’assurer la mainmise effective des jeunesses Imbonerakure formées de militaires démobilisés après l’arrivée au pouvoir du CNDD-FDD en 2005 et récupérés par le parti pour effectuer différentes tâches politiques et administratives. Les Imbonerakure deviennent alors progressivement l’instrument du contrôle rapproché des populations du parti unique de facto. Une organisation similaire aux ex-Jeunesses de l’UPRONA sous les précédents régimes militaires. Pris en charge par les plus fidèles soutiens de Pierre Nkurunziza, ces groupes de jeunes militants reçoivent des entraînements, disposent d’armes de poing, voire à feu, peuvent court-circuiter l’administration locale, la police et la justice et invoquer directement l’autorité de la direction du parti ou des services de la Présidence. On assiste à une véritable prise en otage des populations, isolées et aux mains des cadres du CNDD-FDD. Intimidations, propagande incessante. On ne sait pas grand chose des provinces totalement tenues par le pouvoir : la peur s’est généralisée et s’amplifie. Les populations ne contredisent jamais les autorités, obéissent et répondent aux mots d’ordre sans discuter, alors que la corruption et souvent l’incompétence paralysent les activités, découragent les initiatives.
En avril 2012, après l’élection de Pascal Nyabenda à la présidence du parti, la nouvelle direction développe le mouvement au sein de la police, de l’armée et des administrations publiques. Elle promet de structurer ensuite les milieux intellectuels et notamment les journalistes et les universitaires. Dans cette politique de conquête progressive des lieux de pouvoir réorientée vers les groupes-cibles de la capitale, on trouve aussi de plus en plus de cadres ou de hauts-fonctionnaires de l’administration publique dont la présence contribue à améliorer l’image du parti. Ils lui servent de relais dans les ministères et assoient son emprise sur la sphère économique largement administrée. Alors que la neutralisation ou l’anéantissement de toutes les forces d’opposition structurées voire coalisées est pour l’essentiel achevé, ces ralliements et relais CNDD-FDD conforte la construction d’un champ politique éclaté à l’ombre du CNDD-FDD. L’enjeu prioritaire pour le Président Nkurunziza n’est plus le rapport de force avec l’opposition, mais le rapport de forces au sein même du parti qui tranchera la question incontournable de sa propre succession. Un débat qui normalement n’aurait pas lieu d’être puisque le principe de la rotation des dirigeants prévaut depuis sa structuration au cours de la guerre.
Installés au sein du parti comme une force politico-militaire d’appoint totalement dévouée à Pierre Nkurunziza, les Imbonerakure renforçent la Brigade spéciale de protection des institutions (BSPI) sous ses ordres directs. Devenu la pièce maîtresse du dispositif du pouvoir, le Président peut ainsi faire jeu égal, voire surpasser les deux autres forces politico-militaires susceptibles de le concurrencer (la Police) ou de s’opposer à lui (les Forces de défense nationale) en invoquant la Constitution. Des forces puissantes susceptibles de présenter l’un des leurs comme candidat présidentiable. Nul n’ignore non plus que la majorité des officiers de l’état-major se perçoivent avant tout comme les garants de l’ordre constitutionnel au-dessus des compétitions politiciennes.
Ayant réussi, en dix ans d’exercice, à concentrer en ses mains les outils et ressources du pouvoir, il parait alors insupportable au Président d’avoir à renoncer à ses prérogatives [cf. 07. Note analyse 2014.03-2015.02] et Chronologie 2014 infra]. D’autant qu’il reste à ses yeux une dernière étape importante à franchir : assurer la pérennité du pouvoir du CNDD-FDD. Cela supposerait de profondes modifications de la Constitution et sa dissociation d’avec les Accords d’Arusha[21].
Cet entêtement à se maintenir au pouvoir alors partagé par l’ensemble des présidents de la région impose au dernier arrivé à tenir son rang parmi les “new leaders” révolutionnaires ou progressistes de l’Afrique centrale et orientale, gérontes récidivistes patentés qui modifient leur Constitution pour briguer de nouveaux mandats. Le hasard veut qu’il revînt au moins expérimenté du lot d’ouvrir le cycle électoral en déclenchant un séisme avant de parvenir à ses fins. Un amateurisme qui trancha avec le professionnalisme dont firent ensuite preuve ses pairs de la région[22] !
En effet, après 10 années au pouvoir qu’il s’agisse de la production agricole, de l’activité commerciale, du niveau de vie et de l’emploi, aucun secteur de production ne tire la croissance ou n’absorbe des effectifs significatifs de main d’œuvre. Cette impuissance n’est pas propre à ce régime (cf. Iwacu Magazine 6). Mais en 2015, le niveau d’exigence de la génération post-Arusha a changé. Elle s’est construite au travers d’un large débat sur l’ensemble des réalités burundaises, qui s’est prolongé dans toutes les sphères et provinces du pays et a rendu possible le retour de la paix et l’émancipation politique de tout un peuple. C’est aussi la génération de la liberté d’expression et des médias indépendants qui aspire à la démocratie sans l’avoir expérimentée. Elle ne supporte plus l’étouffement des libertés et l’autoritarisme croissant qu’impose le parti au pouvoir.
Cette revendication s’était exprimée avec force le 19 février 2015, après l’annonce de la sortie de prison de Bob Rugurika, le directeur de la Radio publique africaine (RPA) la plus écoutée du pays, lorsque la population en liesse et en prière s’est massée sur les 50 kilomètres de son trajet de retour vers la capitale.
Cette manifestation reste gravée dans les mémoires car après l’épisode “Rwasa” du 15 décembre 2014, c’est la deuxième fois depuis l’arrivée au pouvoir du CNDD-FDD que de nombreux manifestants s’expriment sans crainte de la police, qui renonce à se montrer… Ces jours-là, les manifestants, comme les militants politiques et associatifs, ont vaincu leur peur de la répression et ouvert la voie à d’autres transgressions pour imposer le respect des libertés d’expression, de réunion et de manifestation au cours de la campagne. Voter est une conquête récente prise très au sérieux.

Le séisme du troisième mandat et la rupture générationnelle
Le verrouillage de la campagne électorale qu’aucun candidat ou parti n’imaginait surmonter vole alors brutalement en éclat lors d’un scénario inattendu, menaçant le régime lui-même. Dès l’annonce de la troisième candidature du Président sortant, violence et répression marquent l’ouverture de la campagne électorale. L’ampleur des protestations et l’endurance des contestataires illustrent déjà des frustrations économiques, sociales et politiques plus profondes. La contestation cible ouvertement les cadres et l’appareil militant du CNDD-FDD qui, après dix ans de combat, ont gouverné le pays pendant une décennie au cours desquelles ils se sont assurés un contrôle politique et économique sans partage. Plus encore qu’en 2010, les élites n’ont toujours pas assimilé les règles des compétitions démocratiques.
Le 25 avril, dès la confirmation par son parti de la candidature du président sortant, la mobilisation populaire est immédiate et se renforce malgré la mobilisation policière. Le 11 mai, les quatre ex-chefs d’État burundais envoient un courrier à leurs pairs, Chefs d’États CAE de la Communauté de l’Afrique de l’Est réunis en sommet à Dar-es-Salaam qui ont mis la situation au Burundi à l’ordre du jour.
Advient alors le putsch manqué du 13 mai 2015 et la neutralisation des auteurs et ou complices présumés. Sa violente répression met à nu la complexité des solidarités et fractures au sein des forces armées, tout comme le conflit structurel Armée-Police. Fin mai, il n’y a plus ni dialogue ni médiation et les forces de l’ordre reprennent en main les quartiers [cf. 8. Notes analyse 2015.05.18-2015.06.18].

En juin, une Commission électorale ad hoc propose un nouveau calendrier électoral et engage une série de scrutins électoraux sous influence. La radicalisation de la campagne officielle menée par le CNDD-FDD, axée sur la dénonciation des putschistes du 13 mai et l’assimilation de toute manifestation d’opposition à de l’insurrection, suscite un vote de peur parmi la population rurale coupée de toute source d’information alors que l’opposition appelle au boycott [cf. 09. Notes analyse]. En juillet, au terme d’élections “ni libres, ni crédibles” selon l’ONU, le CNDD-FDD dépasse la majorité des deux-tiers à l’Assemblée nationale – le pourcentage nécessaire pour s’émanciper des contraintes constitutionnelles et des Accords d’Arusha, l’objectif ultime de la “refondation de la République” – et Pierre Nkurunziza est réélu avec 69 % des voix.
Le mandat de trop (2015-2020)
L’installation du premier gouvernement de la mandature affiche clairement l’option sécuritaire avec la nomination de généraux et d’un commissaire de police aux postes-clés. Parmi les civils, cinq ministres issus des rangs des Forces nationales de libération (FNL) sont nommés, dont Agathon Rwasa qui a lui-même obtenu la Première Vice-présidence de l’Assemblée nationale en contrepartie d’un ralliement opportuniste lui permettant de sauver ses forces militantes et de protéger sa base populaire. [Cf. 10. Notes analyse 2015.09].
Sur le plan diplomatique, la spirale de violence dans laquelle le Burundi s’engage avive les tensions avec le Rwanda où affluent des dizaines de milliers de réfugiés. Les alliances régionales porteuses qui s’esquissaient avec l’appui de l’Afrique du sud et de la Tanzanie sont compromises. En octobre 2017, le Burundi se retire de la Cour pénale internationale[23] et ferme en mars 2019 le Bureau des droits de l’homme des Nations unies. Il redevient “infréquentable”.
À l’intérieur, l’ordre sécuritaire brutal instauré en 2015 ne connait pas d’ouverture. Aucune tâche de moyen ou long terme, ni même de simples perspectives mobilisatrices, ne sous-tendent ou justifient à l’extérieur du CNDD-FDD la personnalisation et le monopole du pouvoir revendiqués alors pour une période indéterminée. Même si le CNDD-FDD dispose de cadres compétents, l’incurie gestionnaire s’aggrave. La croissance en berne, la fuite des capitaux, l’absence d’entretien des infrastructures, la réduction drastique des prestations sociales, le pillage des ressources publiques dissuadent les aides internationales. La sanction des bailleurs, investisseurs et marchés est manifeste y compris de la part de ses principaux “corrupteurs associés”, notamment chinois. Insensibles aux contingences politiques en matière de relations d’affaires, leur référence est la garantie de stabilité de leurs investissements [11. Notes 2016.03-2016.04].
Pour autant, en mars 2018, Pierre Nkurunziza est nommé “éternel guide suprême” juste avant l’adoption d’une nouvelle Constitution qui sauvegarde néanmoins les principaux acquis des Accords de paix d’Arusha en termes de représentation démocratique[24]. Elle lui permet de solliciter deux nouveaux mandats de sept ans lui assurant de rester au pouvoir jusqu’en 2034, comme Paul Kagame au Rwanda ! Seule concession, en mars 2019, Agathon Rwasa déjà associé au gouvernement, obtient enfin la reconnaissance légale des activités de son parti, le Conseil national pour la liberté (CNL), qui pouvait ainsi s’engager dans les élections de 2020.
Au terme de ce troisième mandat, les défis croissants et l’isolement régional et international du pays finissent par contraindre les dirigeants du CNDD-FDD à pousser vers la sortie un Président devenu “imprésentable”. En janvier 2020, Pierre Nkurunziza renonce à sa candidature en échange d’une retraite dorée doublée d’une garantie d’impunité parallèlement à la candidature du général Évariste Ndayishimiye, un homme avisé en retrait et, dans la conjoncture du moment, le seul candidat susceptible d’être accepté par ses pairs.
En face, les formations de l’opposition contribuent aussi au désenchantement populaire. Incapables de se relever depuis leur boycott des élections de 2010, le mouvement populaire de 2015 leur a échappé. Regroupés, au sein du Conseil national pour le respect de l’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi et de l’État de droit (CNARED), mais impuissants et divisés, les leaders exilés engagent finalement en 2019 des négociations dispersées avec le CNDD-FDD pour rentrer au pays et tenter de mener campagne. Leurs bases ayant été siphonnées par le CNDD-FDD et le Conseil national pour la liberté (CNL) d’Agathon Rwasa aucun d’eux n’a pu peser sur le processus électoral dominé par l’affrontement inégal entre le puissant Parti-État et le principal parti de l’opposition actif mais dont les militants et cadres sont inquiétés, arrêtés voire assassinés.
Au terme d’une campagne électorale très tendue, la forte participation électorale sous contrainte laissait espérer au principal candidat de l’opposition que la volonté de changement des électeurs s’exprimerait dans le secret des urnes. Personne n’a donc cru aux résultats finalement validés, mais de toutes parts le réalisme a prévalu. Parallèlement à une très explicite déclaration des évêques de l’Église catholique, les chefs de missions diplomatiques accrédités au Burundi prenaient acte des résultats accordant les deux-tiers des suffrages au général Évariste Ndayishimiye en encourageant, comme l’Union africaine et les Nations unies, tous les acteurs à préserver la paix civile. Agathon Rwasa dénonçait la “mascarade électorale” et son parti déposait sans illusion des recours avant d’être exclu de la distribution des postes.
Le 8 juin 2020, le décès inattendu de Pierre Nkurunziza confronte son successeur, Évariste Ndayishimiye, l’élu coopté par l’appareil du parti CNDD-FDD, à un défi personnel inattendu au regard de la fonction qui lui incombe et plus globalement aux exigences pressantes qu’imposent la situation politique, économique et sociale dégradée du pays. Après sa prise de fonction anticipée, le 23 juin, le président élu nomme Premier ministre Alain-Guillaume Bunyoni (précédemment ministre de la Sécurité publique) et Gervais Ndirakobuca, ministre de l’Intérieur (jusque-là chef du Service national de renseignement), les deux généraux en charge de l’étreinte sécuritaire des populations.

Des nominations qui semblent exclure d’emblée toute ouverture et consacrent les membres enrichis de la nomenklatura aux postes-clés. Face aux réactions internationales négatives, des propos de circonstance sur la lutte contre la corruption visent à rétablir l’image du régime. Des progrès que le Conseil de sécurité des Nations unies enregistre. D’autres effets d’annonce ou ouvertures suivent.
Le 15 août 2020, la présence du Président avec l’équipe gouvernementale à Gitega à la célébration de l’Assomption aux côtés des évêques de l’Église catholique, fermes défenseurs des libertés publiques et de la paix civile, marque les esprits. Viennent ensuite la libération des journalistes du groupe de presse Iwacu et les vœux aux représentants des partis politiques lors des fêtes de fin d’année. Le 25 janvier 2021, après le renouvellement des instances dirigeantes du parti CNDD-FDD lors d’un Congrès extraordinaire, le président Ndayishimiye, invite ses membres à “être à l’avant-garde” dans la mise en œuvre du programme national de lutte contre la corruption et les malversations socio-économiques. Le 19 juin 2021, date anniversaire de sa nomination, au-delà des premiers bilans, il appelle chaque Burundais à être personnellement co-créateur d’un Burundi nouveau et beau. En août, il dénonce à nouveau la corruption qui gangrène le pays en ciblant cette fois la magistrature burundaise… Mais chaque mois apporte son lot de nouvelles affaires ! Certes, en 2021, le Burundi n’avait pas encore replongé dans le dernier décile du classement des pays en matière de corruption qu’il occupait de 2008 à 2012, mais il s’en approche et cumule désormais cette charge avec la reconduction pour la troisième année consécutive au rang
de “pays le plus pauvre de la planète”.
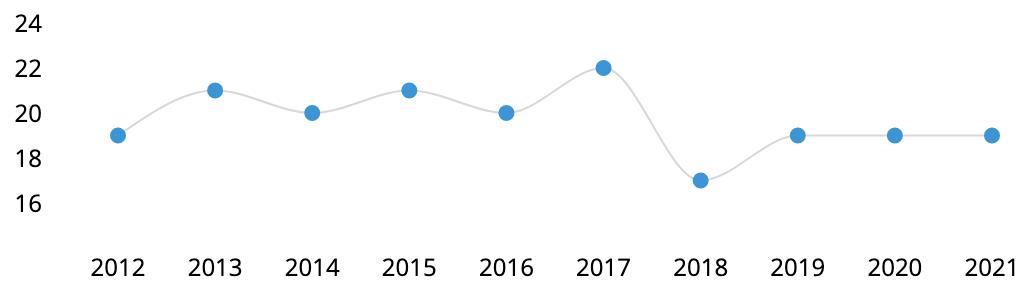 Figure 13 : Corruption Perceptions Index Burundi 2021 Score Change 2012-2021[25]
Figure 13 : Corruption Perceptions Index Burundi 2021 Score Change 2012-2021[25]
6. Faillite gestionnaire, contraintes structurelles et aspirations démocratiques
L’urgence prévaut en effet en la matière. Alors que l’État contrôle tous les pouvoirs et ressources, régule la vie quotidienne des citoyens, n’a plus d’“ennemi” intérieur hors de son contrôle, le bilan des trois mandats de gouvernance CNDD-FDD est cruel. L’impuissance gestionnaire et la déshérence économique franchissent des niveaux inégalés à l’échelle régionale et internationale : l’économie est à vau-l’eau, la misère au plus haut.
“Le pays le plus pauvre du monde”
Il ne s’agit pas là d’un épiphénomène passager puisque le PIB déjà très bas aux débuts des années 1990, ne cesse de baisser après les années 1993-1994 puis la guerre civile. Au plus bas en 2005 avec 798 $/hab., il repart timidement à la hausse de 2005 à 2014, puis ne cesse de baisser après 15 ans de gestion CNDD-FDD : 751 $ en 2019, 731 $ en 2020…, soit trois fois moins que celui du Rwanda. Déjà classé par le FMI en 2013 et 2014 au second rang des pays les plus pauvres du monde selon le PIB/hab., le Burundi accède au premier rang en 2015, repasse au second en 2019 et reprend la tête en 2020 avec une nouvelle contraction de son activité économique de 3,2 % et s’y maintient en 2021. Parallèlement, la dette publique progresse de 45% du PIB à 65% entre 2017 et 2020. De même, le déficit des comptes publics se creuse de 8,3% du PIB en 2019 à 9,5 % en 2020. Une timide reprise de la croissance prévaut néanmoins en 2021 mais le maintient au dernier rang mondial.
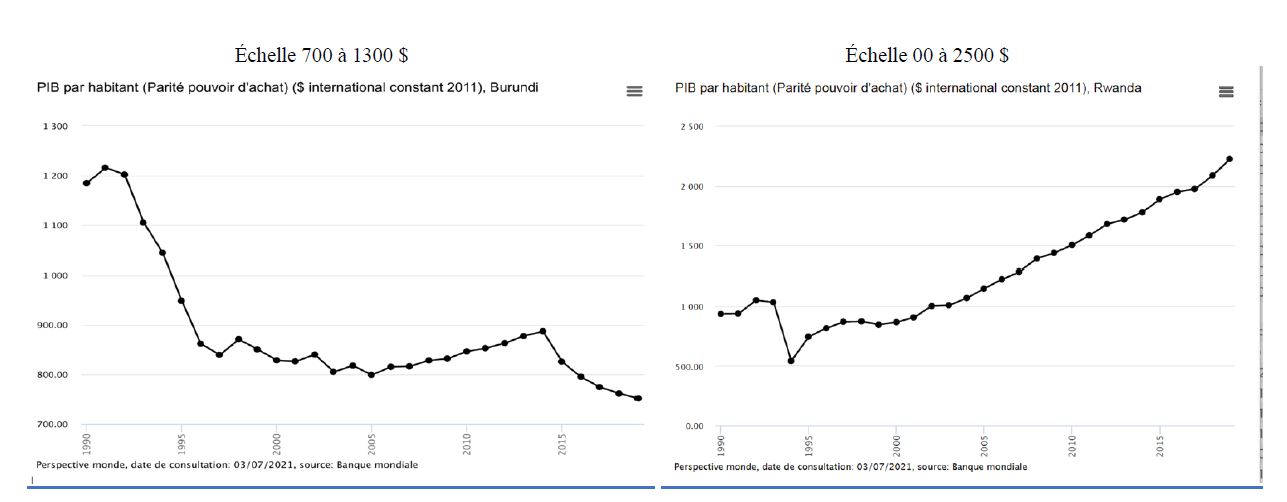 Figure 14 : Burundi PIB per capita 1993-2020 ($ Constant international PPA 2011) [26]
Figure 14 : Burundi PIB per capita 1993-2020 ($ Constant international PPA 2011) [26]
et Rwanda [World Bank International Comparison Program Database]
NB. : À noter que les échelles de valeurs sont deux fois plus élevées au Rwanda.
D’autres éléments comme l’indice du développement humain du PNUD qui, outre le PIB, prend en compte des éléments de bien-être (longévité, niveau d’éducation et inégalités) attestent eux aussi la dégradation impressionnante du classement du pays : 138ème rang mondial sur 189 pays en 1995, 169ème en 2000, 182ème en 2005, 180ème en 2010 et 2015, 185ème en 2019 et 2020.
Assurément, l’impact de la guerre civile et la conjoncture économique internationale récente amplifient les contraintes, mais cela n’explique pas pourquoi dans quasiment tous les domaines économiques et sociaux les performances burundaises sont désormais parmi les plus basses de la planète sans que nulle catastrophe exceptionnelle ou contrainte spécifique puissent être invoquées.
Au contraire, prenant le pas depuis 2012 sur les exportations traditionnelles de café et de thé qui en représen¬taient plus de la moitié, l’or et plus récemment les terres rares (vers les États-Unis 2019-2022 désormais) sont parmi les premiers postes d’exportations du pays. Potentiellement porteurs, mais fatals pour les agriculteurs aux terres dévastées, il est toutefois difficile, ou impossible d’évaluer précisément les dividendes économiques du secteur minier, en raison de l’absence globale et durable de transparence et de la complexité des arrangements entre les multiples partenaires internationaux et nationaux.
Le “peuple des collines” face à ses élites
Après le coup d’État d’avril 2015, la cogestion des “forces armées intégrées” (ex-FAB et rébellions) et les équilibres qui prévalaient en leur sein et entre l’armée et la police prennent fin. Sortis vainqueurs du putsch, les gradés récents issus de la rébellion ne s’imposaient plus aucune limite en matière de rattrapage financier et de “retards de carrière” vis-à-vis de leurs collègues tutsis plus âgés et diplômés des écoles militaires. Jusqu’alors contenues ou dissimulées , ces pratiques, se transformaient en une compétition ouverte en matière d’enrichissement personnel à la mesure des pouvoirs de chacun. Si l’on ajoute les crispations sécuritaires qui inspirent l’encadrement de proximité des citoyens par le parti CNDD-FDD, on pourrait penser que la gouvernance des élites militaires issues des maquis n’a pas fondamentalement rompu avec le cadre et les pratiques des régimes militaires antécédents.
En 2016, lors d’échanges sur la question du “troisième mandat présidentiel”, un des porte-parole éminents du parti CNDD-FDD, invoquant la double légitimité de la victoire militaire et de la consécration des urnes, déclarait : “Après trois décennies de régimes militaires tutsis, nous aurons nous aussi trois décennies devant nous pour refonder la République et instaurer une nouvelle démocratie inclusive”. Confirmant ainsi, comme les Burundais le disent, que les paysans sont censés être au pouvoir “par l’intermédiaire de leurs enfants”, avec la distance d’une génération, via l’école, les universités, les formations militaires et désormais le maquis au nom de leur statut de libérateurs du peuple majoritaire.
L’enjeu est donc majeur. En effet, après avoir été mis autoritairement au travail depuis l’indépendance par les divers régimes militaires qui se sont succédés pour s’approprier l’État, ce sont les propres enfants du “peuple des collines” qui a majoritairement supporté leur combat qui vivent désormais de son labeur. Au regard de la faillite gestionnaire et sociale qui s’est instaurée et semble insurmontable, la rupture pourrait être potentiellement plus profonde que les exclusives ethniques et régionales.
Imaginant avoir porté au pouvoir des dirigeants issus de ses rangs, la paysannerie prend désormais pleinement conscience qu’au-delà de l’atomisation et de l’inorganisation des travailleurs de la terre dont elle porte la responsabilité, c’est au travers des formes mêmes d’intégration et de participation au pouvoir d’État que découle son inexistence politique en tant que classe de petits producteurs.
C’est en effet la paysannerie qui fournit la quasi-totalité des membres et des ressources d’un Parti-État dont la plupart des décisions majeures de politique agraire sont prises en dehors d’elle voire -éventuellement – se conduisent contre elle. Y compris aux échelons de base où les délégués du parti, souvent des paysans, n’exercent que des fonctions d’exécutants. En effet, face à un État qui, sous ses divers prête-noms publics ou privés, s’est imposé comme opérateur économique exclusif, ce sont les fonctionnaires de l’État central et/ou concrètement les cadres du Parti-État qui décident, programment, dirigent les investissements vers les régions politiquement stratégiques et gèrent les interventions productives et leurs retombées.

Mais, au Burundi, la conscience aiguë de la dévalorisation du mode de vie des paysans et de leur dépossession repose sur une configuration idéologique particulière car, à la différence de nombreux pays africains où l’agriculture est moribonde, l’exercice quotidien de la domination subie est pondéré par la conscience de la puissance potentielle massive, si ce n’est de la paysannerie en tant que classe, du moins de l’ordre paysan.
Cette force contenue est bien réelle même si elle s’exprime indirectement dans les limites imposées aux opérations de dynamisation productive et d’animation idéologique. Dans un pays où l’État ne peut vivre sans le labeur offert des producteurs de la terre (soit 30% du PIB pour 90% de la main d’œuvre nationale) sous la forme de produits et de recettes d’exportation, ce repli sur leurs parcelles entretient le sentiment de “tenir” l’État. Largement partagé, ce sentiment soude la paysannerie par-delà ses différenciations et réactive en permanence les valeurs rurales qui tirent leur force du sentiment séculaire de domination de la nature et d’intégration dans un ordre qui, face à la misère, est devenu pour beaucoup une ultime ligne de défense.
Des exigences incontournables

Les ressources agricoles diminuant au rythme de la pression foncière (425 hab./km2 en 2020 et 11,9 millions d’habitants)[28] et des transmissions d’exploitations (avec une taille moyenne désormais inférieure à 0,5 ha), la plupart des producteurs atteignent les limites de l’intensification qu’impose la couverture de leurs besoins essentiels. Un impératif quotidien commun sur la quasi-totalité du territoire.
Deux issues sont actuellement envisageables. La première, qui prévaut déjà au Rwanda, est celle d’une paysannerie assujettie et paupérisée interdite de polyculture biologique produisant “sous contrat” sur ses propres terres remembrées avec des engrais chimiques des cultures commercialisées sous la tutelle omniprésente des cadres politiques et techniques du Parti-État pour couvrir les besoins du marché national et maximiser les recettes d’exportations. Paupérisés, les petits producteurs n’ont plus même la possibilité de repousser sans cesse les limites de “l’intensification” sur leurs propres parcelles. De tels modèles autoritaires d’exploitation se sont toujours heurtés au Burundi à la résistance des travailleurs de la terre qui croyant instaurer la “démocratie” en juin 1993 avaient été abusés par leurs encadreurs s’inspirant déjà du modèle rwandais d’encadrement et de vulgarisation tutélaires. Ils ont ensuite cru au changement en 2005, puis en 2010, en 2015…
La deuxième voie à suivre prendrait enfin en compte les leçons du passé et les impératifs du présent. Depuis l’Indépendance, ayant expérimenté dans la douleur toutes les formes de divisions qui peuvent être exploitées par des régimes autoritaires, la paysannerie sait maintenant que son sort misérable ne résulte d’aucune fatalité hormis les compétitions entre des élites pour la captation de leurs ressources
Seule la réappropriation de l’État, qui le relégitimerait aux yeux de la grande masse des producteurs, pourrait contribuer à libérer les énergies et les ressources qui sont actuellement détournées de leur but. Cela implique que les travailleurs de la terre – et sans terre[29] – et les divers groupes urbains paupérisés s’émancipent des bureaucraties administratives et économiques cooptées sous diverses formes, qui se sont appropriées le pouvoir et les ressources par la force depuis l’indépendance, d’abord au profit d’une élite tutsie, puis d’une élite hutue. C’est dire que le peuple des collines et les populations en déshérence pourraient enfin s’imposer au travers d’élections libres et crédibles en tant que citoyens autoorganisés responsables de leur reproduction et de l’avenir d’un pays démocratique. Cela peut sembler une illusion, mais croire que l’accaparement des richesses et l’autoritarisme d’élites urbaines prédatrices n’ont pas de limites l’est tout autant.
Sortir de la misère et de l’incertitude du lendemain est plus que jamais une aspiration partagée par la très grande majorité des populations rurales et urbaines du Burundi car personne, surtout pour les jeunes générations ne peut être assuré d’un avenir viable. Et notamment les femmes.
En effet, si la Constitution reconnait l’égalité entre les hommes et les femmes, l’Assemblée nationale refuse depuis 2004 de mettre à son ordre du jour un projet de loi qui établirait l’égalité entre les hommes et les femmes en matière de succession, notamment sur le plan du droit foncier. Ainsi, le président de l’Assemblée nationale déclarait le 5 novembre 2021 que sur cette question “on a constaté que ce sont surtout les femmes instruites qui en parlaient et qui voulaient occulter la culture burundaise.” Puis, invoquant cette dernière, il n’hésitait pas à déclarer que satisfaire ce droit déclencherait au Burundi des affrontements pires que les divisions politiques et ethniques : “Si les gens s’entretuent actuellement, qu’en sera-t-il une fois que cette loi sera appliquée ?”.
Ainsi, les revendications pour l’émancipation des jeunes générations, et en premier lieu le refus des discriminations selon le genre qui permettrait aux descendants des deux sexes d’hériter de leurs parents seraient aujourd’hui plus redoutables que les divisions claniques, ethniques et régionales héritées du passé !
7. Le dépassement des “divisions héritées du passé”
C’est dans ce contexte déprimé qu’à la mi-2022 il revient au Président de la République d’organiser la double commémoration des 60 ans de l’indépendance et des 50 ans des “événements de 1972” selon la formule adoptée par le Sénat burundais en mai-juin 2021 pour débattre de la qualification du “génocide des Hutus de 1972”, qui est certainement l’épisode de violence le plus dramatique de l’histoire du Burundi indépendant.
Précédée par la publication du premier bilan d’activité de la Commission Vérité et Réconciliation, cette qualification et, plus globalement, l’ampleur attendue des commémorations se devaient de marquer durablement les débats mémoriels burundais et l’avenir de ce pays blessé. Une opportunité bienvenue pour le nouveau président de faire le bilan de près de deux décennies de pouvoir CNDD-FDD en matière d’unité nationale et d’énoncer au début de son propre mandat ses attentes en matière de Vérité et de Réconciliation… L’exigence est désormais forte car “Se souvenir et bien qualifier les événements de 1972” s’accompagne de la relance d’un volet judiciaire de la CVR.

Les antécédents du débat sur le volet judiciaire de la CVR
Sur ce point essentiel, comme l’ont souligné plusieurs orateurs lors des débats au Sénat, il appartient en effet aux instances judiciaires internationales ou nationales de se prononcer sur la qualification de ces crimes de masse récurrents. On peut certes s’interroger sur les motifs essentiellement politiques qui ont bloqué à divers moments des procédures judiciaires internationales plus conséquentes, mais tout porte à croire que la relance de telles procédures est présentement hautement improbable. Enfin, une chose est d’obtenir de la représentation nationale une qualification formelle des “événements de 1972”, une autre est de débattre et d’assumer au niveau national l’ensemble des divisions du passé.
Sans remonter à un passé lointain, rappelons que les dispositions des Accords d’Arusha établis en 2000 (et redéfinis en 2005 par le Conseil de sécurité de l’ONU) prévoyaient, dans le cadre de la justice transitionnelle, la création d’un tribunal pénal spécial doté d’un procureur indépendant. Mais les actuelles autorités ont régulièrement reporté l’installation d’une Commission Vérité et Réconciliation (CVR) et ensuite refusé de mettre en place cette cour.
Ainsi, en avril 2010, alors que le ministre de la Justice, Jean-Bosco Ndikumana, avait transmis au Président Pierre Nkurunziza un rapport rédigé à partir des consultations nationales qui s’étaient déroulées à la fin 2009 à l’intérieur du pays, celui-ci est demeuré confidentiel. La volonté d’ouvrir un débat public demeurait incertaine. En septembre 2010, le secrétaire général du parti CNDD-FDD, Gélase Ndabirabe, disait qu’il n’en voyait pas l’intérêt immédiat : “réconciliation d’abord, éventuellement vérité-justice après” ; quelques jours après le conseiller diplomatique du Président, Joseph Ntakirutimana, disait exactement l’inverse[30] , mais le Président lui-même était alors confronté à un dossier fort délicat pour lui en raison d’accusations le concernant. Finalement, pour apaiser les craintes communes des officiers des nouvelles “forces armées intégrées” susceptibles d’être accusés de divers crimes, les deux plus hautes autorités de l’État issues du CNDD-FDD et de l’UPRONA (Président et Premier Vice-Président) ont conjointement bloqué la mise en place des mécanismes de justice transitionnelle et, sans le moindre débat public, faisaient ériger à Gitega un monument dont l’inscription “Plus jamais cela” anticipait une hypothétique réconciliation nationale.
Dans cette perspective, la célébration de plusieurs commémorations avait alors été débattue par la direction du CNDD-FDD. En septembre 2011, la programmation envisagée comprenait le mois suivant le 50e anniversaire de l’assassinat du prince Rwagasore (13 octobre 1961, juste après sa nomination au poste de Premier ministre) ; en avril-juillet 2012, la triple célébration du 40e anniversaire de l’assassinat du prince Ntare V Ndizeye le 29 avril 1972, du 40e anniversaire des massacres interethniques et du génocide des élites hutues et, le 1er juillet, du 50e anniversaire de l’indépendance. Venaient ensuite, le 21 octobre 2013, le 20e anniversaire de l’assassinat du président Melchior Ndadaye ; le 6 avril 2014, le 20e anniversaire de la mort du président Cyprien Ntaryamira lors de l’attentat contre l’avion présidentiel du président rwandais à Kigali et, enfin, le 18 octobre 2015, le 50e anniversaire de la tentative de coup d’État contre la monarchie. Cette programmation traduisait la volonté d’associer tous les dirigeants victimes des divisions nationales, incluant notamment la famille royale. Pour chacun de ces événements, des “messages mémoriels spécifiques” avaient été définis et les “résurgences inévitables” anticipées. La multiplication de gestes politiques de “réconciliation nationale” se substituait alors au travail de vérité et de justice incombant à une hypothétique CVR.
En l’absence d’un engagement institutionnel ferme, ce scénario volontariste connut nombre d’avatars. La commémoration “Rwagasore” ne mobilisa guère au-delà de l’UPRONA et de quelques ONGs. Quant à Mwanbutsa IV Bangiricenge, enterré en Suisse, la famille s’opposa au rapatriement de la sépulture et obtint en 2017 son interdiction définitive par la justice suisse. Pour son fils, Ntare V Ndizeye, les recherches du corps n’ont pas abouti en 2012 et les Baganwa demandent toujours la reprise des recherches. En 2013, la célébration du 20ème anniversaire de l’assassinat du Président Ndadaye s’est transformée brutalement, dix jours avant la cérémonie, en une choquante opération de blanchiment mutuel et de dénaturation des faits négociée entre le chef de l’État et le prédécesseur concerné…
Le problème au Burundi tient au fait que les crimes commis relèvent de régimes qui se sont succédés sur la longue durée dans une situation d’impunité récurrente et que le système de pouvoir mis en place par les Accords d’Arusha est théoriquement, au-delà de la représentation formelle sortie des urnes, un pouvoir “réparti” qui n’a pas désigné de vainqueur[31] ni de vaincu alors même que des crimes ont, comme toujours, été commis par les divers camps en lutte pour le pouvoir. Lui-même acteur majeur de cette histoire, le CNDD-FDD ne peut diaboliser ceux qui l’ont combattu[32], ni s’accorder l’impunité pour la part qui lui revient dans les crimes commis lors de la guerre de libération. Or, le travail de vérité et de mémoire tout comme celui de la justice ne peut être fait que collectivement et contradictoirement. Leur recevabilité tient à cela. La crédibilité et la force des vérités énoncées et partagées tout comme la légitimité d’une décision judiciaire ne s’imposent ni ne se décrètent. C’est le prix à payer pour que la vérité soit reçue.
Alors que depuis leur accession au pouvoir, les autorités ont toujours étroitement contrôlé la gestion du passé et l’expression des mémoires remémorées, elles savent parfaitement que dire les souffrances et se libérer des peurs sont aussi des ressorts de mobilisation politique qu’elles entendent maîtriser. Ainsi, après bien des années de débats et blocages, la loi créant la CVR votée le 17 avril 2014 entérinait alors à l’unanimité le refus du volet judiciaire. Entretemps, les populations, qui avaient appris à “vivre ensemble” au rythme des pouvoirs successifs sans imaginer que quiconque ne réponde un jour futur à leurs détresses, faisaient preuve d’une maturité politique exceptionnelle pour exprimer avec force et clarté leur volonté de paix et d’union nationale afin de conforter les assises de la démocratie et consolider les libertés émergentes. C’est pourquoi, malgré le fort engagement de Mgr Jean-Louis Nahimana, à la tête de la CVR de 2014 à 2018, la Commission dite des “vérités divisées” s’avéra impuissante à surmonter les “mémoires ethniques” globalisantes masquant les responsabilités individuelles[33].
En 2018, la nomination de son successeur, Pierre-Claver Ndayicariye, jusque-là en charge de la Commission électorale lors des scrutins contestés de 2015, marque la reprise en main de la CVR. Prolongé de quatre ans, son mandat étend désormais sa compétence temporelle à l’année 1885, date de la conférence de Berlin et du partage de l’Afrique entre les puissances coloniales. La responsabilité des divisions est alors principalement imputée à l’héritage colonial et, au-delà, aux politiques d’“ingérence néocoloniale” qui ont conduit les autorités à se retirer de la Cour pénale internationale en octobre 2017…
Le mandat de la CVR est explicitement recentré par les autorités sur l’exhumation des fosses communes, l’inventaire des lieux de massacres et la collecte de témoignages liés aux “événements de l’année 1972” (cf. Rapport décembre 2020). Des investigations qui ont inévitablement suscité des controverses sur la priorité accordée aux victimes d’un camp et/ou d’un groupe ethnique. Ces débats partisans ont été amplifiés par la condamnation à la prison à perpétuité et à la saisie de tous leurs biens de l’ex-Président Pierre Buyoya (alors Haut représentant de l’Union africaine pour le Mali et le Sahel) et de 18 autres personnalités un mois avant la publication du rapport de la CVR. Ils étaient tous accusés d’“attentat contre le chef de l’État, contre l’autorité de l’état et attentat tendant à porter le massacre et la dévastation” dans la procédure engagée en 2019 sur l’assassinat du Président Melchior Ndadaye en 1993.
Enfin paradoxalement, l’ampleur du travail réalisé sur cet “événement” et sa qualification laissait penser qu’il faudra bien d’autres années, vraisemblablement plus d’une décennie, et beaucoup de moyens, d’énergie et surtout de constance pour étendre les investigations aux innombrables sites des autres périodes de massacres dont la CVR a la charge.

Ces premières étapes franchies, la qualification du “génocide des Hutus de 1972” par les députés et sénateurs réunis en congrès en décembre 2021 devenait une formalité. Le seul débat – essentiel – tenait au choix d’une formulation exclusive ou inclusive vis-à-vis des “autres victimes des divisions nationales” en vue de la commémoration du cinquantenaire du 29 avril 2022. Un choix capital en matière de stratégie mémorielle au regard des enjeux politiques et éthiques qui la sous-tendaient : s’en tenir à une qualification exclusive satisfaisait assurément la propre base politique du régime en consacrant la primauté et la spécificité du “génocide oublié” mais le refus de mentionner “les autres victimes” des multiples épisodes dramatiques post-indépendance qui n'étaient pas prioritaires dans l’agenda de la CVR serait immanquablement dénoncé comme un déni de reconnaissance envers elles.
En effet, on rappellera que plusieurs rapports des Nations Unies, eux aussi restés sans prolongements judiciaires, recourent au terme de génocide en relatant d’autres événements douloureux de l’histoire du Burundi : “le massacre des Hutus par les Tutsis au Burundi en 1965 et en 1972” (NU 1985 p. 9, 16, 19, 28, 37) et “des actes de génocide perpétrés contre la minorité tutsie le 21 octobre 1993 et les jours suivants” (NU 682_F, § 483). Même si pour différentes raisons juridiques et/ou d’opportunité politique elles n’ont pas débouché ensuite sur des qualifications formelles, ces mentions n’ont pas été introduites par hasard dans les rapports des missions d’enquête onusiennes.
Rappelons encore qu’un tel débat – très animé – avait déjà eu lieu en avril 2020 au sein de l’Assemblée générale des États-membres des Nations unies au sujet de la qualification officielle de la Journée internationale de réflexion sur le génocide des Tutsi au Rwanda en 1994 suite auquel les autorités rwandaises avaient imposé l’exclusivité.
Or, le Burundi avait été un des rares pays faricains à ne pas figurer sur la liste des pays sponsors du projet de résolution présenté par le Rwanda à l’Assemblée générale des Nations unies qui refusait d’associer la mention des “autres victimes” à cette journée de réflexion sur le “génocide contre les Tutsi”. Une exclusion vivement contestée alors par le Secrétaire général des Nations unies, le Président de l’Assemblée des États-membres, les représentants des États-Unis et de la Grande-Bretagne, etc. (cf. déclarations UN 1, 2, 3, 4.). Alors même que le génocide des Tutsi au Rwanda reste un événement d’actualité majeur à l’échelle internationale et toujours omniprésent dans les mémoires au niveau national à 25 ans de distance, la simple cohérence aurait voulu qu’une formulation inclusive assume globalement l’héritage douloureux du passé et consacre solennellement le dépassement de l’ethnisme au dont les actuelles autorités se prévalent.
De plus, au final, le choix de la qualification exclusive que les autorités avaient validé a finalement débouché en avril 2022 sur le renoncement à toute commémoration officielle du “génocide des Hutus de 1972”. Un renoncement politique tardif, surprenant et laborieusement argumenté qui fait peu de cas de la longue mobilisation de la représentation nationale pour débattre et entériner cette reconnaissance nationale.
Une inconstance qui suscite bien des interrogations sur la capacité des autorités et de la représentation nationale à définir et mettre en œuvre une politique nationale claire, assumée et comprise sur le traitement des divisions du passé. Est-ce à dire qu’il faudra désormais attendre les reconnaissances modulées des multiples autres massacres majeurs au rythme du calendrier des victimes exhumées établie pas la CVR en laissant ensuite des collectifs de survivants et victimes organiser chacun de leur côté des “célébrations privées” désormais certifiées CVR 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans après la commission des crimes ?
Après une telle faute politique, il sera difficile d’éluder ce point lors des commémorations des 60 ans de l’Indépendance. Le temps est assurément venu de connaître à travers la voix des plus hauts représentants nationaux, leur analyse des divisions du passé, la conception de “l’unité nationale” qui leur incombe au nom de “l’alternance après la fin des régimes militaires” et, plus globalement, la politique qu’ils entendent désormais promouvoir en matière de vérité, justice et réconciliation.
En effet, pour que ces moments de dépassements individuels et collectifs soient durables et assumés, les commémorations se construisent préalablement en mobilisant autour des autorités les représentants de toutes les forces vives du pays impliquées dans ce passé afin qu’elles accompagnent le travail de mémoire et de vérité et veillent au respect des droits fondamentaux de toutes les victimes et acteurs.
60 ans après l’Indépendance, la grande majorité des Burundais attendent enfin des plus hautes autorités de l’État un message d’unité qui rendrait un hommage inclusif à toutes les victimes des divisions nationales et un engagement formel à poursuivre le travail de vérité et de justice sur l’ensemble du passé. Ce faisant, l’énoncé d’un tel message mémoriel répondrait enfin aux aspirations qui s’étaient déjà exprimées avec force lors des Consultations nationales organisées par son prédécesseur à la fin 2009… et restées depuis lors lettre morte !
Des commémorations qui engagent le futur
La vision des autorités est aussi particulièrement attendue sur des enjeux plus larges. En effet, 2022 c’est aussi le 60e anniversaire de l’indépendance nationale qui advient au terme d’une décennie de rupture ayant délibérément compromis les acquis du retour à la paix et les avancées démocratiques célébrée en 2012. La consolidation d’un nouveau régime autoritaire ressuscitait alors des déclarations officielles et des discriminations politiques marquées par l’ethnisme. Un argument étranger aux revendications des contestataires, mais toujours susceptible d’être sollicité par les autorités lorsque leur monopole du pouvoir est susceptible d’être contesté.
Dans une société aux pouvoirs collectifs aussi restrictifs qu’au Burundi, les actes et les paroles des autorités, quelles qu’elles soient, peuvent avoir un poids décisif, car au-delà des individus qui les portent, elles représentent aussi l’appartenance à un groupe ethnique, une région, un terroir, des solidarités socio-professionnelles, des engagements partisans, des obédiences confessionnelles, etc., toutes appartenances susceptibles de nourrir des défiances ou des exclusives. Même lorsqu’elles sont contestées, leurs déclarations et leurs attitudes sont écoutées, interprétées et conditionnent les opinions et actions des gouvernés, des subordonnés, des militants, des fidèles, et parmi eux, en premier lieu, les jeunes générations qui accumulent les positions dominées ou de dépendance. Des générations qui n’ont pas elles-mêmes connu les années les plus dramatiques et qui voudraient enfin pouvoir s’émanciper et se projeter dans un avenir à construire. Pour les ainés, débattre, voire assumer les crimes et les souffrances du passé donne aussi la force de vouloir un autre avenir.
Des clarifications s’imposent donc assurément aux diverses autorités comptables de la “réconciliation nationale” pour que chaque Burundais puisse estimer que les commémorations de 2022 soient effectivement “mémorables”.
Compléments téléchargeables
Remerciements
Il m’est impossible de clore cet écrit sans ajouter quelques remerciements et hommages. Les remerciements s’adressent en premier lieu à tous les personnels et ami(e)s du Groupe de presse Iwacu qui a bien voulu assurer la publication de ces écrits et leur accès gracieux. La constance de l’engagement collectif de ses cadres et personnels pour faire vivre – et, à bien des périodes, faire survivre – ce média, le courage dont ils ont fait preuve chaque fois que la répression s’est abattue sur plusieurs de ses membres qui ont dû s’expatrier, leur collègue Jean Bigirimana qui a “disparu” depuis des milliers de jours ou encore ceux qui ont été condamnés à de longues peines de prison pour avoir seulement fait leur métier. Des épreuves injustifiées envers un média pluraliste et soucieux de vérifier ses informations. Bien évidemment, cette reconnaissance concerne plus largement l’ensemble de la corporation qui s’est continument mobilisée pour la promotion et la défense des libertés d’expression et d’informer.
En outre, et il importe de le souligner, y compris lors des périodes les plus tendues et violentes, il s’est toujours trouvé des personnes qui, quelles que soient leurs fonctions et positions sociales, leurs appartenances politiques, ont défendu et protégé les femmes et hommes des médias “déviants”, opposants ou “ennemis” présumés. À tous les niveaux, et sous tous les régimes que j’ai connus, il s’est toujours trouvé des interlocuteurs de hauts rangs qui ont bien voulu entendre des doléances en matière de répression et de violences arbitraires et/ou démesurées, et qui ont alors désavoué, voire sanctionné leurs auteurs. De même, des récits précis, datés, vérifiables (puis vérifiés…) et d’une franchise surprenante ont été recueillis lors d’entretiens, notamment avec des militaires, sur des épisodes de grande violence ou d’injustice de leur propre passé que j’ignorais ou que je n’avais pas même abordés avec eux. Non pour être rendus publics, mais simplement pour avoir eu le courage de le dire et de les assumer ? À bien des égards, on retrouve là parmi les “grands” de tous les bords ce que l’on pourrait appeler l’“exception burundaise” qui témoigne que les ressorts de la violence ne sont jamais fatals et que leurs divers auteurs pourraient aussi être des porteurs actifs de messages de paix.
Cette “exception burundaise” s’incarne plus encore sur les collines parmi les dominés et exploités qui ne maîtrisent que partiellement la chaîne des mécanismes d’oppression et d’exploitation auxquels ils sont soumis. Mais ils savent aussi exprimer crûment les limites de l’emprise et des pouvoirs de leurs multiples “encadreurs”. Individuellement et surtout collectivement, ils excellent alors à mimer avec ironie leurs méthodes et propos, les détournements possibles et les marges de manœuvre sauvegardées..
Enfin, je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes, des collines à la capitale, qui au cours de ces années m'ont permis de voir, écouter et débattre. Cela n’a pas toujours été facile lorsque les demandes du “chercheur” transgressaient les contraintes imposées ou tolérées en matière d’accès aux terrains, de contacts et de liberté d’expression vis-à-vis de différentes autorités. Mais, quels que soient les régimes et les conjonctures, il s’est toujours trouvé des interlocuteurs, voire des protecteurs compréhensifs. Il me faut encore remercier les multiples coopérations internationales et nationales et notamment la Suisse qui ont rendu possible et/ou accompagné ces activités de recherches. Sans oublier les ambassadeurs de France qui, lorsque nécessaire, m’ont hébergé avec bienveillance à leur résidence.
Notes
[1] Cf. Iwacu Magazine, n°4, mars 2012.
[2] Par André Guichaoua, professeur émérite de Sociologie, Institut d’Études du Développement de la Sorbonne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
[3] Le projet était soutenu et élaboré en collaboration avec la Direction du développement et de la coopération (DDC) et la Division Sécurité Humaine du Département fédéral des Affaires étrangères suisse. Par ailleurs, ces directions soutenaient au Burundi plusieurs autres programmes, notamment les émissions radiophoniques sur les enjeux de justice transitionnelle animé par La Benevolencija Grands lacs.
[4] RNTB (Radio et Télévision) ; Groupe Renaissance (Radio et Télévision) ; Radio Bonesha, Radio Isanganiro, Radio Rema FM, Radio RPA ; les journaux Iwacu et Le Renouveau.
[5] Une armée gardienne des institutions ; Le pluralisme au fil de l’histoire burundaise ; Églises et pouvoirs : des relations ambivalentes ; Regards des diasporas : Venir, Partir et Revenir ; La construction d’une paix durable.
[6] Au moins après les élections de 2015, selon les déclarations des autorités.
[7] On retiendra notamment le gain de 40 places du Burundi entre 2021 et 2022 dans le classement de la liberté des médias.
[8] “Pour comprendre l’évolution politique du Burundi après l’indépendance, il faut connaître celle parallèle de son jumeau, le Rwanda.” (cf. 19960816 _Bur. CS NU 682_F, p. 21).
[9] De 1960 à aujourd’hui, le lecteur peut se référer aux listes et compositions de tous les gouvernements burundais, assemblées et autres structures institutionnelles. [“en cours d’achèvement”]
[10] Les accusés ont été libérés et l’instruction abandonnée fin 1967 laissant un énième assassinat de personnalités hutues non élucidé…
[11] Le clan des Bahima était présent dans divers royaumes de la région avant la colonisation (Buganda, Ruanda, Urundi).
[12] Depuis le début des années 1960, les diverses forces politiques burundaises sont fortement sollicitées par les représentations diplomatiques engagées dans les conflits nationaux et les enjeux régionaux pour le contrôle du pouvoir et des ressources de l’est du Congo. Dès 1963, la Chine est reconnue par le Burundi et active au Burundi. Les relations sont rompues en 1965 et reprennent en octobre 1971 avec l’arrivée au pouvoir de M. Micombero. La Chine joue dès lors un rôle majeur en finançant les forces et régimes qu’elle soutient.
[13] Cf. Rapport politique 093/100/CAB/68 du 18 avril 1968 in Rose Karambizi-Ndayahoze, Le Cdt Martin Ndayahoze. Un visionnaire, Éditions Iwacu, 2016.
[14] Symboliquement, une Union des Jeunes Révolutionnaires du Burundi remplace la JRR de sinistre réputation.
[15] Cf. Comité militaire pour le salut national du 3 septembre et gouvernement de la 3e République du 1er octobre.
[16] Le Front pour la démocratie au Burundi a été créé en 1986 par des dirigeants issus du Parti des travailleurs du Burundi, un parti clandestin majoritairement hutu créé à la fin des années 1970. Légalisé en tant que parti politique en 1992.
[17] Mais aussi tutsis, comme Christian Sendegeya, Stanislas Kaduga, Léonce Ndarubagiye et Joseph Ntakarutimana qui ont occupé des postes importants dans la rébellion à sa naissance.
[18] Élargie désormais à toutes les forces politiques qui n’y étaient pas représentées en 1993, l’Assemblée nationale de transition passait de 81 à 121 membres.
[19] Un combattant formé dans le maquis après l’assassinat du Président Malchior Ndadaye.
[20] Le principal défi réussi découlait du processus de démobilisation qui, entre 2004 et 2008, a concerné 41.000 ex-Forces armées burundaises et 15.500 ex-Partis et mouvements politiques armés. Largement financé de l’extérieur, le double processus de démobilisation d’un côté et d’intégration de la nouvelle armée de l’autre fut considéré comme un succès majeur.
[21] Rappelons que les mouvements de la rébellion armée prohutue n’ont pas participé à son élaboration et ont dû en reconnaître les dispositions pour intégrer le nouveau cadre constitutionnel.
[22] En 2021, le président ougandais, au pouvoir depuis 39 ans, s’est vu confier un nouveau mandat de cinq ans alors que son collègue congolais, après 37 ans au pouvoir, préparait sa réélection, possible jusqu’en 2031. Le Président rwandais au pouvoir depuis 2000 est renouvelable jusqu’en 2034.
[23] Un retrait qui n’affecte pas la compétence de la Cour concernant les crimes allégués commis notamment en 2015-16.
[24] Parité ethnique (50%-50%) dans l’Armée et la Police, au Sénat où il y a également une parité au niveau du genre ; 60% Hutus et 40% Tutsis à l’Assemblée nationale et au Gouvernement, approbation des principales nominations par le Sénat. Le principal abandon concerne le retrait du Service National de Renseignement des corps de défense et de sécurité avec obligation de parité ethnique de ses membres.
[25] Le score d’un pays est le niveau perçu de corruption du secteur public sur une échelle de 0 à 100, où 0 signifie très corrompu et 100 signifie très propre. Classé en 2020, 165ème sur 180 pays analysés dans l’Index de perception de la corruption de Transparency international, il descend à la 169ème place en 2021 (168ème rang du dernier classement 2019 de Doing Business).
[26] Cet indicateur illustre l’importance de l’activité économique d’un pays et la grandeur de sa richesse générée. En dollars constants, il est le plus adéquat pour comparer des économies entre elles et à travers les années puisque les valeurs sont toutes ramenées à une même année de référence. En matière de comparaisons internationales, cet indicateur est d’autant plus pertinent qu’il introduit la correction de la Parité de Pouvoir d’Achat qui tient compte des différences de pouvoir d’achat entre les différentes monnaies. Enfin, dans la mesure où la taille de la population est intégrée, il permet d’avoir une image très juste de la richesse d’un pays. Cf. Banque mondiale, autres indicateurs (8).
Ainsi, depuis 2007, plus de 30.000 militaires burundais ont servi en Somalie dans la mission de paix de l’Union africaine (AMISOM), d’autres en Centrafrique, bénéficiant d’importants sursalaires ou revenus d’“affaires” alors que l’État s’assure de généreux prélèvements : “Les missions de maintien de la paix ont permis aux militaires d’échapper aux difficultés socio-économiques auxquelles fait face la majorité de la population burundaise.” (ICG, 2017). Des trajectoires de promotion et de fidélisation supérieures à celles des Imbonerakure qui assurent sur les collines l’encadrement politique, le contrôle de la mise au travail et des prélèvements sur les populations. Mais la concurrence est désormais rude en matière de diplomatie militaire.
[28] Et 11,5 en 2019, soit un taux de croissance annuel de 3,12 %.
[29] En 2021, les acteurs humanitaires ciblaient 1,06 million de Burundais dont des personnes déplacées internes (PDI), des rapatriés et d’autres catégories de la population affectées par les urgences, cf. OCHA, Plan de réponse humanitaire Burundi, mars 2021, soit près de 10 % de la population.
[30] Entretiens des 9 et 14 septembre 2010.
[31] Le CNDD-FDD n’était qu’une des composantes de la rébellion armée hutue et les forces armées burundaises sont demeurées à parité avec un ministre de la Défense issu des ex-FAB jusqu’en 2015.
[33] “Il ne faut jamais perdre une guerre, une bataille éventuellement, mais jamais la guerre, car c’est celui qui la gagne qui écrit l’histoire des vaincus, l’exemple de la victoire du FPR au Rwanda a toujours été présent dans nos esprits pendant la guerre.” (entretien avec un haut responsable du CNDD-FDD, 13 septembre 2011).
[33] Elle a néanmoins recueilli plus de 70.000 témoignages recueillis, plus de 4.000 fosses communes identifiées permettant ainsi à des familles de faire enfin le deuil des leurs, plus de 20.000 “présumés auteurs” ayant accepté de témoigner.
Notes d’Analyse : Sommaire
• Note d’analyse 1 : Le contexte sociopolitique au début de la campagne électorale (Septembre 2009) – A. Guichaoua
• Note d’analyse 2 : Bilan de l’année électorale (Septembre 2010) – A. Guichaoua
• Note d’analyse 3 : Un pouvoir autoritaire à la tête d’un “État fragile” (Septembre 2011)
– A. Guichaoua
• Note d’analyse 4 : Programme “Conférences pour mémoire” (Mars-Juin / Septembre 2012)
– A. Guichaoua et S. Capitant
• Note d’analyse 5 : Programme “Médias-Mémoire-Histoire” (Janvier 2013-Janvier 2015)
– A. Guichaoua & S. Capitant
• Note d’analyse 6 : L’adaptation du CNDD-FDD à ses nouvelles tâches prioritaires du temps de paix (Septembre 2012) – A. Guichaoua
• Note d’analyse 7 : Une stratégie de campagne électorale catastrophique (Mars 2014-Février 2015) – A Guichaoua
• Note d’analyse 8 : Le Burundi dans la tourmente (Mai-Juin 2015) – A Guichaoua
• Note d’analyse 9 : Les trois temps du régime CNDD-FDD au Burundi (Mai 2015)
• Note d’analyse 10 : Les leçons d’un énorme gâchis (Septembre 2015) – A Guichaoua
• Note d’analyse 11 : La stabilisation du nouvel ordre autoritaire (Mars-Avril 2016) – A. Guichaoua